Part I - Le dossier Rennes-le-Château, du vrai et du faux - premier bilan Part II - Les 7 clés du Serpent Rouge Part IV - Généalogie des rois mérovingiens, les Manuscrits ou généalogies mérovingiennes de l’abbé Pichon (B) les Dossiers Secrets d’Henri Lobineau et
conclu en apothéose par la Légende de Dagobert, collage inclus dans « Pierres
Gravées du Languedoc » d’E. Stüblein, provenant d’un ouvrage de 1648, nous
venons d’apprendre la réapparition, à la BnF, de la gravure de la dalle, dite
des chevaliers, publiée par la SESA[1]. Beaucoup de preuves, relatives à l’affaire de Rennes-le-Château, émergent
de plus en plus rapidement. Le Serpent Rouge, autre publication apocryphe,
pilier de l’histoire, tiendra ses promesses. Mais avant de vous dévoiler ce
qu’est réellement cet opuscule de 1967 qui a fait couler tant d’encre et
dérouler des kilomètres de pellicules cinématographiques avec le roman « Da Vinci Code », pour n’en citer qu’un, voyons d’abord ce qu’il en est de cette fameuse
Généalogie des rois Mérovingiens, travail rapporté par le présumé, non moins
célèbre, H. Lobineau[2], faire valoir du
Prieuré de Sion.
Description du matériel L’ouvrage
se présente comme une succession d’arbres généalogiques des comtes, des ducs de
Bar et de Lorraine, de Dagobert Ier, des comtes de Razès, de
Boulogne, de Bouillon, des familles de Buchet, d’Igny, de Lenoncourt, de Liseras,
de Guitry, de Mareuil, et enfin de Gisors et de Saint-Clair. Les
références de ces travaux seraient les écrits de l’abbé Pichon en 1814, du Dr Hervé
(1843), d’un généalogiste nommé Hamberg (1912), de Gédéon Dubreuil (1857)
historien de Gisors. On y trouve aussi les parchemins de l’abbé Saunière et le
manuscrit de l’abbé Denyau sur l’histoire Gisors en deux volumes. Pierre
Plantard, qui est le véritable commanditaire et auteur des généalogies, y a ajouté
une page d’une revue titrée « la Semaine Catholique Genevoise » et
une carte de l’ancien pays audois. Inutile
de vous préciser que ces filiations ont été montées de toutes pièces à partir de documents véritables mais tronqués
à souhait. Il suffit de connaître la véritable provenance des deux parchemins cryptés
du curé de Rennes-le-Château pour se faire une idée de tout le reste. En créant
et en antidatant ces tableaux, il apportait des pièces justificatives,
apocryphes, aux Dossiers Secrets qui viendraient plus tard. La
carte géographique a été tirée du livre d’Elie Griffe « Histoire
religieuse des anciens pays de l'Aude »[3].
Comme nombre d’archives récupérées et utilisées par le Prieuré de Sion, elle a
juste été retouchée, voire recopiée. Nous avons pu faire la comparaison avec un
original de cette carte publiée par Pierre Jarnac[4]. Dans
les Généalogies Mérovingiennes Lobineau, la carte a été recopiée et dans « Un
trésor mérovingien à RLC »[5] elle
n’a été que retouchée. Le
feuillet de la « Semaine Catholique Genevoise » semble être une pure invention.
A notre connaissance, il n’existe en effet aucune revue portant se titre, même ailleurs
en Suisse. Nous
reviendrons bien entendu sur les références. Nous allons, auparavant, démontrer
la nature frauduleuse des tableaux généalogiques en prenant pour exemple celui
de Dagobert Ier, des familles de Gisors, de Guitry, de Mareuil et de
Saint-Clair. La descendance de Dagobert Ier A
l’âge de sept ans, Dagobert II, fils de Sigebert III et petit-fils de Dagobert
Ier, roi d’Austrasie fut envoyé dans le monastère irlandais[7] de
Slane (on le dit aussi en Ecosse) en 654 par Grimoald, maire de palais
corrompu. Ce dernier l’avait fait passer pour mort après avoir tenté de le
faire assassiner dans son couvent. Le jeune prince échappa aux mains du
meurtrier envoyé par Grimoald et s’enfuit. Il parcourut ainsi longtemps
l’Irlande, l’Angleterre et la Bretagne[8] sous
l’identité obscure d’un étranger. Puis il fit la connaissance de Wilfrid
d’York. Evêque clairvoyant, Wilfrid s’intéressa au jeune Dagobert et fit tout
son possible pour le ramener sur le trône d’Austrasie. Les desseins du prélat
se réalisèrent en 674 quand la forfaiture de l’usurpateur Grimoald fut
démasquée. Les princes d’Austrasie ouvrirent le tombeau de Dagobert II prétendu
mort et en voyant la sépulture vide ils destituèrent le maire de palais félon
puis l’envoyèrent à Clovis II, oncle de Dagobert, qui le fera exécuter. Dagobert II avait épousé
pendant son exil une saxonne dénommé Mectilde (ou Mathilde). De ce mariage
naquirent cinq enfants, quatre filles et un fils : SIGEBERT né en 661
était l’aîné[9], suivaient Irmine[10]
abbesse d’Oeren, Adèle abbesse de Palatiol au diocèse de Trêves, puis Ratilde
sourde et muette et enfin Ragnetrude, dont il est fait mention dans le
testament de sa sœur Adèle. Nous
avons donné cette histoire détaillée, suivant celle des comtes de Madrie et de
Razès, dans le Mercure de Gaillon N°1. Il est franchement étrange de ne pas
trouver une référence au père Henschenius dans les généalogies Lobineau, alors
qu’il est le premier, bien avant A. de Vallois, à réhabiliter la mémoire de
Dagobert II et de son fils Sigebert IV, le roi perdu. Un
roi perdu ! C’est du pain béni pour qui veut s'octroyer quelque
descendance royale française mérovingienne. Plantard ne fut pas le seul à
tenter le coup. On se souviendra de la famille Bush, celle des deux Georges,
deux « Bonesmen[11] »,
fauteurs de guerre en Irak, dont certains généalogistes dociles et patentés
attribuèrent une origine royale européenne. La même équipe, de l’Eglise
Mormone, une des têtes de l’hydre Illuminati, semble vouloir rejouer le même
scénario avec Barack Obamma, président des Etats-Unis. Elle lui donne en effet
non seulement un cousinage avec Dick Cheney, autre « Bonesman », ex-vice
président coupable de crime de guerre en Irak au même titre que son complice
G.W. Bush, mais aussi des racines françaises[12]…
alsaciennes… rien de moins ! Alsace, partie de l’ancien royaume
d’Austrasie de Dagobert II… La manipulation de masse continue. Jusqu’où
iront-ils ? Or,
si Sigebert IV reste un roi perdu, certains historiens ont donné un deuxième
fils, à Dagobert II, voire un troisième ou un quatrième. M. Charles
Grellet-Balguerie[13] cite
Clovis III ayant régné cinq ans sur le royaume d’Austrasie. A l’appui de ces
affirmations viennent plusieurs diplômes et chartes du règne de Clovis III.
Selon l’auteur on ne devra plus le confondre avec le fils de Thierry III. Quant
au R.P. Buffier[14] de la Compagnie de Jésus,
à l’instar de G. Henschenius, il nomme Clotaire IV et Thierry[15].
Nous voici maintenant en présence de quatre rois, plus ou moins perdus ! A
moins que Clovis III Clotaire IV ou Thierry ne soient en réalité Sigebert IV…
Ces nouvelles informations tirées de sources irréfutables jettent le trouble
dans nos recherches. Vacillant sur ses fondements, le scénario « plantardo-rhedaesien »
est encore un peu plus plombé. Outre
la survivance de Sigebert IV, de Clovis III Clotaire IV ou Thierry, le lieu de
sépulture de Dagobert II est sujet à discussion. Assassiné le 23 décembre 679,
on le dit inhumé en l’église Saint-Pierre de Rouen[16] ou
bien à Stenay, comme le racontent les historiens de l’est de la France[17]. Une
double sépulture est envisageable puisqu’il était de coutume à cette époque de
conserver le corps dans un tombeau et ses entrailles dans un autre. Les sépultures
de Charles de Bourbon, archevêque de Rouen et roi de la Ligue, sous le nom de
Charles X, à Gaillon et Fontenay-le-Comte en font foi. La famille de Gisors Au
XIe siècle Gisors était une seigneurie sous la domination des comtes
du Vexin, sous tutelle normande, héritiers de Galeran (ou Walaran) comte de
Meulan. L’Église de Rouen y possédait encore ses terres. Gauthier, fils de
Galeran, puis Gauthier II, Raoul le Grand et enfin Raoul II se succédèrent dans
le comté du Vexin. Raoul II devint le gardien des biens du clergé rouennais. Vient
ensuite Simon, son fils, qui tint Gisors et Neaufles jusqu’à la restitution de ses
biens à l’archevêque de Rouen vers 1075. A partir de cette date Gisors passe
dans la maison des héritiers de Chaumont-en-Vexin qui fit alliance avec celle
de Boury (ou Bodris, Bodrys). Si l’on en juge par une charte de 1105
mentionnant la rétrocession des terres de Gisors à l’archevêché de Rouen, Raoul
II comte de Meulan est aussi celui que l’on appelle Raoul de Bodrys[18]. 
L’arbre
généalogique de la maison de Boury-en-Vexin est difficile à établir. Nous
pouvons toutefois en extrapoler une branche par Geoffroy[19]
donné pour grand-père de Mathilde de Boury. Elle épousa Hugues Ier
de Chaumont, dit « Francon ». De ce mariage naquit Thibault dit
« Payen », futur seigneur de Gisors. La meilleure source sur la généalogie de la Maison de Gisors est une
étude de J. Depoin « Les Châtelains de Gisors »[20]. On trouvera
encore un grand nombre d’informations sur la famille de Gisors dans le
cartulaire de l’abbaye Saint-Martin de Pontoise où la plupart de ses membres
furent inhumés. Ce sont des références vérifiables et accessibles passant
par-dessus la tête de P. Plantard. En aucun cas il n’existe de parenté entre Thibaut Payen, fils de Hugues
de Gisors, et Hugues de Payens, fondateur de l’Ordre des Templiers. Le rôle des
Templiers de Gisors s’y joue autrement, et surtout sans en minimiser le poids
et les conséquences. Voyez cette histoire complète dans le Mercure de Gaillon
N°2 ou dans le FANUM II. 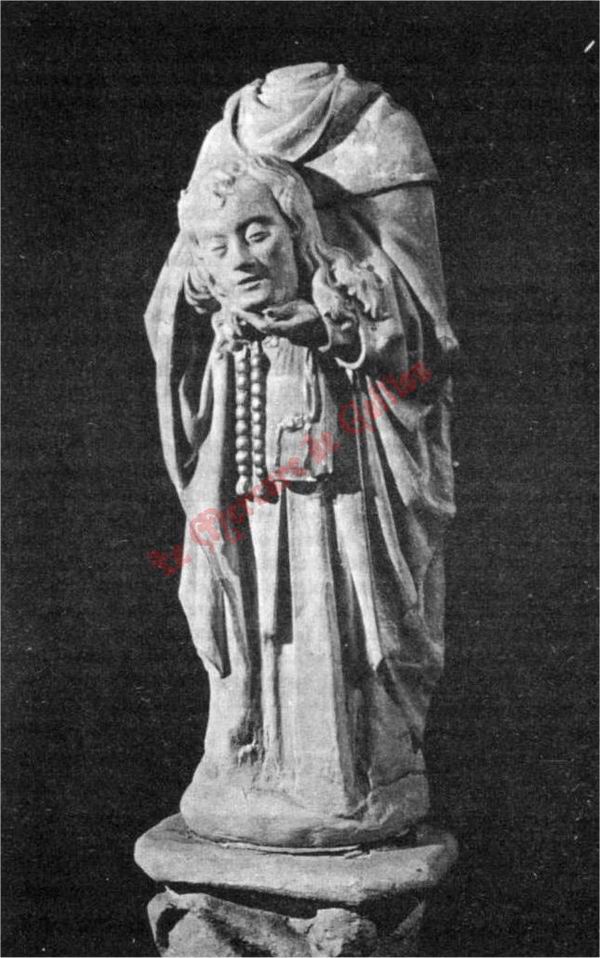
La famille de Saint-Clair Il existe
en France pas moins de seize communes portant le nom de Saint-Clair. En
Normandie, nous en connaissons six. Pour notre histoire, nous nous bornerons
simplement à celle de Saint-Clair-sur-Epte et Saint-Clair-sur-Elle. Au
commencement était la famille de Saint-Clair sur Epte, près de Gisors, site où,
selon la légende, fut exécuté le saint éponyme[21].
Plus tard on y ratifia le célèbre traité de Saint-Clair (911) faisant de la
Normandie un état souverain. La
généalogie de cette famille de Saint-Clair-sur-Epte est si approximative que le
Prieuré a tôt fait de mêler ses racines à la famille de Sinclair d’Ecosse. Lié
depuis fort longtemps à la franc-maçonnerie écossaise, cette famille portait en
effet le même nom, écrit de la même manière, à ceci près que les Saint-Clair
(ou Sinclair) d’Ecosse sont issus d’une famille implantée dès le XIe
siècle à Saint-Clair-sur-Elle, dans la Manche. Le premier du nom était Walderne
qui, en épousant Marguerite fille de Richard II et de Judith de Bretagne,
obtint du duc de Normandie les terres de Saint-Clair-sur-Elle. Le Prieuré de Sion avait
donné pour femme à Henry de Sinclair, second baron de Rosslyn, Isabelle de
Levy, introuvable dans la généalogie des barons de Rosslyn. En réalité il se
maria avec Rosabel (ou Katherine) de Strathern. De même, le Prieuré lui donna
pour fille Marie de Saint-Clair, Grand-Maître du Prieuré de Sion vers 1220. Ce
qui est évidemment faux puisque c'est son fils, Henri de Sinclair deuxième du
nom, qui eut une fille se prénommant Marie, issue de son mariage avec Margareth
Grathenay[22]. Cette Marie de Sinclair
ne fut, par ailleurs, jamais mariée à Jean de Gisors comme le soutient le
Prieuré. C’est en effet à ce moment précis de l’histoire qu’il a tenté de
mélanger une troisième lignée de Saint-Clair, exprimée ici par Saint-Cler pour
clarifier un lignage fortement embrouillé. Et l’on découvre ainsi que
les Saint-Cler sont une branche de la famille de Chaumont alliée à celle de
Gisors. C’est le parfait imbroglio jouant en faveur de la duperie du Prieuré.
La famille de Chaumont possédait la seigneurie de Guitry en pays du Vexin dont
un fief a été appelé Saint-Cler[23]. Les
rejetons de cette branche deviendront les seigneurs de Saint-Clair-sur-Epte. Vers 1220, Robert de
Chaumont, dit le Roux, fils de Osmond II, seigneur de Guitry fut le premier à
porter le nom de Saint-Cler. Son trisaïeul, Robert l’Eloquent, était le frère
de Hugues de Chaumont père de Thibaud-Payen seigneur de Gisors. Robert le Roux
eut trois enfants[24] de
sa femme Isabelle. Tout est encore une fois
vérifiable et accessible à tous dans les « Mémoires de la Société
Historique et Archéologique de l’arrondissement Pontoise ». P.
Plantard en fait la totale abstraction. Voyez cette histoire dans le Mercure de
Gaillon N°3 . Dans cette affaire nous
sommes obligés d’examiner les informations sous toutes les coutures. Notre expérience,
aussi modeste soit elle, et notre méthode de travail nous protège contre toute
forme de manipulation. Les archives étudiées par le Mercure de Gaillon sont
issues de nos propres investigations. Nous n’avons reçu l’aide d’aucun clan
local tant à Gisors qu’à Rennes-le-Château. Nous n’avons jamais reçu de «documents secrets»
par le biais d’une filière occulte quelconque. C’est plutôt bon signe et cela
s’explique très facilement. Tout faux document serait très rapidement détecté
et les « metteurs en scène » ou farceurs démasqués. Avis aux
amateurs !
Thierry Garnier Remerciements particuliers à : A-M Lecordier (*) Voir téléchargement.
[1] Bull. de la
Soc. D’Etudes Scientifiques de l’Aude de 1927, p. 197. [2] Cote BnF :
Fol LM3 4122 [3] V.1, Des origines chrétiennes à la fin de l'époque
carolingienne, 1933. [4] Histoire du
Trésor de Rennes-le-Château, éd Bélisane, P.Jarnac, 1998, p.27. [5] Par A. L’Ermite
(pseudo). [6] Diatriba de
tibus Dagobertis, par G. Henschenius, Molsheim, 1623-1655. [7] Histoire de
l'Irlande ancienne et moderne, tirée des monuments les plus authentiques, T.I,
par James Mac-Geoghegan, Imp. Antoine Boudet, 1758, p.359. Voir aussi, History of the Irish Hierarchy
with the Monasteries of Each County, Biographical Notices of the Irish saints,
par Thomas Walsh, éd D &J Sadlier, New-York, 1854, p.607. [8] Histoire
générale de l’établissement du christianisme T.II, par Ami Bost, éd. Marc Aurel
frères, 1838, p.439. [9] État de la
France dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement Ecclésiastique
etc... T.I, par Henri Boulainvilliers et Philippe Mercier, éd. T. Wood & S.
Palmer, Londres, 1737, p.280. [10] La Hollande
catholique, par Baptiste Pitra, éd. Librairie classique catholique, 1850, p.97.
Voir aussi Mémoire de l’Académie Celtique, par la Société des antiquaires de
France, T.III, 1809, p.455. [11] Membres de la
fraternité Skull & Bones [12]
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/07/21/01011-20090721FILWWW00290-obama-confirme-ses-origines-francaises.php [13] Deux
découvertes historiques. Histoire de Clovis III, nouveau roi de France, 672 ou
673 à 677-678. Authenticité et date précise de la translation du corps de saint
Benoît en France. Nouveaux documents, diplômes royaux (l'un de Clovis III),
bulles inédites, 1882. Voir aussi la revue « La Légitimité, journal
historique hebdomadaire, organe de la survivance du roi martyr», 1886. [14] Pratique de la
mémoire artificielle, pour apprendre et retenir l’histoire, 1712, p.124. [15] Mémoire sur les
trois Dagobert, par le R.-P. Berain, 1717, p.26. A
consulter dans le FANUM II. [16] Histoire de
France, depuis Pharamond jusqu'à la vingt-cinquième année du règne de Louis
XVIII, T.I, par Jacques Corentin Royou, éd. Le Normant, Paris, 1818, p.103.
L’église Saint-Pierre est aujourd’hui appelée Saint-Ouen. [17] Histoire de
Montmedy, par M. Jeantin, 1863. [18] Recherches
historiques sur le tabellionnage royal et principalement en Normandie, par
Alexandre Théodore Barabé, Ed. Boissel, Rouen, 1863, p.8. [19] Histoire de la
ville de Gisors, P. Hersan, 1858, p.23. [20] Mémoires de la
société historique et archéologique de Pontoise. [21] Cf. Le Mercure
de Gaillon n°2, avril mai juin 2008. [22] Généalogie of the Sainteclaires of
Rosslyn, par Richard Augustin Hay, 1835. [23] Dictionnaire
topographique du département de l'Eure, par Ernest Poret De Blosseville, imp.
Nationale, 1877. [24] Cartulaire de
l'Abbaye de St-Martin Pontoise, J. Depoin, 1909, p.370. |


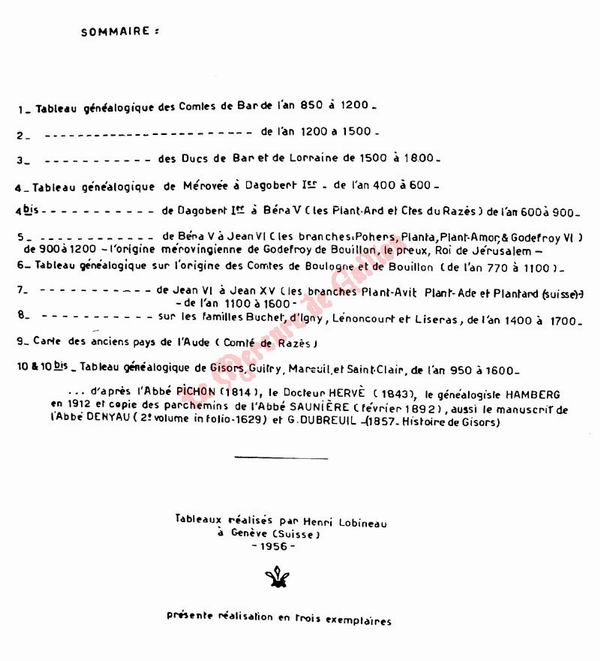


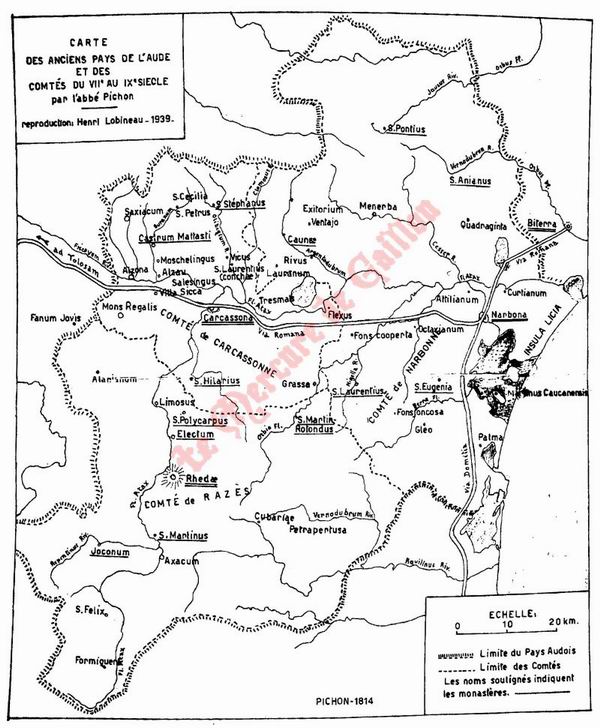
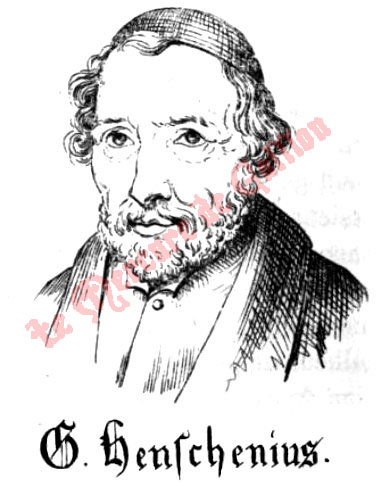 Nous ne
remettons pas en cause la vie de Dagobert II et l’existence de Sigebert IV. Des
auteurs anciens tel Adrien de Vallois ou le père Henschenius
Nous ne
remettons pas en cause la vie de Dagobert II et l’existence de Sigebert IV. Des
auteurs anciens tel Adrien de Vallois ou le père Henschenius
