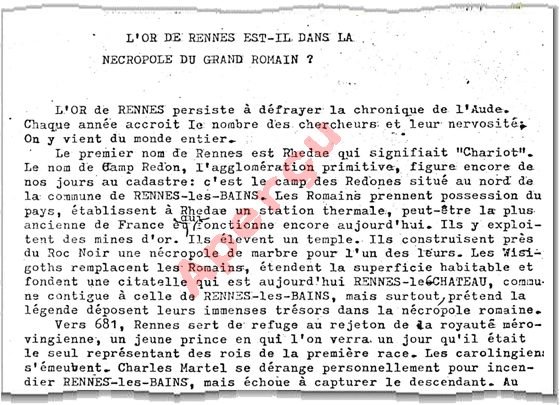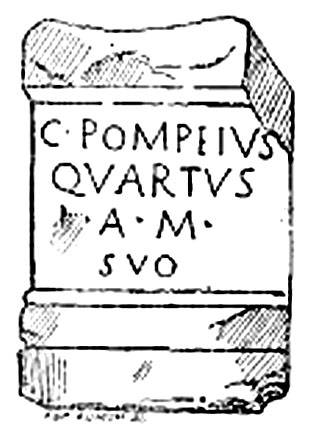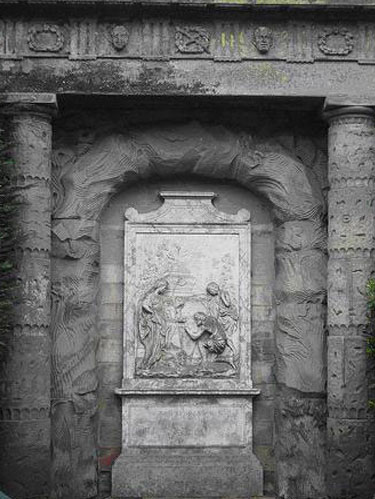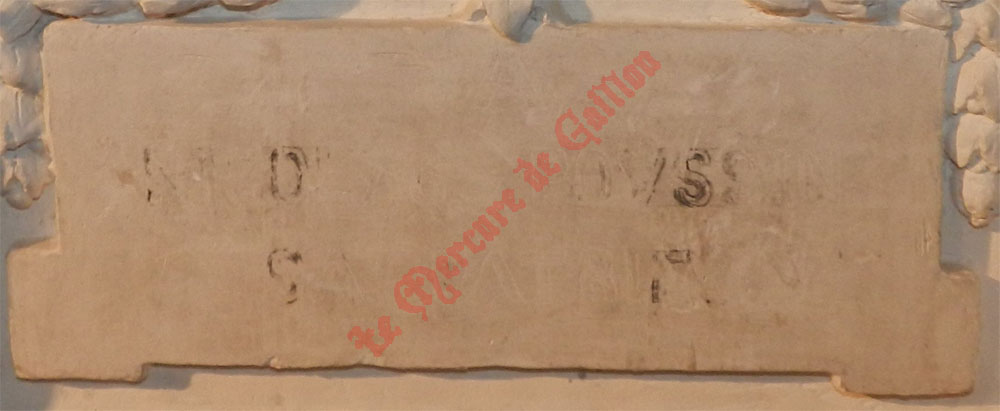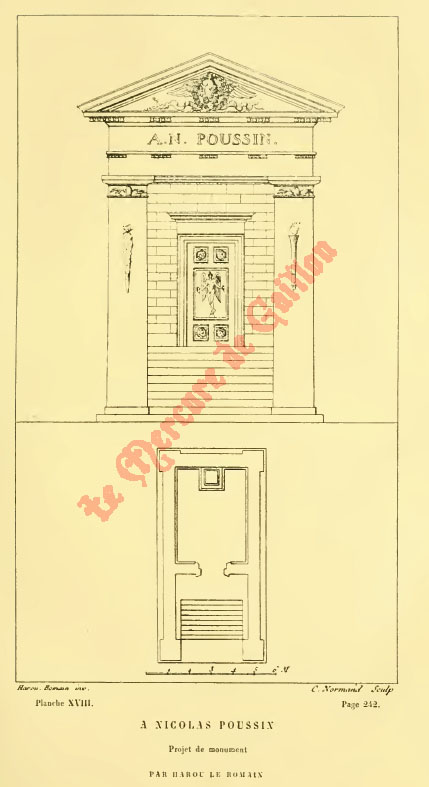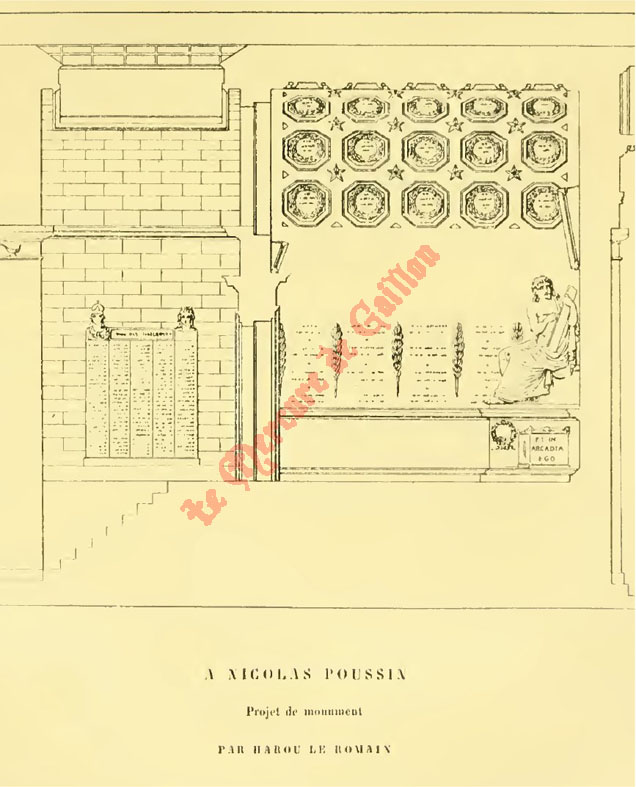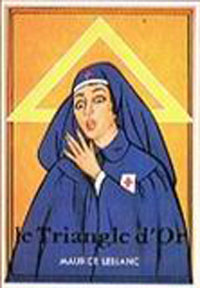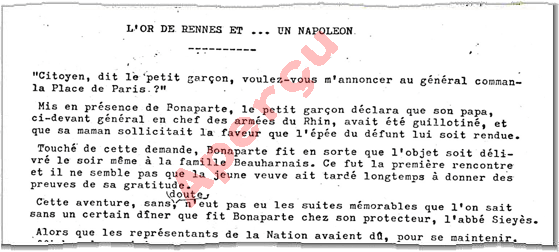Part I - Nicolas Poussin, une énigme en son temps L'horizon des événements a basculé. Un point de non-retour a été franchi. Méthodiquement nous avons mis au jour la réalité d'un
Temple souterrain dans le périmètre de Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains.
Ne fut-il que symbolique, nous en avons trouvé la porte et les clefs. L’anneau scellant l’entrée a été brisé. En deux tours,
nous avons déverrouillé la serrure. La porte s’est entrouverte, mais les
battants restent désespérément rivés entre eux. La porte semble bloquée de
l’intérieur. Les rouages philosophiques d'une telle mécanique sont aussi
surprenants à découvrir que la tâche est rude à les dégripper. Un couteau
Suisse, même sorti du Vatican, n’y suffirait pas. Les choix de l’abbé  Le vaste réseau de recoupements mis au jour entre
divers documents et personnages historiques nous a permis de comprendre
pourquoi un grand nombre d'artistes peintres et d’auteurs littéraires se sont
penchés sur ce secret millénaire avant et après Bérenger Saunière. Les mythes de l’Arcadie y ont pris une
place prépondérante. Mais pourquoi l'Arcadie justement ? Pour qui s’intéresse
de près aux mythes du Razès, cette question est obsessionnelle. Elle taraude
l’esprit du chercheur depuis la genèse de l'affaire des deux Rennes.
Pourquoi l’abbé Saunière a-t-il choisi le thème de la
mythique Arcadie pour faire passer son message à travers le temps et plus
particulièrement le tableau de N. Poussin « Les Bergers d'Arcadie »
(ou l'Arcadie) ? Car il s'agit bien de cela. Faire passer des
informations à la postérité, ou tout du moins à ceux qui sauront les décrypter,
voire tout au plus à ceux qui auront la curiosité de se pencher sur ce mystère.
Dans l’art, l’Arcadie est systématiquement associé
allégoriquement à l’Âge d’Or ou à l’au-delà. Or ceci n’est qu’un épais
brouillard cachant d’autres vérités. Chez Poussin on a décelé tour à tour la
révélation d'une géographie sacrée relevant du zodiaque, des tribus grecques
venues avec leur troupeau de moutons faire pâture dans les Pyrénées ou de la
tribu de Benjamin égarée. Sachant que le tombeau des Pontils n'existait pas au XVIIe siècle, on suppose, à juste titre, qu'un
élève de N Poussin, Antoine Rivalz natif de la région, a pu exécuté le fond de
tableau de l'oeuvre majeure du maître resté en Italie. On sait,
avec la plus grande certitude, que le tableau inspira B. Saunière pour élaborer
son jeu de piste. Le tombeau fut édifié vers 1900 par la famille Galibert, non sans avoir pris quelques directives auprès de
l'abbé Saunière. L'abbé Mazière nous apprend en effet
qu'un caveau avec une simple dalle gravée existait bien avant le mausolée des Galibert. La dalle fut ensuite transportée à
Rennes-le-Château et réemployée. Il s'agirait de la trop célèbre dalle où est
gravée la citation latine "Et in Arcadia
Ego". Rien ne permet de confirmer ou de renier le témoignage de l'abbé Mazière à l'heure actuelle. Au delà de ces éléments très subjectifs, nous
disposons d'informations complémentaires plus solides pour comprendre la ligne
directrice Arcadienne tracée par Saunière. Au demeurant, il ne fallait pas
chercher bien loin puisque c'est M. Julia de Fontenelle, l'auteur d'un mémoire
sur les eaux thermales de Rennes-les-Bains, qui apporte une première réponse
particulièrement intéressante. Dans une correspondance adressée à un certain Ernest
en juillet 1821, après un long descriptif historique basé sur le récit de
l'abbé Delmas, dont il détient le mémoire que nous
avons longuement étudié, il déclare : « Ce
lieu est propre à inspirer ceux qui, à l'exemple de Théocrite, de VIRGILE, de Roucher, St Lambert, Dellile etc.
voudraient en célébrer les agréments champêtres. Les bons pâturages qui environnent
les Bains de Rennes y rendent le mouton excellent ». Les affinités du Poussin pour l'œuvre de Virgile sont
de notoriétés publiques. La thématique pastorale des Bergers d'Arcadie en
découle directement. En transposant cet
environnement au confluent de la Salz et du Rialsesse, Julia de Fontennelle
donne plus que tout autre une légitimité aux travaux "arcadiens" de B
Saunière. Le tombeau du Grand Romain Ce n’est pas tout. L'œuvre de Nicolas Poussin est sans
doute celle par laquelle l'énigme a été le plus largement commentée. Des
tentatives d'explications, souvent erronées sans pour autant être totalement
fausses, ont vu le jour sous la houlette de Pierre Plantard et Philippe de Cherisey. Une de leur première tentative fut de prétendre, au
travers de l'opuscule du "Cercle d'Ulysse", que les travaux de
l'abbé Delmas, sur les antiquités des Bains de Montferran, autrement dit Rennes-les-Bains, donnaient la véritable
explication et prouvaient l'existence du tombeau des Pontils dès le XVIIe siècle.
La seconde fut commise dans une autre brochure dont
ils avaient le secret, intitulé "Le trésor de Rennes-le-Château est-il
dans la nécropole du Grand Romain"? Grand Romain issu des prophéties
de Nostradamus, car sa « prophétie » est indéniablement imprégnée des mystères du Razès. Nous avons
compté au moins une douzaine de présages et quatrains se référant à ce pays
languedocien. Dans cet article le marquis de Cherisey
s’ingénie à faire du tombeau d’Arques un des jalons principaux pour retrouver
la sépulture du Grand Romain à grand renfort de poudre de perlimpinpin. Il en
révèle même la position exacte, laissant la porte ouverte aux vandales avides
d’or et d’argent. Les pauvres hères étant tombés dans le panneau n’eurent que
leurs yeux pour pleurer car, bien entendu, tout n’était que contes de fées afin
d’écarter les chercheurs de la véritable piste. C'est au travers de ces documents que se rejoignent
les deux versions « prieuresques ».
Véritable numéro d'illusionniste en vérité, car si l'abbé Delmas
nous parle bien d'un tombeau, il disserte seulement sur la sépulture probable
du Grand Pompée en référence à diverses pièces épigraphiques découvertes à
Rennes-les-Bains (ci-contre). Pompée
devenant ainsi le Grand Romain pour l'occasion et de faire le parallèle avec
l'oeuvre de Nicolas Poussin "Les Bergers d'Arcadie" avec son épitaphe
"Et in Arcadia Ego". Quant aux quatrains de Nostradamus se rapportant au
tombeau du Grand Romain, où l’on décrypte une allusion arcadienne, ils sont au
nombre de trois: III.65 Quand le sepulcre du grand
Romain trouvé, Le jour apres sera eslu pontife, Du senat gueres
il ne sera prouvé Empoisonné son sang au sacré scyphe.
(Coupe sacrée = Graal)) VI.66 Au fondement de la nouvelle secte, Seront les os du grand Romain trouvez, Sepulcre en marbre apparoistra
couverte Terre trembler en Auril, mal
enfouez. IX.84 Roy exposé parfaira l'hecatombe, Apres avoir trouve son origine, Torrent ouvrir de marbre & plomb la tombe D'un grand Romain d'enseigne Medusine. L’ordre dans lequel les quatrains ont été écris et
publié n’a pas de réelle importance. Il faut en effet commencer par le quatrain
IX.84, suivi par le III.65 et VI.66. Un sens de lecture qui semble être
logique. Nostradamus nous révélerait alors « l’apparition d’un Roi qui,
après avoir trouvé son origine, découvrirait dans un torrent (courant de
rivière) le tombeau de marbre plombé du Grand Romain, marqué de l’emblème de
Méduse (ou Mélusine), après l’élection d’un Pape ». Rien n’indique pour
autant que ce tombeau soit situé dans le Razès. Toutefois la référence à Méduse
indique l’origine arcadienne du tombeau nostradamique.
« Dans le temple de Minerve Poliade[1] (ou Athéna
Aléa chez les grecs) à Tégée en Arcadie, on conservait des cheveux de Méduse,
dont Minerve avait fait présent aux Tégéates, disait-on,
en les assurant que par-là leur ville deviendrait imprenable. Le temple était desservi
par un prêtre qui n’y entrait qu’une fois dans l’année »
[2]. Une variante du mythe indique que Céphée, un des Argonautes comme son père Aléons, devint le roi de Tégée. Il obtient d'Athéna Aléa
que sa ville demeure imprenable : à cette fin, la Déesse lui confia une pièce de la chevulure
« serpentiforme » de la Méduse (ci-contre) par
l’entremise d’Heraclés de retour de sa chasse contre
le sanglier d’Erymanthe. Nombreuses sont les études tendant à démontrer une
orientation Herculéenne dans les Bergers d’Arcadie de Poussin. Pour certain, le
pâtre agenouillé à gauche du tableau montrant l’épitaphe du sépulcre ne serait
pas autre chose qu’une symbolique de la constellation d’Hercule[3]. De plus, la seule bergère en présence à sa droite
est une représentation d’Athéna. Dans la même veine, si on y ajoute la
symbolique du Serpentaire, l’empreinte de la gorgone Méduse est évidente. Michel de Nostredame, dont
les ancêtres étaient originaires d’Alet-les-Bains, en Razès, n’a pas ménagé ses
efforts pour faire passer un message d’Initié à Initié. Message pour un roi
futur, ou « pontif » perdu, figé pour l’éternité par
Nicolas Poussin dans son oeuvre à la faveur d’un fond de tableau (sans tombeau)
réalisé par Antoine Rivalz, enfant du pays. Dans l’ombre de Daphnis, des Théâtres de la Reine ou Cromlech de Rennes-les-Bains,
les travaux d’Hercule, paraphrasent les vers d’un « Filleul » de
Virgile et les quatrains alambiqués de Nostradamus. En d’autre terme, le
tableau de Nicolas Poussin est la meilleure représentation picturale de ses
trois quatrains révélant la découverte d’un tombeau ou d’un temple souterrain. Un bas-relief révélateur Alors, quid de nos jours du tombeau du Grand Romain à
Rennes-le-Château ? Aucune révélation n’a été faite, aucune découverte de ce
genre n’a été annoncée, après l’élection d’un Pape. Seuls quelques cippes
funéraires romains ont été retrouvés au XVIIe
siècle et sont bien connus, notamment celui portant la mention « C. Pompeius Quartus A.M ». Néanmoins le voile obscure de la manipulation des
faits se déchire à la faveur de la réapparition d'une improbable pièce de sculpture.
Une curiosité, s'il en n'est, qui loin d'apporter des réponses directes, aura
eu l'avantage de nous faire replonger dans l'oeuvre du Poussin et des monuments
érigés à sa gloire.
La sculpture en question est une reproduction en plâtre
du monument érigé par Chateaubriand à Rome dans l’église San
Lorenzo in Lucina en 1829, dans le sens initial
du tableau de Poussin. Elle mesure 125cm de hauteur sur 95cm de largeur. Sa
facture date de la fin du XIXe, début XXe siècle. Elle se présente sous la forme d’un bas-relief
dans un tableau cantonné par des pilastres corinthiens. Ce bas-relief est orné
à sa base d’un portrait du Poussin en médaillon, présenté par deux putti (ou
amours), sous lequel est suspendu un panneau gravé de la sentence « A
NICOLAS POUSSIN SA PATRIE » et paré d’une guirlande à tête d’angelots.
L’ensemble est posé sur un socle à ressauts, surmonté d'un G gravé sur une
pièce cubique dont je laisse la libre interprétation aux quelques « frères » à l'écoute.
La suite ne pourra que confirmer toute interprétation d’équerre. L'objet a été vendu aux enchères le 15 décembre 2013.
Cette vente s'est déroulée Aux Andelys, berceau de Nicolas Poussin. Les
informations sur le vendeur sont inconnues. Nous savons uniquement que ce plâtre
est issu d'une collection privée parisienne.
Le nom de l'acquéreur n'est pas plus connu. Le prix de vente a été adjugé à 7000€. Ce monument n'a aucune incidence sur l'affaire de Rennes-le-Château.
Il en a pourtant avec le monument maçonnique glorifiant le Poussin
dans le Shugborough Hall au Royaume-Uni et un lien marqué par le
commissaire-priseur avec le mausolée de Rome. D'où un retour aux sources d'une certaine connaissance "plantardienne", semée de confusion certaine. Suivant
le marbre britannique, ce moulage est le troisième monument prouvant l’Initiation
de Nicolas Poussin aux Grands Mystères. Le deuxième étant sans conteste
la règle édictée par Joséphine Péladan, fondateur de l’Ordre de la Rose+Croix en
1892. Une initiation que nous avions déjà mise en évidence par son appartenance
à l’Académie ou Guilde de Saint-Luc,
simple couverture pour un ordre occulte, de beaucoup plus secret. Le projet de l’an X d’un
« grand » Romain Les projets de monuments à la gloire de Poussin sont
peu nombreux. Ceux qui ont aboutis le sont encore moins, sans compter les
statues à son effigie. Nous pouvons en dénombrer trois: celui de Chateaubriand
à Rome, celui de Shugborough Hall en
Angleterre en 1760 et celui de Villers (son village natal) près des Andelys
érigé en 1926. Si d’autres monuments existent, qu’on nous les signale. Aux Andelys même, il n'y a qu'une statue. Un projet plus
important devait pourtant y voir le jour. Dès 1799 l’idée était lancée. Une
grand temple mausolée, dit sacellum, aurait dû
être érigé au Petit Andelys, non loin du Château Gaillard, placé sous
l'ombrage silencieux d'une espèce de bois sacré[4] (sic). Le
projet avait pour directeur Nicolas-Philippe Harou, dit Romain, architecte. Ca ne s’invente
pas ! Le Romain est son pseudonyme. Une souscription avait été proposée le 20 fructidor de
l’an X (10 mai 1802)[5]. Le 25
suivant des plans du sacellum furent définitivement
adoptés et le dessin publié dans la 4e livraison des Annales du Musée
du peintre Landon. Pendant plus de 70 ans ce projet sera
discuté, écarté, remis sur le tapis, porté à bout de bras par divers
intervenants pour finir totalement oublié.
Il aura donc fallu la vente aux enchères du 15
décembre 2013 pour ressortir des cartons un vieux projet, certes poussiéreux
mais ô combien instructif. Dans sa description tout d’abord. Non content
d’être une création d’Harou, dit Romain, celui-ci
nous dévoile ses objectifs : « Le pied d'une montagne
escarpée, sur laquelle sont les ruines d'un ancien fort, nommé le château
Gaillard, une voie publique et les murs du Petit-Andelys,
formeraient le plan antérieur. Un peu au-delà serait le Sacellum
placé sous l'ombrage silencieux d'une espèce de bois sacré »[6].
En bordure de Seine, tel le fleuve Alphée, il décrit en quelque
sorte le paysage du tableau des Bergers d’Arcadie[7]. Toutes
ressemblances avec les allusions au sommet de Blanchefort
près de Rennes-les-Bains propagées au XXe siècle, n’est
peut-être pas dues au hasard. Le piton rocheux de Chateauneuf
à Port-Mort (27) et le tombeau de St Ethbin , non loin du
village natal du Poussin sont dans la même situation : « Que ce
même tombeau, tracé par son pinceau (du Poussin), soit élevé en pierre dure,
en marbre, s'il est possible, et placé sur un tertre semé de gazon ; qu'il
soit ombragé par un groupe d'arbres dont la tige élevée, dont la variété des
masses ébranlées dans les airs, rappelle un jour au voyageur surtout ses nobles
paysages »[8].
Harou-Romain a-t-il voulu donner corps à la vision de
Nostradamus ? Béranger Saunière eut-il connaissance de ce projet ? On
peut le supposer mais nous n’en savons rien. Toujours est-il qu’il réussit vers
1900 là où Harou-Romain avait échoué cent ans plus
tôt. Par le biais de la famille Galibert, il fit
édifié le tombeau des Bergers d’Arcadie dans un site miroir, aux Pontils en
Razès, glorifié par Julia de Fontenelle sous l’invocation de l’oeuvre de
Virgile. Harou-Romain poursuit : « On a eu l'intention
d'exprimer sur la façade principal le génie créateur du Poussin, par un
flambeau en bas-relief, sur l'une des antes ; son âme forte, par une massue
couronnée d'un papillon, sur l'ante parallèle ; l'étude qu'il fit du coeur humain
et de la nature physique, par des oiseaux sculptés dans le gorgerin des
chapiteaux ; deux de ces oiseaux se regardent près d'un miroir, et deux autres
becquètent près d'une palette, l'un dans le calice d'une fleur, l'autre, dans
un fruit entamé jusqu'au centre.[...]. Sa raison sévère et son esprit
poétique, par les bustes de Minerve et d'Apollon ajustés en Hermès à l'une
des tables du porche, sur laquelle serait gravée une
notice historique sur ce grand peintre. [...].
On a voulu encore que l'intérieur du Sacellum contînt tous les titres du Poussin à
l'immortalité. Sa statue poserait sur un piédestal. La face principale de ce
piédestal offrirait une barque submergée avec un serpent[9],
qui cherche, mais en vain, à échapper des flots. Sur l'un des côtés seraient le
lit d'Eudamidas, son bouclier et sa lance, et sur
l'autre côté serait le Tombeau du Berger d'Arcadie, avec l'inscription (n.d.l.r : Et In Arcadia Ego)
touchante que le Poussin traça lui-même.[...]. La voûte du Sacellum serait enrichie de trente-cinq caissons octogones.
Dans chacun d'eux serait aussi une couronne, au centre de laquelle serait
l'indication d'un autre tableau du Poussin. En place des petits caissons losanges
seraient des étoiles »[10]. Rien ne manque. L’hommage rendu par Harou-Romain va bien au-delà des connaissances picturales
et historiques de Poussin. L’initiation du maître transpire en Silence. A
la Table d’Emeraude symbolique, entre Minerve et Apollon, Hermes « Trismégiste »
en est le témoin éclatant. La massue couronnée d’un papillon représente
le maillet en bois d’acacia, le symbole de la maîtrise Initiatique[11].
L’acacia est non seulement un bois maçonnique mais aussi un arbre de la famille
des papilionacés[12]
tel que le Lupin (la fleur), l’ajonc, le trèfle ou le haricot. Clin
d’oeil à Arsène en passant. C’est d’ailleurs l’arbre figurant dans le paysage
arcadien du tableau de notre Poussin, une espèce de bois sacré que
l’architecte voulu reproduire aux Andelys, telle la branche d’Acacia plantée
sur le tombeau d’Hiram. Architecte, ce dernier avait édifié le premier
Temple de Salomon, le Saint des Saints, dans lequel fut disposée l’Arche
d’Alliance fabriquée elle-même en bois d’acacia. Et d’une nature morte, entre le marteau et « l’enclume »
d’acacia si j’ose dire, un nombre certain de souscripteurs au projet de l’an X,
frères F :. M, frappent trois fois notre curiosité, si ce n’est à
la Porte du Temple, et s’invitent à la table d’Hermés
ou de Mercure. Des personnalités dont les noms de familles, par le plus
« heureux des hasards », ne sont pas du tout inconnus dans les
divers dossiers composant l’affaire de Rennes-le-Château. De la connaissance du secret Sont appelés à la barre des témoins : le premier
Consul Napoléon Bonaparte, Anselme-Marie Fouquet de
Gisors (écrivain), Jacques-Louis David (peintre), Alexandre
Lenoir (administrateur du Musée des Monuments français), Antoine-Denis
Chaudet (sculpteur). Anselme-Marie Fouquet de Gisors, n’est pas à mettre de côté. Descendant de l’illustre
Nicolas Fouquet et des Ducs de Belle-île, comte de Gisors, il était né à Paris
en 1767, mort en 1827. Cet Anselme-Marie entretint
avec Harou-Romain des relations amicales jusqu'en
1816. La nature du secret Audois de Poussin connu du ministre
« renégat » de Louis XIV donne
soudain au projet de l’an X une dimension inattendue. Napoléon,
encore consul, fut le premier à apporter son soutien et son obole à ce projet.
Pour ce qui concerne l'affaire de Rennes-le-Château, on le voit apparaître
comme par magie sous la plume de Plantard et de Chérisey dans quelque
publication pittoresque, « L’or de Rennes et un Napoléon » notamment. Le peintre David retient l'attention
pour un tout autre motif. A l'instar de Napoléon, il était franc-maçon. Initié
de longue date, il pris sous son aile un certain Olivier d'Hautpoul.
Fils d'Angélique Lenoir et Jean-Marie-Alexandre d'Hautpoul Felines, il fut en effet
élève de David. D'où notre intérêt porté à un autre souscripteur, Alexandre
Lenoir, sauveur de quelques débris du château de Gaillon, car nous le
suspectons d'un cousinage plus ou moins proche avec ladite Angélique Lenoir,
dernière détentrice des précieuses archives de la famille d'Hautpoul-Felines Les liens familiaux établis ont permis de révéler
certaines facettes inconnues de l'histoire. La famille d'Angélique Lenoir
propriétaire à Paris d'un immeuble ayant pour enseigne le Chariot d'or s'était
mise en relation avec quelque orfèvre de la place : un certain Chéret qui pour
diverses raisons était associé au sculpteur A.-D.
Chaudet, souscripteur lui aussi pour le projet de l'an X. A cet instant de l’histoire, il est bon de rappeler
certains faits étranges et merveilleux[13] s’étant
déroulés au début du XIXe siècle, indirectement
liés avec l’énigme de Rennes-le-Château. Ces faits sont à redécouvrir dans le
Mercure de Gaillon N°6 vont avoir des répercussions immédiates
sur le projet d’Harou-Romain. De Labouisse-Rochefort, à Chateaubriand tous les auteurs
initiés à ces mystères sous-entendent dans leurs écrits l’existence d’un
tombeau ou temple sacré dans le secteur deux Rennes. Nous y sommes. La détention d’un grand secret implique de grandes
responsabilités. Tous les
dépositaires de ce secret ont fait en sorte qu’il ne soit pas disponible, jusqu’au
jour où le maître des clefs le permettra. Alors, ce jour-là seulement les
portes du Temple s’ouvriront définitivement. Thierry Garnier © 08 août 2015 - M2G éditions. Toute reproduction interdite sans autorisation de l'auteur. [1] Poliade
signifie celle qui habite dans les villes,
ou la patrone d’une ville. [2] L’Enclopedie, 1751 T.XII p.904. [4]
Annales du musée et de l'école moderne des beaux-arts, 1834, p.34. [5]
Bulletin de l'Alliance des arts, par Paul Lacroix, n°1, juin 1842, p.43 et
Gazettes des Beaux-Arts, 1860, p.71. [6] Souscription pour un monument à élever à la gloire de
N. Poussin, Harou-Romain, Nicolas-Philippe,
1803, p.5. [7] Réunion des sociétés des beaux-arts des départements,
1903, 27e session, p.249. [8] Journal du département de l’Oise, 18 thermidor An VIII
(6 août 1800). [9] Cf. chevaux de Méduse. [10] Ibid. [11] Par la Nymphe Psyché représentée avec des ailes de
papillon. Celui-ci est une évocation de l’âme et par extension une voie vers
l’Initiation. [12]
Est emprunté (1730) au latin des botanistes papilionaceus « de papillon » (1689), dérivé du latin papilio (→ papillon) [13] Mercure de Gaillon n°6. | ||||||||||||||||||||||||||