Les tentations « des »
Teniers La primauté des Bergers d’Arcadie a souvent
mis en marge l’étude de la Tentation de St Antoine de D. Téniers. Maintes
fois reprises par divers auteurs en littérature et artistes en peinture,
« La Tentation » fut une scène religieuse affectionnée par le peintre
flamand, puisqu’il en pegnit plusieurs. Mais de quel David Téniers s’agit-il exactement?
Du père ou du fils, de Téniers le vieux ou Téniers le jeune,
lequel exécuta une Tentation de St Antoine codifiée dans le
cryptogramme du grand manuscrit de Bérenger Saunière? Bergère pas de tentation Que Poussin et Téniers gardent la clef !  Les auteurs, s’étant penchés sur le sujet, ont
souvent mis à l’écart Téniers le vieux considérant qu’il n’y avait
aucune « Tentation » à mettre à son actif. Or Léon Bocquet[1],
un des biographes des Téniers, n’est pas de cet avis. Il rapporte que le père
fut copié par le fils très souvent et notamment sur des thèmes religieux tel
que la Tentation de St Antoine[2] :
« Il (le fils) se conforme quant à lui aux formules de ses devanciers
assemblant dans la grotte de l’anachorète en prière les démons grotesques et
les monstres baroques. L’attirail diabolique des sabbats PATERNELS et de ses
sorcelleries est là au complet. Et le fils s’est répété avec un
sans-gêne… ». Ceci est la démonstration que David Téniers le
vieux réalisa un tableau de la Tentation de Saint-Antoine. L’œuvre du
maître est tombée dans les oubliettes de l’histoire et tous les chercheurs se
sont précipités sur le tableau de Teniers le jeune, exposé au Louvre. Cela ne
nous satisfait pas. Il manque des pièces au puzzle. Les deux peintres flamands étaient contemporains
de Nicolas POUSSIN. TENIERS le vieux l’était plus encore que son fils, car il
avait une dizaine d’années d’écart avec le Poussin. La logique ou la Tentation
nous pousserait à choisir David Téniers le vieux. Mais un argument vient
contrebalancer ce choix. Si le message du grand manuscrit désigne deux œuvres
exposées au Louvre, la première étant Les Bergers d’Arcadie de Poussin peint 1640, la seconde ne peut qu’être « La Tentation »
de David Teniers le jeune. Le problème n’est pas résolu pour autant, car au
Louvre, il existe au moins deux tableaux de D. Téniers, deuxième du nom, sur le
thème de la Tentation de St Antoine. Le premier est une huile sur bois de 50cm
sur 63cm entrée au musée en 1816. Le second est également une huile sur bois de
16cm sur 22cm acquise par le musée en 1869, suite à une donation par legs du
docteur Louis La Caze. Les deux peintures peuvent
être admirées au second étage de l’aile Richelieu, section 23.
Même si B. Saunière se procura des copies des
œuvres de Téniers et Poussin au Louvre vers 1891, en tout état de cause, l’abbé
Antoine Bigou ne peut être l’auteur des deux parchemins manuscrits connus,
retrouvés dans le pilier Wisigoth de l’église de Rennes-le-Château, quels qu’ils soient, grand ou petit. Décédé
le 21 mars 1794 en Espagne où il s’était réfugié, fuyant les troubles de la
Révolution française, comment aurai-il put être au fait des acquisitions
picturales de D. Téniers II par le musée du Louvre de 1816 et 1869 ? Quand
bien même Bigou aurait pu connaître ces tableaux, l'œuvre d’Eugène Delacroix,
l’Archange St Michel terrassant le dragon, placée dans la chapelle des Saint-Anges de l’église SAINT-SULPICE de Paris, fut
exécutée entre 1855 et 1861. Si elle doit être prise en compte dans le message, par
la Croix et ce Cheval de Dieu j’achève ce Daemon de gardien, les
documents présentés par le Prieuré de Sion (ASBL loi 1901 fondée en 1956), via
le canal Plantard, ont été obligatoirement écrits après 1861 et bien avant
1956. Nous avons déjà démontré tout cela en clouant au
pilori le montage grossier de Chérisey dans notre
étude du CODEX BEZAE (éd. de 1899). Nous y ajouterons un document, tout à fait
significatif, retrouvé dans les archives de l’écrivain Andelysien Brossard de Ruville. Nous développerons ce sujet plus loin. La datation des parchemins peu être effectuée
maintenant avec précision. De plus, le TOMBEAU DES PONTILS, copie conforme du
tombeau des Bergers d’Arcadie du Poussin ayant été bâtit vers 1902 et
servant de POINT DE REPERE, les parchemins ont été conçus fatalement à cette
époque (entre 1899 et 1902). Nous n’avons pas à chercher bien loin pour
retrouver les véritables auteurs des deux manuscrits: Boudet et Saunière.  Le fil conducteur de nos savants
« kabbalistes » suit les EVANGILES DE SAINT-LUC, de Mathieu et de
Saint-Jean. Les TENIERS furent membres de la GUILDE DE SAINT-LUC, la célèbre et
très puissante corporation de peintres et de sculpteurs d’Anvers. Rubens, Van
Dick, Bruegel, Vermeer parmi d’autres artistes peintres flamands, étaient
affiliés à cette confrérie. En 1632, DAVID TENIERS II y est reçu franc-maître et en 1644 il devient doyen, tandis qu’en 1631
NICOLAS POUSSIN entre à l’ACADEMIE DE SAINT-LUC de Rome, pendant italien de l’ordre flamand.
LEONARD DE VINCI était un éminent affidé de la Guilde de Saint-Luc
en 1472. POUSSIN pouvait-il en être ? Nous le croyons, sachant que la
marque de reconnaissance de la guilde Anversoise, une MAIN COUPEE, apparaît en
second plan sur son autoportrait [3]
de 1650 (ci-contre): les mains posées sur les épaules de la femme du maître signent
l’œuvre… et l’œil[4]
regardait Caïn… Il convient ici de ne pas omettre Maurice Leblanc,
notre guide. Dans l’Aguille creuse,
la MAIN MUTILEE de la veuve ROUSSELIN révulsera Arsène LUPIN. La tortionnaire,
Joséphine Balsamo, le sosie de la JOCONDE, en prendra pour son GRADE. La MAIN
de GLOIRE[5],
attribuée généralement au cambrioleur, sera cette fois peu glorieuse pour les
ravisseurs de la veuve ROUSSELIN. La MAIN COUPEE de
MAGUENOC, qui avait touché la Pierre-Dieu de l’Île
aux trente cercueils, nous rappellera combien les chemins de la
Connaissance sont perilleux. Nous venons de voir qu’une corporation d’artistes
« Initiés » européens, la GUILDE SAINT-LUC, probable paravent d'une Société Brumeuse, était étrangement mêlée à
l’affaire. Poussin et Téniers gardent la CLEF de la PIERRE CUBIQUE: l’un
dans un PARC et un TOMBEAU d’ARCADIE, l’autre dans un ERMITAGE et une GROTTE.
Ne pouvant déterminer avec certitude lequel des deux David Téniers est cité
dans le grand manuscrit, nous procéderons par déduction. L’ensemble des Tentations
de Saint Antoine, réalisées par le fils, étant copiées sur celle du père,
nous en conclurons provisoirement qu’il faut recentrer notre recherche autour
d’un ERMITAGE ou d’une CAVERNE remplie de chauve-souris, leitmotiv
dans l’illustration de DAVID TENIERS II, dans laquelle serait renfermé un
TOMBEAU… ou une ARCHE DE DIEU !
Brossard de Ruville est de ces écrivains régionaux du XIXème siècle dont on ne parle guère. Il nous a légué une œuvre
essentielle pour l’histoire des Andelys où naquit N. Poussin. Il affirme, dans son histoire des Andelys[6],
que le corps du peintre a été enlevé à la fin du XVIIIème
siècle[7].
Il étaye ses assertions sur les commentaires de plusieurs auteurs du XVIIIème siècle. Charles de Brosses[8],
visitant la tombe du Poussin à Rome en 1740, put relever l’inscription[9]
que Bellori avait fait graver en l’honneur de N.
POUSSIN vers 1666. Le tombeau était encore visible en 1740. Mais en
1779, Seroux d’Agincourt[10]
cherchant la dalle et l’épitaphe ne les trouva pas. La tombe avait disparu. Il
s’informa sans succès de la place où le corps de N. Poussin avait été enterré.
Une autre épitaphe (ci-contre), composée par un abbé qui ne nous est pas inconnu, se trouvait à Rome à l'époque du décès du Poussin. Ce religieux n'est autre que l'abbé Nicaise, très bon ami du maître, que l'on voit apparaître à Gaillon dans une assemblée R+C. Divers documents, dont plusieurs lettres entre l'abbé Nicaise et Poussin, prouvent ces liens étroits[10b]. Même si l'abbé n'était pas à l'enterrement du Poussin, ça ne contrarie en rien une dédicace posthume. On se fourvoierait s'il fallait suivre les affirmes produites dans "les Archives de l'Art Français"[10c] , selon lesquelles l'abbé n'était pas l'ami de notre peintre. C'est une erreur, les recherches plus récentes démontrent que les deux hommes se connaissaient très bien.
Maurice Leblanc cite souvent en référence CHATEAUBRIAND
dans l’Aiguille creuse, l’île aux trente cercueils ou le bouchon de
cristal. Rien n’est écrit innocemment chez M. Leblanc et Chateaubriand,
initié aux loges maçonniques «Vraie et Parfaite Harmonie» et «Candeur»
de Paris[11],
fit d’une PIERRE TOMBALE deux coups. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Si B.
de Ruville nous apprend que le corps de Poussin a
disparu de Rome, la lecture de ses archives[12]
est, de loin, encore plus éloquente. Elles nous révèlent indirectement et nous
amènent à comprendre la cabale montée de toute pièce par le pseudo
« antique » Prieuré de Sion dès la fin des années 1950. Dans une liasse, conservée aux Archives Départementales de
l’Eure, nous avons déniché un document exceptionnel prouvant au moins que
P. de Chérisey pouvait avoir un intérêt direct dans
l’affaire; un intérêt particulier ne datant pas d’hier. En faisant notre
recherche sur Nicolas Poussin, nous avons retrouvé un faire-part de décès au
nom de Victoire Marie Marguerite de Fontanges, Marquise d’Hantecourt,datant de 1882. C’est dans cet acte qu’à notre plus grande stupéfaction nous avons vu mentionné le nom de la famille DE CHERISEY: Vicomtes, Comtes et
Marquis... Quels liens les Fontanges entretenaient-ils avec
de Ruville, écrivain andelysien et admirateur de N.
POUSSIN? Les Fontanges, famille alliée aux de Chérisey,
sont notifiés dans la liste des souscripteurs du livre de Brossard de Ruville. Nous y verrons aussi les noms de Msg de BONNECHOSE et la famille de SAINT-CLAIR, lignage
dont se réclamait P. Plantard. Cette pièce à conviction nous éclaire pleinement
sur la manière de procéder de P. de Chérisey pour
discréditer et nier l’importance des parchemins de B. Saunière afin d’écarter
tous les curieux. Nicolas
Poussin ou la clef de l’Arcadie
La relation du grand maître classique français
avec les Secrets du Razès est connue de tous. En effet les différentes
recherches axées sur les BERGERS D’ARCADIE, scène Angélique, s’accordent sur ce point. Le message
décrypté dans le grand parchemin issu du CODEX BEZAE CANTABRIGIENSIS de
1899 ne laisse planer aucun doute : BERGERE PAS DE TENTATION QUE POUSSIN TENIERS GARDENT
LA CLEF PAXDCLXXXI (681) PAR LA CROIX ET CE CHEVAL DE DIEU J'ACHEVE CE DAEMON DE GARDIEN A MIDI POMMES BLEUES J. Peladan, le Sar, avait en son temps, et dès la fondation de son Ordre Rose+Croix, prit toute la mesure de l'œuvre de Nicolas Poussin. Dans sa règle il avait spécifié, à l'article IV des sujets honnis dans la peinture : "tout paysage sauf celui à la Poussin"(ci-dessous). Notre peintre Andelysiens ne laissait donc pas les R+C indifférents. Mais au-delà de ce tableau énigmatique, NICOLAS
POUSSIN a laissé d’autres preuves de son savoir. La plus connue est une lettre
de l’abbé LOUIS FOUQUET adressée à son frère Nicolas, surintendant des finances
de Louis XIV. Dans cette missive, datée du 17 avril
1656, il l’entretient d’un étrange échange avec le peintre: «Rome, le 17
avril 1656 J’ai rendu à
monsieur Poussin la lettre que vous luy faites
l’honneur de lui escrire; il en a témoigné toute sa
joie imaginable. Vous ne sauriez croire, monsieur, ni les peines qu’il prend
pour votre service, ni l’affection avec laquelle il les prend, ni le mérite et
la probité qu’il apporte en toutes choses. Luy et moi
nous avons projeté certaines choses dont je pourrais vous entretenir à fond
dans peu, qui vous donneront par monsieur Poussin des avantages que les roys auraient grand peine à tirer de lui et qu’après lui
peut-être personne au monde ne recouvrera dans les siècles advenir; et, ce que
qui plus est cela serait sans beaucoup de dépenses et pourrait même tourner à
profit et ce sont choses si fort à rechercher que quoi que ce soit sur la terre
maintenant ne peut avoir une meilleure fortune ni peut être égale .» Nous pouvons donc déduire que Poussin
détenait bien un secret d’une telle
importance qu’il le place au-dessus de tout. Il aurait pu le partager avec
Fouquet. Ce secret pourrait être lié à un site archéologique. Poussin pense
qu’après sa mort le secret risque d’être perdu. Mais d’où tenait-il ce fabuleux
secret ? Jacques Thuillier, dans son ouvrage[13]
consacré à Poussin, indique dans ses notes: «Ce projet mystérieux et
grandiose pose une énigme. A quelle entreprise merveilleuse pouvaient bien
rêver le vieux peintre et le jeune abbé, esprit vif mais tête pratique, et peu
susceptible d’enthousiasme inconsidéré? Quelque grande publication? On
comprendrait mal un tel engouement. Montaiglon a
avancé l’hypothèse de grandes fouilles archéologiques, en quelque point de Rome
ou du Tibre. Elles sont en effet fort plausibles. Peut-être même Poussin,
attentif à la moindre découverte et par le rôle d’intermédiaire qu’il exerçait
parfois, en relations plus ou moins suive avec de fouilleurs clandestins,
avait-il repéré un site exceptionnel, dont il détenait le secret: ce qui
expliquerait les termes si curieux dont se sert l’abbé». S’il ne voulut le perdre, il le dissimula alors
très probablement dans ses toiles. Bellori, ami et
hagiographe de Poussin, nous le confirme en rapportant cette indication dans
son premier épigraphe[14]
de 1666 sur le tombeau du Poussin: Il est permis de l’entendre parler Il est étonnant,
par ses tableaux il
vit et s’exprime. Et c’est plus particulièrement dans Les bergers d’Arcadie qu’il se manifeste: Et In Arcadia
Ego, puisque l’anagramme qui en
ressort, I TEGO ARCANA DEI, se
traduit par: Je garde le secret de Dieu (des dieux) ou je connaît les
arcanes de Dieu. Il a pu également
l’exprimer dans d’autres tableaux et rien ne peut confirmer que Rome soit
vraiment le site par défaut, ni Rennes-le-Château d’ailleurs. Un autre frère du surintendant, FRANCOIS FOUQUET,
s’immisce subrepticement dans l’affaire. Il devint archevêque de NARBONNE en
1659, soit trois ans après la lettre de Louis. Après la chute de son frère
Nicolas, en septembre 1661, F. Fouquet fut
envoyé en résidence surveillée en Normandie. Il arriva à Alençon le 13
septembre 1666. Il préserva cependant la charge de l’archevêché de Narbonne.
Colbert assigna l’évêque de Sées, FRANCOIS ROUXEL DE MEDAVY, futur archevêque
de Rouen, à sa garde. L’évêque de Sées ne voyait pas l’arrivée de cet « hôte » d’un très bon œil. François
Fouquet, à l’époque où il était encore libre de ses mouvements, fut à l'origine
des projets finalement réalisés en 1873 par Msg F.A. Billard, évêque de Carcassonne, pour l’occupation par
les lazaristes de N. D. de Marceille[15]
près de Limoux. Cet ordre fut fondé en 1625 par Vincent de Paul. Il nous
apparaît, au travers de cette simultanéité de faits distincts, que tout cela n’est pas
anodin puisque dans les années 1615-1616 Vincent de Paul était trésorier de la
collégiale d’ECOUIS[16],
village de l’Eure situé à un dizaine de kilomètres des Andelys où vivait à la
même époque NICOLAS POUSSIN qui, beaucoup plus tard, aura NICOLAS FOUQUET,
frère de François, dans ses plus proches relations. N. Poussin
était un élève assidu dans l’école du peintre Noël Jouvenet à Rouen quand Msg FRANCOIS DE JOYEUSE[17],
possédant la baronnie d’ARQUES, était archevêque de Rouen. Vincent de Paul, N.
Poussin et F. de Joyeuse se sont donc croisés, s'ils ne se sont côtoyés, entre
1615 et 1616 en Normandie. Quelles coïncidences ! Toute la source des
secrets ancestraux détenus par NICOLAS POUSSIN, un des piliers du
« mythe » Rhedaesien, semble être là en
Normandie. On ne sait si le talentueux
Nicolas Poussin rentra en rapport avec François de Joyeuse. Cependant nous
pouvons supposer qu’il eut connaissance de certaines révélations vers 1615 et
entreprit de les dissimuler dans certaines de ses œuvres. Une supposition
corroborée par un document écrit de THOMAS CORNEILLE. Frère de Pierre, il vécut
une grande partie de sa vie aux Andelys. Il s’y maria en 1650. Thomas écrit
dans son Dictionnaire universel, géographique et historique[18],
que le départ de POUSSIN des Andelys fut précipité pour «une affaire qui lui survint et lui ayant fait craindre quelques
poursuites qui l’auraient embarrassé; il quitta son pays et vint à Paris»[19]. Vers 1618, il arriva dans la
capitale, puis il en partit pour Rome vers 1620/21, se sentant peut-être plus
libre de ses mouvements. 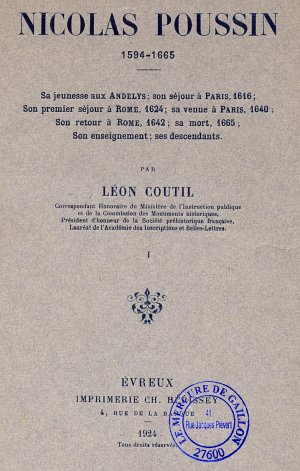
Quelle était donc la nature
de ces charges que N. POUSSIN redoutait ? Léon Coutil[20] était
également originaire du petit village de Villers. Ses ancêtres, voisins des
POUSSIN, eurent en leur possession des titres de propriétés de cette famille et
de celle de Thomas CORNEILLE. Aussi déclare t’il: «Malheureusement, trop de fantaisies s’y trouvent mentionnées et nous
préférons ne pas les relever» [21].
L’étrange comportement de
cet historien intriguerait le plus retord des rationalistes. Des fantaisies
inavouables, des poursuites qui mettent en péril la vie de notre Poussin
national. Qu’est-ce qui le poussa à fuir la Normandie dès 1618? Quelle était la
teneur des informations détenues par N. POUSSIN ? Etait-ce le secret qu’il
devait confier 38 ans plus tard à Louis Fouquet ? Nous sommes dès à
présent sur la piste des archives de L. Coutil. Nous espérons prochainement
aboutir et dévoiler enfin cette vérité qui dérange. Le SECRET de POUSSIN serait
donc né dans l’archevêché de Rouen entre 1614 et 1618. Une époque et une région
où notre peintre à la curieuse occasion de croiser le chemin du Cardinal François DE JOYEUSE, baron
d’ARQUES, seigneur du CHATEAU DE GAILLON dont le parc révèle UNE CLEF ARCADIENNE, et SAINT VINCENT DE PAUL, ancien pensionnaire de Notre Dame de Marceille dit-on, chanoine trésorier de la collégiale d’ECOUIS[22] de 1615 à
1645, vicaire
général de l’abbaye Saint-Ouen de Rouen de 1643 à 1653 et sympathisant de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice de
Jean-Jacques Olier.
Th. Garnier Remerciements particuliers à : A-M Lecordier Mis à jour le 15.11.09 [1] David Téniers,
par Léon Bocquet, Ed. Nilsson, Paris, 1924. [2] Op. Cit, p.99. [3] Peint pour Paul
Fréart de Chanteloup,
H.98xL.74cm, le Louvre. [4] Du diadème. [5] La Main de la
Gloire était une main coupée et desséchée provenant d'un pendu. Son nom dérive
de mandaglore, qui dérive lui-même de mandragore. Cet
article faisait partie des artefacts de la magie noire. Elle avait la propriété
d'éclairer dans l'obscurité uniquement celui qui la portait. La Main de la
Gloire était très prisée chez les cambrioleurs, car on lui prêtait des pouvoirs
hypnotiques. La tradition affirme que si le pouce de la Main ne s'allumait pas,
c'est que l'une des personnes visées par le sort dénoncerait le voleur! [6] Histoire de la
ville des Andelis et de ses dépendances, Brossard de Ruville, Les Andelys, Delcroix,
1863-1864, vol.2 [7]Op. Cit, p.430 et
Nicolas Poussin, 1594-1665, Léon Coutil,
1924, p.54. [8] Lettres
historiques et critiques sur l’Italie, Charles de Brosse, Paris, An VII, T.2,
p.310. [9] Op. Cit, de Ruville, p.426 et 427. [10] Lettre à M.
Castellan, décembre 1813, Seroux d’Agincourt, Archives de l’art français T.1, 1852, p.145. [10b] Bulletin de la Société Poussin n°1, Poussin et son temps, collectif, juin 1947. Lettre à consuler dans le FANUM II. [10c] Archives de l'art français, T.1, A. de Montaiglon, 1852, p.20. [11] Histoire abrégée de la Franc-Maçonnerie,
Robert Freke Gould, J. Lebègue,
Bruxelles, 1910. [12] Archives
départementales de l’Eure. [13] Nicolas Poussin, par Jacques Thuillier, Ed Flammarion, 1994. [14] Op.Cit, Brossard de Ruville, vol.2, p.426 et 427. [15] Dossier Rennes Le Château N°5 p.20, André
Douzet, Société Perillos, 2003. [16] Saint Vincent de Paul en Normandie, Extrait
d’un mémoire lu au congrès des Sociétés Savantes, à la Sorbonne en 1889, Imp.
E. Vauclin, 1890. [17] Famille possédant la baronnie d’Arques et
le moulin de Pontils où le célèbre tombeau fut édifié vers 1902. [18] T.1 - 1708, p.17. [19] Nicolas Poussin, 1594-1665,. L. Coutil, 1924, p.6. [20] Correspondant honoraire du ministère de
l’instruction publique et de la Commission des monuments historiques, président
d’honneur de la Société préhistorique française, lauréat de l’Académie des
Inscriptions et Belles Lettres en
1924. [21] Notice de 2 pages : Les dernières
oeuvres de N. Poussin au Musée des Andelys, L. Coutil, sans date. Consuler le document dans le FANUM II. |


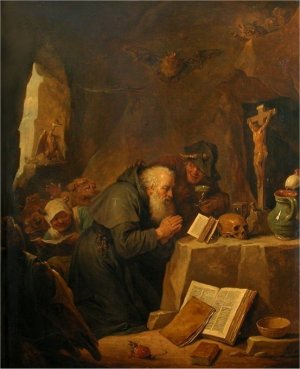
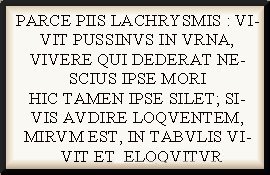
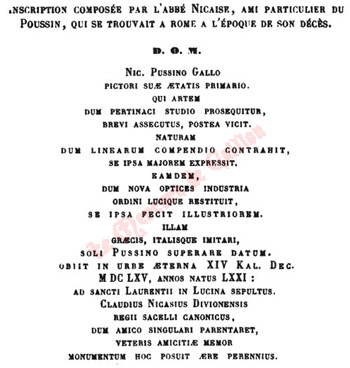
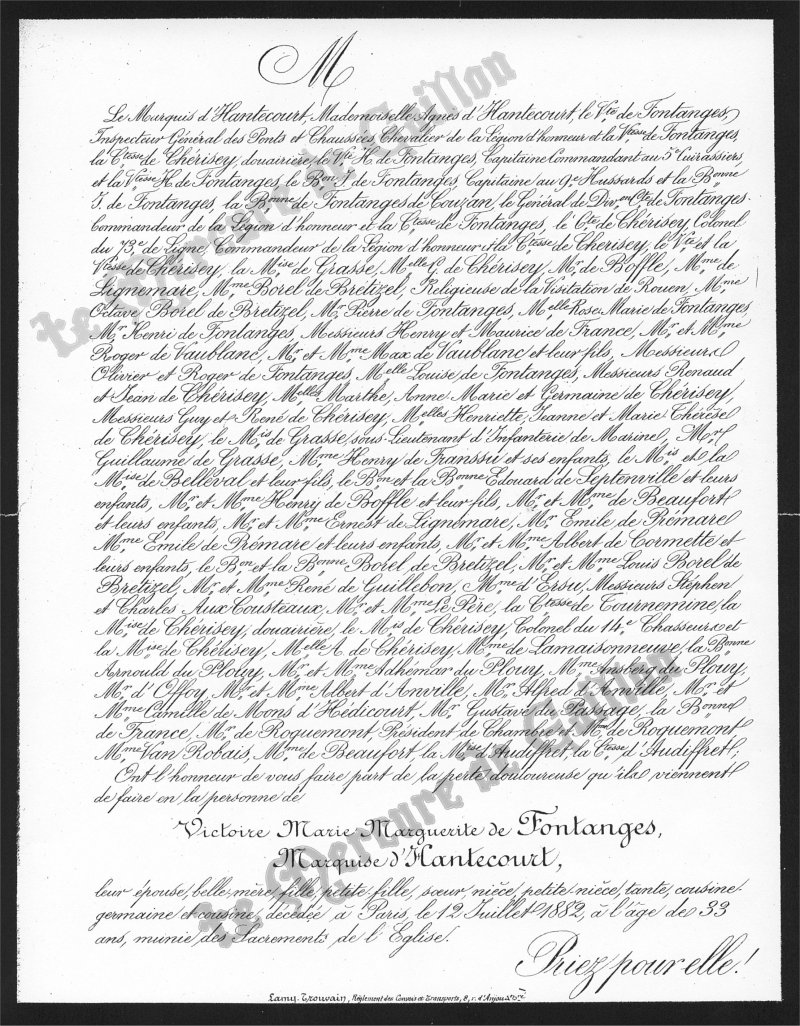


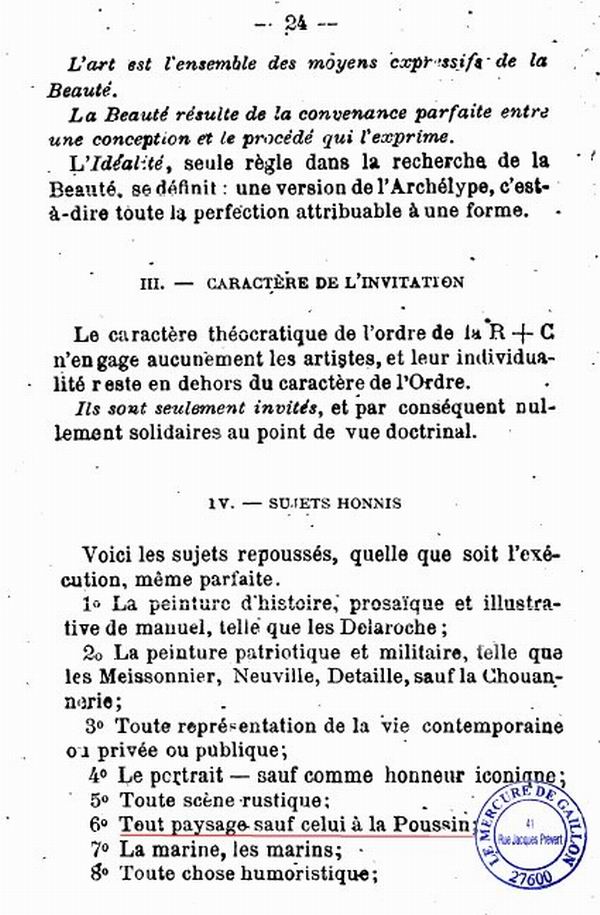
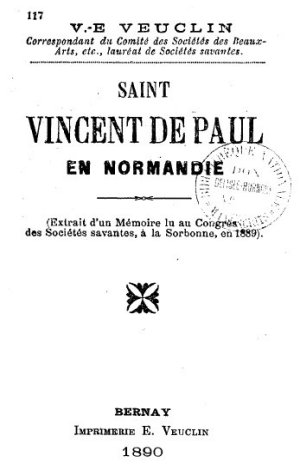 Le chercheur
un peu curieux découvrira, dans ce sanctuaire, une statue de SAINT VINCENT DE
PAUL. Le saint homme aurait séjourné en ce lieu vers 1605. Y aurait-il encore
corrélation ?
Le chercheur
un peu curieux découvrira, dans ce sanctuaire, une statue de SAINT VINCENT DE
PAUL. Le saint homme aurait séjourné en ce lieu vers 1605. Y aurait-il encore
corrélation ? 
