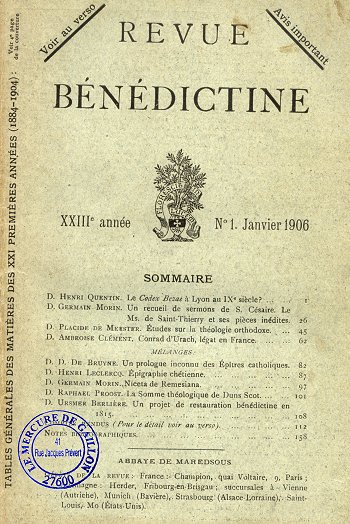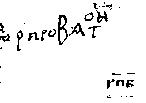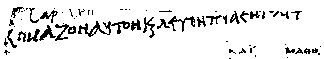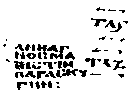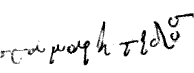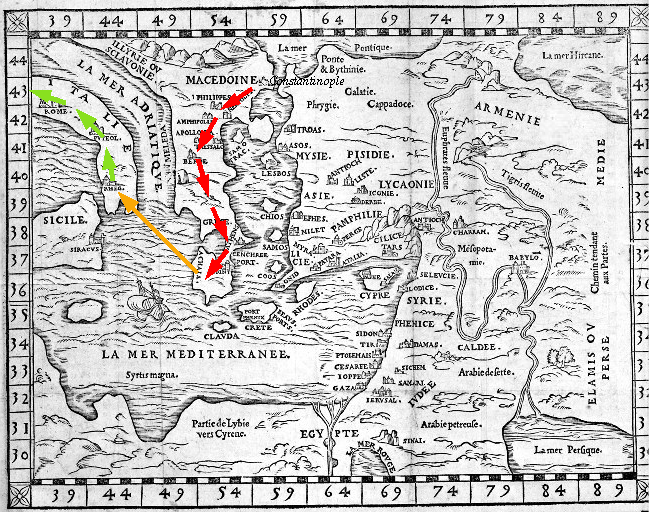Une grande partie du matériel utilisé pour sa
rédaction au Ve siècle proviendrait des textes écrits par la secte montaniste,
mouvement chrétien fondé par Montanus, déclaré hérétique vers 177 ap. J.-C. Montanus est né à Ardabau, un village de Phrygie,
Turquie d’aujourd’hui. Ancien prêtre du culte de Cybèle converti au
christianisme, il fut un chrétien de type charismatique. La doctrine des montanistes était à la fois des plus
progressistes et outrancièrement rigoriste. Elle laissait de la place aux
femmes dans l’Ordre[1] à l’égal des hommes. Sur
ce plan, Montanus se rapprochait de l’esprit des Evangiles Gnostiques
découverts en 1945 dans le désert Egyptien[2] à Nag
Hammadi. Condamnant quiconque contractait un second mariage,
les dogmes montanismes n’interdisaient pas le mariage des prêtres[4]. Par
opposition, la secte prônait un ascétisme le plus strict. Montanus propagea un
christianisme nommé par ses contemporains hérésie phrygienne, hérésie
cataphrygienne ou encore hérésie pépusienne. La plupart des érudits avaient considéré le montanisme
en bloc. Ils ne paraissaient pas se douter que la secte avait pu évoluer. Elle
avait pourtant conservé des adeptes enthousiastes pendant plusieurs siècles,
depuis le temps des derniers Antonins[5] jusqu’au début du Moyen Age[6] et
l’apogée de l’ordre des Fidèles d’Amour d’Occident. Fidèles d’Amour
qui inspirèrent les sociétés philosophiques émergeant aux XVIe et XVIIe
siècles telles que la Rose-Croix,
la Société Angélique et la dérive
des Illuminés de Bavière en Europe ou en Amérique du Nord jusqu’à la
pâle copie du Prieuré de Sion moderne. Nous ne nous étendrons pas
davantage sur cette filiation. Nous l’avons déjà publiée et commentée
abondamment dans Mémoires des deux Cités, tome II, en novembre 2005. La tradition concède le mérite à saint Irénée pour avoir
apporté les textes apocryphes du Codex à Lyon. Déclaré hérétique par les pères
de l’Eglise chrétienne du IIIe siècle, la secte montaniste, soutenue
par le saint lyonnais, avait pu subsister secrètement, dans le Saint-Empire romain
d’Orient, en conservant presque tous ses écrits[7]. Mais
aucun élément probant n’a jamais été mis en exergue pour conforter l’hypothèse
d’un transfert à Lyon d’un quelconque manuscrit. Des auteurs se sont perdus en
conjectures faisant de Montanus un auteur de livres sibyllins, voire
même un magicien. Les documents historiques montanistes, en latin, grec
et syriaque, subsistants montrent combien les esprits du début du premier
millénaire se passionnèrent pour le nouvel évangile de Montanus, appelé Nouvelle
Prophétie, provenant non plus des montagnes de Judée mais de celles de
Phrygie, prêché non par Jésus et ses apôtres mais par les partisans de la
secte. Ils tombèrent vite sous le coup de l’hérésie. L’Eglise ne traita pas
leurs écrits comme elle aurait pu le faire pour d’autres hérétiques. Pris sous
cet angle, on peut supposer que les écrits montanistes ont servi à la
composition du CODEX BEZAE au Ve ou VIe siècle. Cela
signifie, de fait, que le premier manuscrit fut rédigé après le sac de Rome
commis en 410 par Alaric Ier, roi des Wisigoths... Quoi qu’il en soit, le manuscrit passa par l'atelier
de calligraphie Florus qui exerçait à Lyon au IXe siècle. Quelques
pages du manuscrit devaient y être réécrites. Le Codex temporairement
appelé Claromontanus fut conservé dans le monastère Saint-Irénée de Lyon
jusqu’au milieu du XVIe siècle. Le Martyrologue d’Adon, contenant
dans le texte les traces du futur Codex Bezae, fut écrit en ce lieu. Le saint
évêque de Vienne déclare lui-même avoir employé l’œuvre reproduite par Florus
en 859 (ou 860). Nos toutes dernières découvertes documentaires
confirment ces faits. Mais saint Irénée fut-il le seul intermédiaire,
dépositaire d’un texte sacré... ou d’un sacré texte ? Un article, paru
dans la Revue Bénédictine du 1er janvier 1906, titré le Codex
Bezae à Lyon[8]
apporte enfin les réponses aux nombreuses questions qui restaient en suspens.
Il fallait simplement le trouver. Il comble ainsi la brèche historique
s’étalant du IIe au IXe
siècle. L’auteur, Henri Quentin, situe le manuscrit dans le sud de l’Italie[9] à
cette époque. Il suppose, sans toutefois en apporter une preuve formelle, qu’il
aurait pu y demeurer jusqu’au XIIe siècle. Les raisons mises en
avant, pour établir le fait du séjour dans cette contrée jusqu’au IXe
siècle, sont liées au calendrier de liturgie et à la phonétique des annotations
du codex. La délimitation chronologique proposée s’appuie principalement sur
les caractères paléographiques des notes. Mais tous les commentateurs du Codex
de Bèze ne sont pas d’accord sur leur datation : en 1864, Scrivener les
plaçait au IXe siècle ; en 1896, Kenyon (comme Kipling en 1793)
leur assignait le VIIe ; puis finalement en 1902, Burkitt[10]
proposait de les vieillir encore plus, allant vers le XIIe siècle.
Les jugements sur ces points ne sont donc absolument pas définitifs.
En 1895, F. Vigouroux répondait lui aussi à quelques
interrogations dans son dictionnaire. Il certifiait l’adjonction des césures
(crochets) aux sections ammoniennes vers le IXe et des annotations
grecques, en marge, beaucoup plus récentes sans en avoir une profonde
conviction. Les copistes (et correcteurs) de l’atelier Florus de Lyon pourraient être les
auteurs de certaines de ces indications fondamentales, à la fois corrections et
signes de cryptages, si ce n’est saint Adon.
Les différentes éditions de son martyrologue
sont, d’ailleurs, assez défectueuses. Ses dérivés du Codex ont parfois été
supplantés par des ajouts intempestifs. Les copistes du Moyen Age et de la Renaissance
étaient souvent enclins à rendre les citations du manuscrit de Bèze conformes
aux textes utilisés pour la Vulgate. Les tentatives sont restées isolées sans
altérer les leçons du Codex incluses dans le martyrologue, mais on comprend
mieux pourquoi le grand parchemin écrit et crypté par Henri Boudet et
Bérenger Saunière contient autant de similitudes rapprochant le Codex Bezae
et la Vulgate dans sa conception. A supposer maintenant que Florus fut l’auteur des
annotations, voire du martyrologue attribué à Adon, la chose n’est
absolument pas impossible. Comme le souligne H. Quentin, le témoignage de Wandelbert,
sur sa richesse en livres authentiques et la lettre que Florus écrivit à l’abbé
Hyldrade de Novalèse, à qui il renvoie son psautier revu et corrigé, nous
persuadera vite que cet homme était parfaitement préparé à ce genre de travail.
Quentin nous informe également que Florus était en relation avec l’Italie. Un
curieux passage de son traité Adversus Johannem Scotum prouve qu’il
connaissait le texte grec du livre des Actes des apôtres[11].
Après avoir été écrit et codé (lettres décalées) par delà le règne de
l’empereur Anastase Ier (518 ap. J.-C.), le Codex quitta
Constantinople au VIe siècle. Son voyage se poursuit à travers
l’Europe du sud en passant par la Grèce où il séjourna probablement jusqu’à la
fin du VIIe siècle et serait arrivé en Italie au VIIIe
siècle puis enfin à Lyon. Si l’on admet, tout à la fois, que le Codex Bezae
séjourna d’abord en Italie puis fut ramené à Lyon au IXe siècle,
Florus aurait eu tout loisir de le faire émigrer par un de ses correspondants
italiens. Dans ce cas, les annotations grecques auraient des chances d’avoir été
réalisées à la fin du VIIIe siècle en Italie (ou dans les ateliers de
Florus au IXe siècle). Cela pourrait expliquer pourquoi il n’y en a pas de trace dans les feuillets additionnels de l’Évangile de Jean ajoutés par la suite à partir du
folio 150 (Jean 18 2 à 18 13) jusqu’au folio 156 (Jean 20 1 à 20 13). Les scribes ne se sont même pas donné la peine de
respecter le décalage des paragraphes en marge de gauche. Nous pouvons en
déduire par là que certains folios, uniques,
détiennent les clefs du secret. Ils n’ont pas tous de l’intérêt. Nous l’avons
vérifié en appliquant le système de décryptage à des feuillets quelconques,
sans résultat. Il faudra comprendre également que non seulement Florus mais
aussi les autres copistes du manuscrit, et les grands convoyeurs inconnus
jusqu’à Lyon, étaient dans le secret du cryptage de l’énigme du Razès dont
Rennes-le-Château, Redhae (ou Redae), était une place forte Wisigothe dès le Ve
siècle. Henri Quentin, qu’on ne pourra soupçonner d’être de
notre côté en 1906, affirmera dans sa conclusion : « Les leçons du
Codex Bezae sont d’un particularisme extrême ». Nous ne saurions dire
mieux. L’enquête se poursuit donc, sachant dorénavant que les annotations et
lettres décalées des feuillets 132 (grec, ci-dessus à gauche) et 186 (latin, ci-dessus à droite), sources épistolaires
du grand et du petit parchemin de Bérenger Saunière, n’ont pu être
retranscrites au delà du IXe siècle quel que soit le lieu du dépôt
du manuscrit, en France ou en Italie.
Liens: - En savoir plus sur les Evangiles Gnostiques. livre en librairie: Arcana Codex, Livre II: Du DA VINCI CODE au CODEX BEZAE, par Thierry Garnier, collection VERITES SECRETES n°5, M2G éditions, 2006, 174 pages. [1] Trevett,
Montanism, Oxford 1996. [2] Les Évangiles
gnostiques ont été écrits en langage copte sur des papyrus aux alentours du IIe
siècle. [3] Mémoires des
deux cités, TII, Th. Garnier, Ed. M2G, 2005, p.264. [4] Revue des
questions historiques, 1902, p.81. [5] Cf. Empereurs romains. [6] Journal des
savants, Paul Monceaux, p.509, 1915; article critique sur « la crise
montaniste » de P. de Labriolle, Paris Ernest Leroux, 1913. [7] Revue
d’histoire et de littérature religieuse, 1915, p.494. [8] Revue
Bénédictine du 1er janvier 1906, H. Quentin, XXIIIe
année, abbaye de Maredsous, Belgique. Site internet :
http://www.maredsous.be/ [9] L’origine
Italienne du Codex Bezae, F.E Brightman et K. Lake, Journal de théologie, avril
1900, p.441. [10] The Date of
Codex Bezae, F.C. Burkitt, Journal de théologie, III, juillet 1902, p.501-513. [11] Op. cit. H.
Quentin, p.23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||