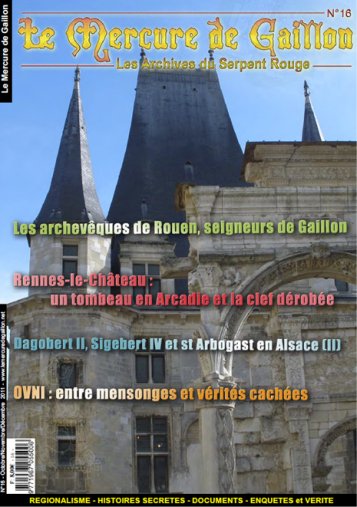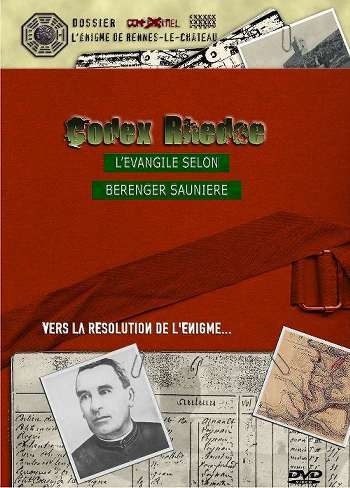|
|
Les Pontils, un Tombeau en Arcadie |

Nos
plus récents travaux révèlent que le livret Pierres gravées du
Languedoc fut réalisé entre 1903 et 1905 sous la férule de Bérenger
Saunière, aidé en cela par Emile Stüblein, frère d’Eugène. On peut ne pas être
d’accord, retourner le problème dans tous les sens, mais les faits sont
indéniables, la signature du livret a de flagrantes ressemblances avec celle
d’Emile Stüblein. Bérenger
aura eu manifestement l’intention de l’imiter, si ce n’est Emile qui a lui-même
signé les planches. Les signatures sont si aléatoires[1]
que nous pouvons nous poser cette question. Telles
sont nos conclusions, déduites après analyse de documents indiscutables.
Les planches épigraphiques
n°16 et n°17 proviennent du livre de Julien Sacaze[2] (ci-contre),
la planche n°18 et celles où sont dessinées la tête dite de Dagogert II (pl. XIX,
XX), la stèle et la pierre tombale de Marie de Négri d’Ables (pl. XXI, XXII)
ainsi que la dalle des chevaliers (pl. XXIII), seul monument lapidaire incontestable
dans son intégralité, sont des créations
de B. Saunière et d’Emile Stüblein.
Un
des rares documents légitimant la stèle est le rapport d’excursion à
Rennes-le-Château de la Société des Etudes Scientifiques de l’Aude (S.E.S.A) du
25 juin 1905. Cependant, nous avons acquis la certitude que la représentation
de la stèle de la dame de Blanchefort publiée dans l’opuscule a été fournie par
B. Saunière.
En effet,
dans le texte de la S.E.S.A, à aucun moment E. Tisseyre ne fait allusion
à un relevé manuscrit du texte de la stèle. La description du passage dans le
cimetière est des plus laconiques : « Une visite au cimetière
nous fait découvrir dans un coin une large dalle, brisée dans son centre, où on
peut lire une inscription gravée très grossièrement. Cette dalle mesure 1m30
sur 0m65 ».
La
précision est une constante dans toute étude scientifique. Une simple phrase
aurait suffi à dissiper tout malentendu quant à l’origine du croquis de stèle
reproduit dans le rapport de la S.E.S.A. L’image de la stèle aurait pu être
dessinée à l’identique, fendue en son milieu, pour l’authentifier. Dans le même
temps, E. Tisseyre écarte de son exposé
la dalle « et in arcadia ego »
beaucoup plus originale que la stèle, puisque inspirée par N. Poussin. Nous
sommes bien sur une pierre d’achoppement (même deux) dans tous les sens du
terme. 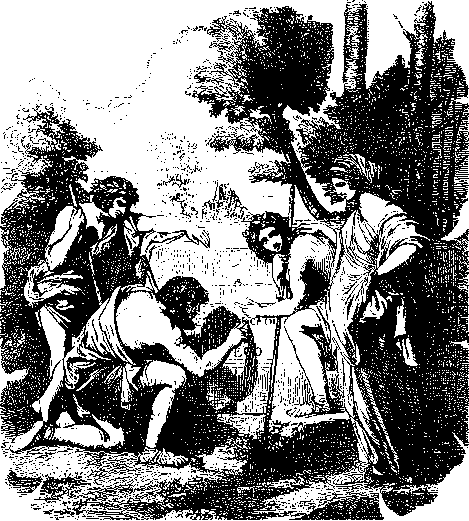 S’il n’en fait pas mention dans son récit c’est qu’elle n’existait tout
simplement pas dans le cimetière de Rennes-le-Château en 1905.
S’il n’en fait pas mention dans son récit c’est qu’elle n’existait tout
simplement pas dans le cimetière de Rennes-le-Château en 1905.
Nous
maintenons donc l’idée selon laquelle B. Saunière a fourni à E. Tisseyre,
rapporteur de la S.E.S.A, une reproduction codée de la stèle pour la
publication de son bulletin dédié à la postérité et crypté l’image de la dalle
funéraire attribuée à la dame d’Hautpoul. Dans le sillage d’Emile Stüblein,
l’abbé Saunière, aura signé les gravures pour Pierres gravées du Languedoc.
Rien
ne stipule une relation directe entre l’abbé Saunière et E. Tisseyre en juin
1905, contrairement à la visite de M. Fages en
août 1908. Néanmoins, il est fort peu
probable que les excursionnistes se permettent de visiter le jardin de l’église
et le cimetière sans que le curé du village n’en soit informé.
Quel
plan extraordinaire, si ce n’est un scénario purement imaginaire, de restaurer
une église, de modeler de main de maître un jardin magnifique, d’élaborer des
parchemins et des documents ramenant aux sources du fabuleux mystère de sa fortune.
Une manne documentaire qui servira à P. Plantard et Ph. de Chérisey pour
créer leur propre vision de l’histoire.

Selon Franck Marie, citant l’abbé Mazières, la pierre tombale de Marie de Nègri d’Ables aurait été une dalle de réemploi provenant du tènement où sera
construit plus tard le tombeau dit « des Pontils »[3].
L’ancien cadastre napoléonien (ci-contre) mentionne, d'ailleurs, un cimetière ayant existé
autrefois dans le secteur des Pontils. Avant la Révolution, ce fief a appartenu à la famille de Joyeuse, dont l'importance et l'influence ne sont pas à remettre en question, tant dans le Languedoc qu'en Normandie.
La
dalle aurait servi de point de repère à B. Saunière pour faire édifier le tombeau
de Poussin et la sentence et
in arcadia ego - une clef de décodage épigraphique existant depuis déjà très longtemps - façonnée
pour le document Pierres gravées du Languedoc par Emile Stüblein et
l’abbé.
D’ailleurs,
il fera en sorte que M. Galibert, propriétaire aux Pontils près d’Arques,
édifie en 1902 ce tombeau en s’inspirant du tableau de Nicolas Poussin : avant
dernier acte d’un plan mis en œuvre en 1898 sous la bienveillance de maître
Paul roche, notaire à Arques, et
père de Déodat.
Vingt
ans plus tard la propriété des Galibert fut mise en vente et rachetée par Mme Emilien
Rivares. Son fils, Louis Bertram Lawrence, né à Hartford
(Connecticut - USA) en 1884, hérita de tous les biens de la famille après sa
mort. Les motifs du retour de la famille en France sont inconnus.
Quant
à son père, dont on ne connaît que le nom de famille, Lawrence, c’était un
hollandais émigré aux Etats-Unis. Qui était-il vraiment ? Cela tient
encore du mystère. Nous développerons un début de réponse autour d’un certain Thomas
Gardner Lawrence affilié à l’ordre noir Skull & Bones en 1884.
Les dates coïncident; ce Thomas Gardner pouvait être le père de Louis Bertram.
Connaissant déjà les complicités sous-jacentes du mouvement extrémiste américain
dans cette affaire, notre attention se focalise dans cette direction.
 |
Cliquez sur la photo pour lire l'article, "Lawrence d'Arabie aux Andelys" dans le FANUM II (Dossier N. Poussin) |
La
prose de l’abbé Delmas, auteur du manuscrit de 1709, a aussi soulevé quelques
questions sur ce tombeau des Pontils. En effet, on lit à la page 3 de
l’apocryphe le Cercle d’Ulysse[5] : « Ce
tombeau… cité dans un ouvrage du XVIIe siècle de l’abbé Delmas ».
Hélas, le manuscrit du brave curé décrit seulement des monuments funéraires, appelés
cippes. Archéologiquement parlant, un cippe peut également être une borne de
propriété. L’abbé évoque encore un tombeau attribué au grand Pompée à
Rennes-les-Bains. L’amalgame fait dans le Cercle d’Ulysse est un
mensonge de plus du Prieuré de Sion qui vient d’être effacé.
Les Saunière étaient très implantés autour de
Rennes-le-Château. Des membres de la famille demeuraient à Arques. Le curé y
avait-il quelques possessions personnelles? Diverses correspondances
échangées avec Paul roche relatent
une situation
équivoque. Le 7 octobre 1898, Saunière
le prie de monter pour actes de notaire. Le 10 suivant, P. Roché
lui demande de se rendre à Couiza pour passer l’acte. Le 26 juillet
1899, Saunière l’interroge au sujet des bornes des propriétés. Les Galibert sont toujours aux Pontils à cette
époque. Deux questions se posent alors :
1- De quelles bornes de
propriétés s’agissait-il ?
2-
Où
sont reportés les frais de notaires dus par B. Saunière ?
Les carnets de comptes n’en font pas mention et il y
a peu de chance pour que les bornes soient celles de ses terrains à
Rennes-le-Château.
Le
constat s’impose de lui-même :
-
Le tombeau des Pontils ne vient pas d’une haute antiquité et n’a rien d’une
cache au trésor, ce serait trop facile. Si facile, qu’étant devenu un exutoire
à de nombreux chercheurs de magot doré, les propriétaires de la parcelle où
était érigé le monument, excédés par les multiples profanations, le firent
disparaître, raser tout bonnement vers 1984.
-
Il n’a pas inspiré Nicolas Poussin, c’est le tableau de Poussin qui incita à sa
construction. A l’instar d’une borne de propriété, il était un point de repère
sémantique et géographique… sacré.
L’abbé
tente ainsi de nous mettre en garde tout en nous guidant vers le secret du codex bezae connu de l’Initié, Nicolas
Poussin. La preuve chiffrée est gravée sur la pierre. Pour rester prudents,
nous dirons seulement qu’une clé de cryptage fut ciselée en chiffres romains,
LIXLIXL[6]
, sur la tombe de la dame de Blanchefort
par Bérenger Saunière[7]
pour souligner la portée universelle du Codex Bezae : PAX 681 ou ARCHE 186…
 |
Le retour du jeune Tobie et sa rencontre avec son père et sa mère, par E. Lavallée Poussin vers 1789 |
A
ceci s’ajoute une question, connaissant déjà deux versions du tableau de
l’Arcadie, peut-on penser qu’il en existât une troisième ? Si l’on en croit
Antoine Rondelet s’exprimant dans « La Revue d’économie
chrétienne » de 1867 cet autre paysage de l’Arcadie de Poussin
porterait l’inscription « ET
EGO IN ARCADIA VIXI » (sic) suivi de « Et moi aussi j’ai vécu et dansé en
Arcadie ».
Il ne peut y avoir de confusion avec le deux premières
versions bien connues. Et l’auteur de décrire la scène : « Je
pense qu'on se rappelle, sans que j'aie besoin d'y insister plus longtemps, ces
chœurs de jeunes filles qui se donnent la main, enchaînées les unes aux autres
par des guirlandes de fleurs, cet horizon de la campagne de Rome, ce soleil,
cette lumière qui est dans le cœur et dans la nature. De ce côté du
tableau, il n'y a rien que des sujets de joie. Puis dans un coin, sur une pierre
sépulcrale, se trouve cette inscription...»[8].
Un tableau d'Antoine Rivalz, peintre dont nous parlerons plus loin, évoque la même scène tout en portant la citation originale de l'oeuvre maîtresse. A.
Rondelet a peut-être commis une erreur en attribuant l’oeuvre à N. Poussin. L’auteur
pourrait être également Etienne Lavallée-Poussin, épigone de son
ancêtre. D’autant plus qu’il exécuta une toile sur le thème du retour de Tobie.
C’est bien entendu un de ces thèmes religieux récurrents adoptés par de
nombreux artistes. Toutefois, l’affaire du Liber Tobiae
aidant, l’histoire prend une autre tournure même si rien n’indique formellement
un rapport entre Lavallée-Poussin et la troisième
oeuvre. Quoi qu’il puisse paraître, si ce tableau est de Nicolas Poussin il
s’agirait d’un révélation en soi !
Un
texte de Diderot publié en 1758 confirme l’existence de l’oeuvre en y décrivant
la même scène : « des jeunes bergères qui dansent au son du
chalumeau »[9].
Ainsi l’approche philosophique du thème arcadien nous ouvre tantôt les Portes
de la mort, décrites par Nicolas Poussin, tantôt celle de la vie, décrites par Maurice
Maeterlinck[10]. Temple de vie, temple de
mort, où aurait pu passer cette oeuvre dont la citation latine est la seule des
trois à comporter des chiffres. Et oui ! VIXI : de la « vie
vécue » surgît les nombres 611, 591 ou encore 6101. Curieusement le
premier, chiffre de mort inversé (vie/mort), tête en haut, par effet de miroir nous remet les
idées en place : 911 - 9/11... Ceci ne vous rappelle rien ? Nombre
symbolique, anachronisme de l’histoire ou fait du « Azard » ?
Le gardien des Portes du Temps de M. Maeterlinck, Grand-Maître
du Azard en détient la clef.
En
tronquant, voire transfigurant, la locution dans les deux tableaux connus, le
Poussin a-t-il voulu marquer une piste singulière ? Pourquoi ne pas l’avoir reporté
sur les deux autres tableaux. Les pistes chiffrées à la romaine dissimulées
dans des textes sont peu communes. L’info est lancée et au lu de ce qui va
suivre vous comprendrez qu’il ne faut absolument rien négliger, dixit notre
Poussin.
| Lire la suite... dans les Dossiers Inédits du Mercure de Gaillon (FANUM II)
Ou à lire dans le Mercure de Gaillon N°16 : Le temps d'un secret, les antiquaires de l'Aude...
Thierry Garnier Remerciements particuliers à : A-M Lecordier Extrait de « Arcana Codex L.II, du Da Vinci Code au Codex Bezae », M2G Editions, 2006. Revu et augmenté le 01.01.10 et le 01.11.11
[1]
Cf. Arcana Codex L.II, du Da Vinci Code au Codex Bezae, Th. Garnier, M2G Editions, 2006, p.117. [2]
Inscriptions Antiques des Pyrénées, J. Sacaze, 1892. [3]
Information reprise partiellement dans « Le Cercle d’Ulysse », 1977. [4]
Paris-Normandie, juillet 1993. [5]
Cote BnF : 4- LK7- 51754 [6]
Cliquez sur le lien pour voir le calcul ou décryptage dans les Dossiers inédits
du Mercure de Gaillon. [7]
Cf, Gaston Sudre domicilié à Rennes-les-Bains. Il fut enfant de cœur de l’abbé
Saunière à Rennes-le-Château. [8] Revue
d’économie chrétienne, la spiritualité dans l’art, par A. Rondelet, 1867, p.643
et 644. Voir aussi le Moniteur Universelle de 1867 (cf. fonds L. Coutil A-D. 27) . [9]
Et in Arcadia ego !
par Jean-Claude
Berchet. In: Romantisme, 1986, n°51. Premiers
combats du siècle, p.86. [10] Cf. L’Oiseau Bleu, in Mercure de Gaillon N°15. |