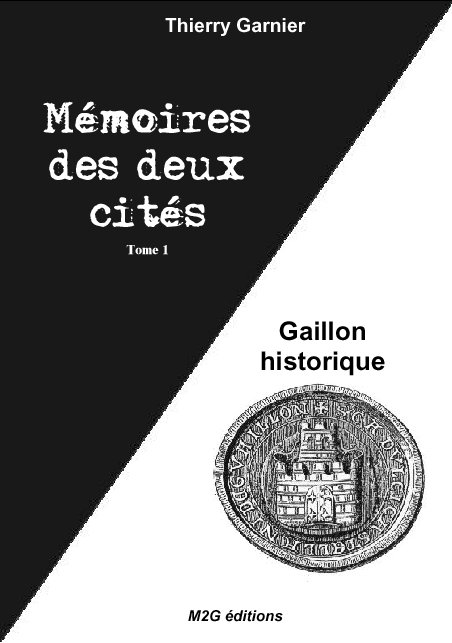L’emprisonnement du fantomatique Nicolas Poulain, dans la forteresse de
Gisors en Normandie, a toujours suscité des interrogations. Les légendes sur
ses véritables origines ont souvent pris le pas sur la réalité. La vérité,
cachée dans les rayonnages poussiéreux des bibliothèques où l'on retrouve la trace des Templiers, ressurgit
aujourd’hui, encore plus stupéfiante que la légende. Nicolas Poulain, l’agent trouble Où
son aventure commence, ne peut se terminer qu’au fond d’un cachot humide et
malodorant du château de Gisors. Le prisonnier de la tour, Nicolas Poulain (ou
Poullain) est toujours resté une énigme. Son image mythique a engendré toutes
les hypothèses. Qui était-il ? D’où venait-il ? Les thèses, des plus
folles aux plus scabreuses, courent encore de nos jours. Du Gardien
mystérieux des trésors enfouis dans les souterrains de Gisors, attendant le
retour de sa promise, à l’amant de Blanche d’Evreux en passant par le délire du
conquérant américain, rien ne nous a été épargné. Il
faut reconnaître que les élucubrations ravageuses tournant autour de ce
mystérieux prisonnier ont vu le jour après la publication en 1962 du livre de
Gérard de Sède, Les Templiers sont parmi
nous. Pour cela, le passé obscur du château de Gisors et de la ville est
complètement trafiqué depuis des dizaines d’années, tant par les guides du
château que par les historiens contemporains, ou prétendus tels. L’objectif est
clair: supprimer toutes traces de l’Ordre Templier à Gisors afin de refréner l’ardeur
des chercheurs de trésor, quelle que fût la nature de son contenu. Certains
vont même jusqu’à émettre des réserves quant à la présence templière dans ces
murs[1],
aussi courte fût-elle. D’autres, pourfendeurs des fantasmes populaires, ayant
une rhétorique bien huilée, mettent en avant la théorie d’un chanoine Tonnelier[2],
renommant le prisonnier de la tour Nicolas Poulain en Elie de Beaumont fuyant
la terre de France pour courir l’Amérique[3].
L’abstraction de l’inscription - Ô mater dei, memento mei, POVLAIN -,
gravée sur les murs de la geôle, réduit à néant cette imposture. Plus
sérieusement, N. R. Potin de la Mairie[4] et P.
F. D. Hersan[5] prétendaient que le nom
gravé de Nicolas Poulain désignait le lieutenant prévôt d'Ile de France, qui
dénonça un complot, de la faction dite des
Seize, ourdi en 1587 contre
Henri III. Les Guise, pour se venger, le firent enfermer à Gisors.
Chateaubriand, quant à lui, reprend cette thèse dans son Analyse raisonnée de l’Histoire de France[6]. Il ajoute que ce
N. Poulain était le fils naturel du cardinal Charles de Bourbon (*), fondateur de
la Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon, couloir de la Demeure Mystérieuse
gaillonnaise exhumé des entrailles de l’Histoire de France secrète par Patrick
Ferté[7]. Les
deux initiales N et P retrouvées parmi les graffitis ornant les murs du cachot
de Gisors sont autant de preuves supplémentaires accréditant cette version. Autour des graffitis Nicolas
Poulain, le fils, fut jeté en prison à Gisors pour traîtrise. Il en ressortit
quelques années plus tard, nous dit-on. Ensuite, nous perdons sa trace. Pour
comprendre les mécanismes plantardesques, sources de G. de Sède, qui fit de N.
Poulain une chimère noyée dans un flot d’âneries, il suffit de reprendre leur
source bibliographique principale : Voyages
pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, La Normandie Vol. II
(et non Vol. III comme le mentionnent de multiples reprises littéraires) de
Taylor, Nodier et de Cailleux. C’est dans ce fort volume (in-folio), qu’une
grande partie de la légende du Prieuré de Sion (asbl fondée en 1956) fut puisée
et construite : de la coupure de l’Orme, qui n’en est pas moins une
histoire vraie, de l’un des trois auteurs Charles Nodier devenu Grand Maître du
PdS, enfin de toute la dialectique entourant le sieur Poulain et ses graffitis.
Nous retrouverons également, dans le volume II, l’histoire de Gaillon ainsi
qu’une multitude de gravures sur lesquelles pose sans complexe C. Nodier. Nicolas
Poulain, fils naturel de Charles de Bourbon-Vendôme reste néanmoins l’auteur
d’une partie des inscriptions principales du cachot de Gisors, écrites entre
1526 et 1590, selon les auteurs les plus sérieux. Il serait d’une grande
stupidité de penser qu’il fut le seul détenu de la geôle normande.
Afin
de rectifier quelques conjectures controuvées nous devons citer certains
d’entre eux, graveurs à leurs heures perdues. Les bas-reliefs, en effet, ne
paraissent pas avoir été exécutés tous de la même main. Ainsi, la présence à
Gisors de Wolfgang de Polheim (ou Polham), homme de confiance ou amant de Marguerite de
Bourgogne enfermé sur ordre de Louis XI, suivant l’hypothèse de M. Blangis, est
possible. P. Hersan[8] nommait Simon de Macy
comme possible Templier incarcéré à Gisors en 1314. En réalité, il n’en est
rien. Même si de vrais Templiers, et nous y viendrons, furent enfermés dans les
cachots de Gisors, Simon de Macy, dit Cordelier, n’était pas Templier. Il fut condamné
comme simple prisonnier politique[9]. Il
sortit rapidement de prison puisque nous le voyons mentionné en 1318 dans le
cartulaire de Notre-Dame de Paris[10]. Une
charte lui concède l’autorité d’acquérir fiefs et autres biens. Il y est nommé
en tant que simple chevalier vivant encore en 1336. Quant
à la captivité de Templiers à Gisors, dès 1309, les documents ne manquent pas. Pendant
le procès des Templiers, le 7 août 1309, une commission se réunit à Paris. Elle
envoya des messages à travers tout le royaume mandant tous ceux qui voulaient
défendre l’Ordre. Le 27 du même mois, Ponsard de Gisi, précepteur de Payens,
comparut devant les commissaires et leur déclara avoir été torturé notamment
par les ennemis des Templiers, Flexian de Béziers, prieur de Montfaucon, et le
moine Guillaume Robert, alors qu’il était emprisonné à Gisors[11].
Nous présentons ci-dessous un extrait tiré de l’ouvrage de M. Raynouard[12] :
La
venue à Gisors de deux enquêteurs ecclésiastiques prouve la réclusion de
quelques Templiers à Gisors avant 1314, comme dans d’autres citadelles du
royaume. Des chevaliers du Temple, dont Ponsard de Gisi, étaient incarcérés
dans celle de Gisors en 1309. Les Templiers de la commanderie de Bourgoult à
Harquency, près des Andelys, furent de ceux là également. Guillaume
de Gisors, assigné au maintien des biens de l’Ordre par Philippe le Bel et
Clément V fut interpellé le 23 juin 1310 par Jean de Parville, huissier
d’armes, député à la garde des Templiers. Il informa le seigneur de Gisors
qu’il avait commis, depuis le 1er jour du mois, Pierre Provencel à
la garde de neuf Templiers étant précédemment sous celle de Robert Verson à
Gisors. Ses gages étaient de trois sols parisis par jour pour lui et douze
deniers parisis octroyés à un valet pour le service des neufs Templiers[13]. Nous
avons encore un témoignage complet et irrécusable, celui de Geoffroy paris, écrivain contemporain de l’Ordre
martyr. Sa « Chronique métrique », écrite en vers et vieux français,
s’étend depuis l’an 1300 jusqu’au mois d’août 1316. Elle est sans aucun doute
le monument littéraire le plus curieux et le plus digne de foi mis à notre
disposition sur les premières années du XIVe siècle. Geoffroy paris ne parle pas par ouï dire. Témoin
oculaire du supplice du Grand Maître, il décrit dans les détails la détention
de Jacques de Molay au château de Gisors peu de temps avant son départ pour
Paris[14] en
mars 1314. -
Vers 6033 à 6044 - Au sujet des Templiers Tantos com ce fu accordé Le grand mestre a esté mandé Qui tenoit prison à Gisors En ce temps ; lors en fu mis hors : Si fu à Paris amenez Cil estoit sages et senez, Je di au mains du sens du monde Et moult tenoit son ordre à monde. Mes quant ot assez sermonné, En la fin fut-il condamné, Et fu jugié qu’il feust ars. Un
tel événement fait désordre quand on veut abolir le mythe Templier dans ce site
éminemment symbolique. Malheureusement, ils en seront pour leurs frais, car les
informations les plus récentes recueillies mettent à mal les théories
négationnistes les plus rébarbatives. Jacques
de Molay ou ses frères auront-il pu graver quelques messages codés sur les murs
de sa cellule comme ils le firent à Chinon ? En vérité nous n’en savons
rien. Quoi qu’il en soit, certains graffitis sont à mettre à l’actif d’un des prisonniers de la tour, Nicolas Poulain, lieutenant général d’Isle de France. 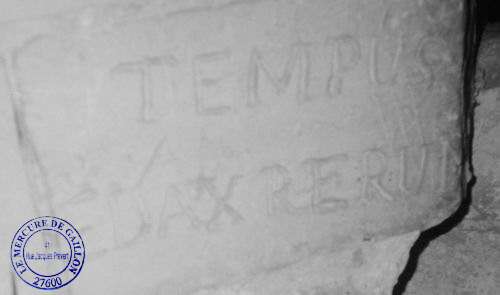
Il
ressort du distique latin, une connotation maternelle sans équivoque. Bien
qu’inattaquable, nul besoin d’utiliser l’anagramme formée par G. de Sède
« Amo Demeter enim timeo » – J’aime Déméter et je la crains
– pour juger que nous avons en face de nous une analogie à une déesse-mère,
la Matrice : Déméter grecque, Isis égyptienne ou Cybèle romaine,
puis gauloise. Leur représentation primitive et leur culte font tous référence
à une pierre noire ; une pierre météorique. Par syncrétisme entre les
religions païennes et chrétiennes, le culte des vierges noires, soutenu par saint
Bernard, prit forme. Et de l’image de Cybèle jouant du tambourin, coiffée d’une
tour ou d’une étoile à sept branches, assise sur son chariot de pierre rouge
à quatre roues (une rhéda) tiré par deux lions, surgit l’indicible et
angoissant portrait de Rennes-le-Château : Terribilis est locus iste !
Un pont entre deux rives Mais
ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain et remettons-le dans son berceau. En
modifiant le nom de Poulain en Pontani, Taylor, Nodier et de Cailleux n’ont pas
commis d’erreur. Parmi ces trois personnages, nous savons que Nodier a été membre
de sociétés secrètes du XIXe siècle. C’est un secret de
polichinelle, suffisamment grossier pour en faire un grand-maître du plantureux
Prieuré de Sion (asbl fondée en
1956). Cadet de Gassicourt assurait qu’il était l’un des principaux membres des
Philadelphes. Appartenance mise en évidence dans "l'Histoire des Sociétés Secrètes de l'Armée"[16].
Forts
de leurs appuis obscurs, Nodier et ses co-auteurs pouvaient connaître la vie
dissolue du cardinal de Bourbon. Ainsi ils marquèrent une piste à suivre, tout
en la voilant : celle de Nicolas Poulain, son fils. Cela
mérite quelques explications pour suivre ce raisonnement. Pontani, en latin[17],
désigne les mendiants vivant sur le Pont Sublicius à Rome, un pont en
bois disparu de nos jours. Le Pont Sublicius, situé non loin du Pont Aemilius,
était le plus ancien pont de la ville reliant le Forum Boarium à la rive droite
du Tibre. Il tire son étymologie du mot sublicae qui signifie : poutres,
pilotis. Il marquait la limite entre la navigation maritime et la
navigation fluviale. On attribue sa construction au roi Ancus Marcius. Emporté
à plusieurs reprises par les eaux, il fut toujours reconstruit en bois. Les
arches étaient en bois pour des raisons religieuses. À Rome, les pontifes, dont
le nombre ne dépassait pas cinq, étaient chargés de l'entretien de ce pont
sacré. Pontife provient du latin pontifex – qui fait le pont entre les dieux
et les hommes – ; c’est le rôle d’un prêtre-roi tel que Charles
de Bourbon-Vendôme aurait pu l’être en quelque sorte. Le Grand Pontife
(Pontifex Maximus) portait le titre le plus élevé de la religion romaine. Il
établissait le calendrier des jours fastes (jours ouvrables) et néfastes (jours
fériés) ; il présidait aussi au culte national des dieux capitolins. Il
est donc parfaitement concevable que les trois auteurs aient vu symboliquement,
entre ciel et terre, un mendiant (Pontani) en la personne de N. Poulain, fils
naturel de Charles de Bourbon, le Grand Pontife. Le graffiti IV
pourrait-il être une évocation du prêtre-roi tenant dans ses bras son enfant,
s’il ne faisait aussi allusion à une descendance de Jésus et
Marie-Madeleine ? Entre les deux cas, il y a une étroite coïncidence et
une référence certaine au roi perdu. Mais la parabole est ici insuffisante pour
faire de N. Poulain un fils de roi, fût-il sans couronne. Observez bien la gravure
du prisonnier dans son cachot, publiée par le joyeux trio. On y voit non
seulement la sentence latine erronée « Ô mater dei, miserere mei,
Pontani », mais aussi, juste au-dessus, une fleur de lys… royale et de
Bourbon ! Charles X = x²
On
a tant glosé, vociféré sur l’origine de ce Nicolas Poulain, qu’il convient une
fois pour toutes de mettre les choses au clair. A
la fin du XVIème siècle, la France eut un roi dont le règne fut
éphémère, c’était Charles Ier de Bourbon, appelé Charles X pour les
besoins de la couronne. Oncle et parrain d’Henri IV et cousin germain de
François de Lorraine, il était né en 1523. Abbé de Jumièges, St Wandrille, de
Châalis[18],
évêque de Carcassonne, cardinal, archevêque de Rouen de 1552 à 1590, légat du
pape en Avignon de 1565 à 1590, c’est lui qui avait béni le mariage de
Marguerite de Valois et d’Henri IV à la veille de la Saint-Barthélemy. À la
mort du duc d’Alençon, dernier frère d’Henri III, il fut reconnu par la Ligue
et Philippe II d’Espagne comme héritier présomptif de la couronne de France. En
1588, Henri III le désigne comme son plus proche parent. Après le meurtre de ce
dernier, Charles de Bourbon-Vendôme fut proclamé roi par les Ligueurs au
château de Gaillon, dans la Maison Blanche du Lydieu[19], le
2 août 1589. Une
anecdote peu connue révèle que Charles de Bourbon, futur prêtre-roi, eut une
liaison avec une femme dont on ignore tout. De cette union interdite naquit un
fils, à Saint-Denis, vers 1560. Un fils d’archevêque, cela fait mauvais genre, bien
qu’il ne fût pas le premier dans ce cas. Outre Chateaubriand, Gérard de Nerval
affirme lui aussi qu’il eut un fils naturel appelé Poullain[20]. Nous
présentons donc ici un élément de preuve irréfutable, car authentique et
historique, à propos de ces allégations. Cette preuve date de 1725, année de sa
publication. Elle apparaît dans les sources généalogiques les plus connues, et
pourtant personne à ce jour n’a songé à la mentionner. Elle fut publiée par le
père Anselme de Sainte Marie dans son Histoire
Généalogique de la Maison de France, où il dit très objectivement :
A
l’instar de son fils, agent double emprisonné à Gisors, ami ou ennemi on ne
sait trop, Charles X n’eut guère plus de chance. Il fut arrêté à Blois le 23
décembre 1589 et placé en résidence surveillée, tandis qu’on assassinait les
Guise[22]. Il
mourut prisonnier à Fontenay-le-Comte le 9 mai 1590 et fut enterré en la
Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon qu’il avait fait ériger de son vivant. Son
tombeau fut ravagé par l’incendie de 1764. Ses cendres, avec celles d’autres
princes et princesses de Bourbon, furent transférées dans un tombeau de la
nouvelle Chartreuse reconstruite au même endroit. L’abbaye ayant été détruite
pendant la Révolution, le marbre tumulaire, reflet d’une haute initiation (tête
de mort et tibias entrecroisés), fut placé dans l’église Saint Georges
d’Aubevoye. Thierry Garnier Dernière
mise à Jour : 20.05.2009 Remerciements particuliers à : A-M Lecordier [1] Le château médiéval de Gisors, Jean Louis
Magnier, Ed. Bertout, 1999. [2] P.M.Tonnelier a tenté de démontrer en 1971,
dans la revue Archéologia n°43, que le prisonnier de Gisors s'appelait Elie de
Beaumont – malheureux époux de Catherine de Basian. Hélas, cela n’explique en
rien le nom gravé « Poulain » et les initiales N.P. [3] Gisors dans l'histoire, Jean Paul Besse,
Ed. L'âge d'homme, 1998. [4] Lettres sur Gisors adressées à M. De Laitre
Préfet de l'Eure, par Nicolas René Potin de La Mairie, 1848. [5] Histoire de la
ville de Gisors, P. F. D. Hersan, 1858. [6] Analyse raisonnée de l'Histoire de France,
François-René de Chateaubriand, reproduction de l'éd. de Paris : Garnier,
1861. Voir aussi : Les Archives curieuses de l'Histoire de France, depuis
Louis XI jusqu'à Louis XVIII, ou Collection de pièces rares et
intéressantes..., de Louis Lafaist, Beauvais, 1836. [7] Arsène Lupin
Supérieur Inconnu, P. Ferté, Ed. Trédaniel, 1999. [8] Op.cit. [9] Mémoires de la
société historique et archéologique de l’arrondissement de Pontoise, 1935. [10] Cartulaire de
l’église de Notre-Dame de Paris, doc. XVII, 31 juil.1336. [11] Procès des
Templiers, par Jules Michelet, Imp. Royale, 1841. [12] Monuments
historiques relatifs à la condamnation des chevaliers du Temple, par François
Juste Marie Raynouard, Imp A. Egron, Paris, 1813. [13] Bibliothèque Gaignières - 714, n°58. Extrait
pris à la Chambre des comptes parmi les recueils de pièces justificatives
relatifs aux Templiers. Cf. Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque
Impériale, T.I, par L. Delisle, 1868. [14] Chronique
métrique de Geoffroy (ou Godefroy) de Paris, par Jean Alexandre Buchon, Lib.
Verdière, Paris, 1827, p.217. A partir du vers 6063, p.219, Geoffroy de Paris
relate la prophétie contre les rois de France déclamée par Jacques de Molay sur
le bûcher. [15] Les
Métamorphoses d’Ovide, XV, 234. [16] Galerie
historique des contemporains ou nouvelles galerie, par Pierre Louis Pascal de
Jullian, T.7, 1822, p.297 et Histoire des Sociétés Secrètes de l'Armée, imp. A. Egron, Paris, 1815, p. [17] Dictionnaire
latin/français, Fr. Noël, Paris, 1820. [18] Oeuvres / Gérard de Nerval, textes établis,
par Henri Lemaitre, Reproduction de l'éd. de Paris : Garnier, 1986, Angélique ;
Châalis était une plaque tournante de l’Illuminisme Français aux XVe
et XVIe siècles. [19] Comptes de
dépenses pour le château de Gaillon, A. Deville, imp. Nationale, 1850. [20] Op. Cit. [21] Histoire généalogique et chronologique de
la maison royale de France, des pairs, grands officiers de la couronne et de la
maison du roy et des anciens barons du royaume, Tome I, 1725, par le P.
Anselme. [22] Réduit aux expédients, Henri III organise
l'élimination des Guise (1588). Décapitée, la Ligue tourne au fanatisme
révolutionnaire : la Faculté de Théologie délie tout serment de fidélité
au roi et un conseil, dit "des Seize", étend son gouvernement sur le
royaume. En 1589, le dernier roi Valois, Henri III, est assassiné. Rassemblés
par un Guise, le duc de Mayenne, qui est devenu lieutenant du royaume, les
états généraux de Paris sont le théâtre des intrigues de l'Espagne qui espère
placer son candidat sur le trône. |





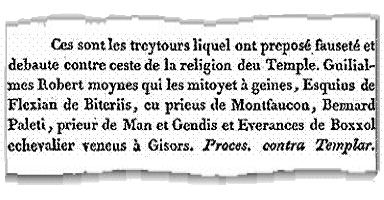

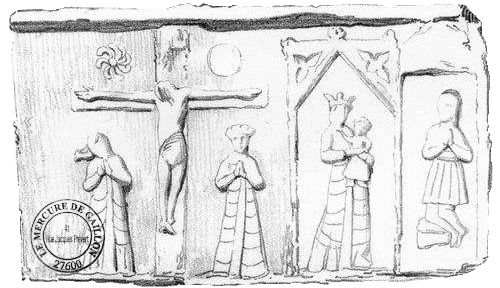
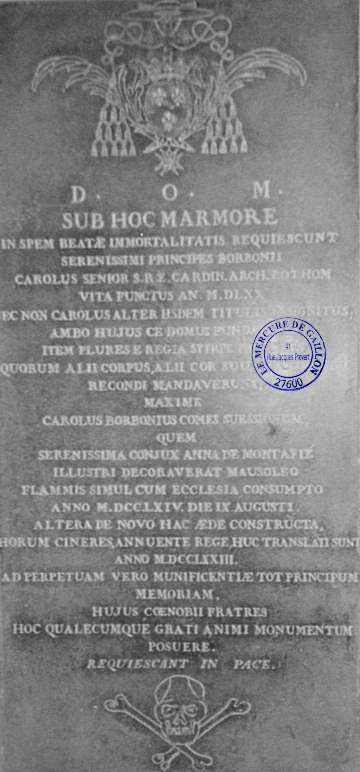
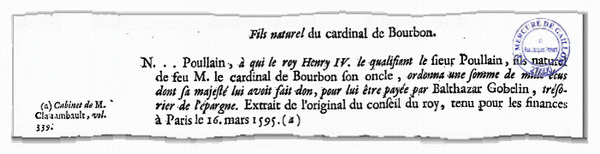 « Fils naturel du Cardinal de
Bourbon : N. POULLAIN à qui le Roi Henri IV, le qualifiant de Sieur
Poullain, fils naturel de feu M. le Cardinal de Bourbon son oncle, ordonna une
somme de mille écus dont sa Majesté lui avait fait don, pour lui être payée par
Balthazar Gobelin, Trésorier de l'Epargne (extrait de l'original du Conseil du
Roi, tenu pour les finances à Paris le 16 mars 1595) »
« Fils naturel du Cardinal de
Bourbon : N. POULLAIN à qui le Roi Henri IV, le qualifiant de Sieur
Poullain, fils naturel de feu M. le Cardinal de Bourbon son oncle, ordonna une
somme de mille écus dont sa Majesté lui avait fait don, pour lui être payée par
Balthazar Gobelin, Trésorier de l'Epargne (extrait de l'original du Conseil du
Roi, tenu pour les finances à Paris le 16 mars 1595) »