|
|
Des cultes et des églises de Gaillon |
De l’antiquité des cultes
Les premières sociétés gauloises civilisées de la contrée
gaillonnaise sont issues des
peuplades implantées dès la préhistoire
entre la Seine et la rivière d’Eure, dans le pays de Madrie, bordée
au nord par le Vexin et au sud par le pays de Chartres. Selon les anciens géographes, la Madrie servait de frontière septentrionale au
pays des Carnutes (Chartres) et n’était pas moins consacrée que la forêt du
même nom[1].
Les
habitants de la région se lancèrent dans l'érection d'énormes blocs de pierre,
les mégalithes[2] : menhirs et dolmens
auxquels ils vouèrent l’adoration que l’on connaît. Les druides étaient les
ministres du culte chez les Gaulois. Ils se composaient de deux classes :
les Saronides se consacrant à l’éducation de la jeunesse et les Bardes,
leurs poètes. L’appellation de druide vient du mot grec signifiant chêne, arbre
le plus sacré entre tous. Ils avaient d’ailleurs coutume de se réunir au milieu
des forêts et sur les bords des fleuves qui étaient leurs temples et où ils
invoquaient dieux et déesses jusqu’à l’avènement du christianisme et même au-delà. La résistance des
idolâtres était en effet forte dans le pagus Madriacensis où les
croyances dans les mystères de la Nature étaient restées ancrées bien plus
profondément que les mystères du Dieu unique.
 |
Temple gallo-romain de Saint-Aubin-sur-Gaillon en 1911 |
Il
ne faut pas s’imaginer que les croyances d’un peuple ont disparu des cœurs du
jour au lendemain, surtout chez les peuples gaulois. Elles se sont transmises
religieusement de génération en génération pendant des siècles. Malgré leurs
efforts, le polythéisme romain puis le christianisme ne purent détruire
totalement l’ancien culte druidique. Les dieux de l’occupant romain avaient été
forcés de cohabiter avec les dieux gaulois. En 1911 des archéologues ont
découvert les vestiges d’un fanum ou temple gallo-romain sur les coteaux
proches de Saint-Aubin surplombant Gaillon. Pour le christianisme, cet état de fait perdurera au moins jusqu’au début du
XIVe siècle dans quelques zones du pays. Comme nous l’avons vu, cela
parait avoir posé de sérieux problèmes dans d’autres régions de France, à
l’exemple du château de Barbarie dans le Nivernais où l’on assista à un pogrom
causant la destruction de la citadelle.
Des
scories de l’ancien culte païen subsistent encore aujourd’hui n’occupant le
rang que de simples superstitions. Il n’est pas rare de voir sur nos tables de
nouvel an ou sur nos portes d’entrée, quelques branches de gui, une sorte de
porte-bonheur pour l’année nouvelle. Dans l’antiquité, cueilli au moyen d’une
serpe d’or et béni par les druides sous le cri de "a gui l’an
neuf ", clamé en Vraie Langue Celtique, il était un talisman
apportant protection contre les maladies et les enchantements.
Pour
faire "passer la pilule" aux derniers païens les plus endurcis, les
croyances gauloises furent assimilées à la nouvelle religion. Parmi d’autres, le
culte de Cybèle, représentée sous la forme d’une pierre noire, fut ainsi
syncrétiquement lié à celui des Vierges Noires de la même manière que le culte
d’Isis l’avait été auparavant. Le culte des Vierges Noires fut introduit dans
tout le pays par Bernard de Clervaux, rédacteur de la règle de l’Ordre du
Temple, ayant été lui-même élevé dans le druidisme. Ajouté à cela dès la fin du
IVe siècle, les paganis, paysans de l'époque romaine, en révolte
contre l'empire romain, viendront grossir les rangs de la nouvelle religion
catholique.
Les
premiers chrétiens de la future Normandie, comme partout ailleurs, furent persécutés.
Saint Mauxe et saint Vénérand subirent leur martyre à Acquigny
(Eure). Le site de leur exécution est encore chargé de tout un tas de superstitions
s’amalgamant au culte païen. Le siècle suivant verra le baptême et le sacre de
Clovis, mettant fin officiellement aux cultes romain et celtique (druidique)
sur tout le territoire. Les monastères, les abbayes puis les églises fleurirent
un peu partout.
La maison des Mères
Le
culte de Cybèle parait s’être développé dans ce secteur, à Gaillon. Ses prêtres
étaient appelés Gallis (ou Galls). Vous aurez immédiatement fait
le rapprochement entre la curieuse étymologie celtique du nom de Gaillon, Gay
Home - Gail Home[3]
- la Demeure Joyeuse et le mot Gallis, nom désignant les prêtres de
Cybèle Gaillon serait alors la Maison des Galles, la Demeure
Mystérieuse des prêtres de Cybèle.
Pour
étayer nos affirmations nous présentons trois monuments marquant chacun leur
époque. Le premier est le dolmen d’Aubevoye, monument situé dans le cimetière
accolé à l’église Saint-Georges, deuxième monument bâti au XVIe
siècle, où il passe complètement inaperçu. Saint Georges est le symbolique
tueur de dragon exprimant la suprématie du christianisme sur le paganisme. En
matière d’alchimie, on y voit bien d’autres choses. Ces symboles sont encore
très nets. Le saint sauroctone était aussi le protecteur de la chapelle du
château de Gaillon. Le troisième et dernier est la statue d’une Vierge Noire,
élevée vers 1880, à quelques mètres de là dans les bois. Ces trois témoins ne
peuvent renier le caractère d’un champ sacré situé en contrebas du château de
Gaillon.
 |
Dolmen de l'église St-Georges d'Aubevoye |
Il
est fort dommage que personne n’ait eu l’idée de faire un historique précis de
ce dolmen qui n’est nullement une sépulture. Par ces temps de renouveau
celtique on a trop souvent tendance à confondre dolmen, table de pierre
sacrificatoire[4], et allée couverte,
tombeau le plus souvent collectif, afin de gommer les aspects barbares du culte
druidique : les sacrifices humains. Léon Coutil[5] esquissa
brièvement l’aspect rustique du monument et il n’a jamais trouvé la moindre
trace de squelettes comme on en trouve dans les tumulus ou allées couvertes. Il
l’a décrit comme une table de pierre supportée
par deux monolithes d’aspect frustre. C’est à sa demande que le curé du village
a fait déplacer ce trilithe[6] en
1895 plus prés de l’église car il créait une gêne dans l’entrée du cimetière. Il semble avoir subi quelques
dégradations lors de son déménagement; un de ses socles n’est pas d’origine. Il
est d’une taille modeste mais atteste bien de la localisation d’un sanctuaire
païen, conformément à ce qui vient d’être dit plus haut.
Les
traditions cultuelles de ces prêtres de Cybèle sont identiques à celles des
égyptiens dans la tradition d’Isis. L’adepte devait, auparavant, en passer par la
lecture du livre de Thot, écrit tout en hiéroglyphes et en nombres, il était
conduit à l’Initiation d’Isis et pouvait ainsi voir la déesse face à face. Thot, dieu de la sagesse,
de l’écriture, des arts occultes et des sciences, se servait de son livre pour
communiquer aux hommes ses messages de sagesse.
Le Livre de Thot permettait de voir le soleil face à face[7]. Les galles, à la différence des prêtre
d’Isis, devaient s’émasculer, faisant d’eux des
êtres androgynes, afin d’atteindre une sorte de
prescience suprême. Voir le soleil face à face signifiait dans le
langage des initiés que cet enseignement était l’intégralité de la Tradition
solaire donnée aux hommes. Considéré comme maudit par certains, cet enseignement
permettait à l’homme de se hisser au rang des dieux. Le livre contenait des
connaissances immenses, aussi était-il secrètement et jalousement conservé par
les prêtres du haut clergé égyptien. Les 22 arcanes majeurs du jeu de Tarot en
sont des nos jours la meilleure expression.
Les traces hiéroglyphiques
relevées par Alexandre Lenoir dans les boiseries de la Chapelle Haute du
château de Gaillon et l’iconographie relative au livre de Thot que nous avons
établie en décortiquant les gravures de ses stalles dans notre ouvrage[8]
démontrent la ténacité du culte païen à travers les âges dans le pays de Madrie,
la Maison des Mères. Ténacité et vitalité du culte auxquelles certains
archevêques de Rouen ne furent sans doute pas étrangers.
Les Eglises et Chapelles

L'église Saint-Antoine
L'église
de Gaillon est bâtie sur l'emplacement de l'ancienne église Saint-Antoine
construite par Cadoc en 1205, au pied du château, sur une petite place en
bordure de la route de Paris à Rouen. Cette première église fut dédicacée en
présence des évêques d'Evreux Luc, d'Avranches Guillaume Toloom et de Lisieux Jourdain
du Houmet, fils de Guillaume connétable de Normandie. Ce dernier rallia Simon
de Montfort dans la croisade albigeoise[9].
 |
|---|
En
1208, l'église Saint-Antoine était desservie par un collège de chanoines
auxquels Gilbert d'Auteuil donnait une maison en pierre, des terres, des bois
et cent sols parisis de rente perpétuelle. Cadoc paya cent livres parisis cette
libéralité. La collégiale est encore citée dans une lettre[10] de
l’évêque d’Evreux en avril 1232, établie à Gisors (Acte ci-contre en latin)
En
1605, sous les auspices de Mgr François de Joyeuse la première cure appelée
Notre-Dame fut créée à Gaillon. Jusqu'à cette date, messes et sacrements
étaient assurés par les curés de Saint-Aubin, paroisse mère de Gaillon. En
1739, un arrêt de la cour du parlement de Rouen supprima le chapitre de
Gaillon.
Au
début du XVIIIe siècle, les bâtiments étaient en très mauvais état;
les murs s'effritaient et le pavage se disloquait. Après un début
d'effondrement, les lieux furent abandonnés en 1768. Cette première église
collégiale du XIIIe siècle fut complètement rasée[11] en
1772. La destruction intervint lors de la dissolution de l'ordre hospitalier
des Antonins.
L'église
se composait d'une nef flanquée de deux bas-côtés. Dans l’un d’eux, une
chapelle avait été fondée à la dévotion de saint Gilles. La nef était prolongée
à l'est par une sacristie et à l'ouest par la tour du clocher. Le choeur, voûté
d'arêtes, comportait cinq hautes fenêtres. Entre la nef et le collatéral, une
porte voûtée en arc brisé, encadrée par deux colonnes, s'ouvrait dans une haute
arcature pleine.
La
communication avec la tour du clocher se faisait par une porte sans décor. A
l'extérieur de puissants contreforts renforçaient la façade. Le portail
d'entrée en arc brisé était surmonté par deux arcatures aveugles et une baie de
même style. Le clocher était percé d'une petite porte, de quatre baies ogivales
au premier niveau et de deux autres ouvertures au second étage. L'appartenance
de ce monument au XIIIe siècle n'est contredite par aucun élément
des structures, mais une dénomination de son style en gothique ou roman serait imprudente.
Les détails styliques importants manquent trop pour en faire une évaluation
correcte.
  |
Aucune
crypte n’a jamais été découverte sous l’église, ce qui est assez rare pour un
édifice de cette importance construit au début du XIIIe siècle par
le seigneur en place. Autrefois le cimetière jouxtait l'église. Il fut déplacé
quelque temps avant la destruction de 1772.
Les
chanoines composant la collégiale de Cadoc étaient, selon les premières
investigations, des Antonins. Plusieurs indices le laissent supposer, notamment
la toile de maître intitulée "les adieux de saint Antoine à saint
Paul". Il s'agit ici de saint Antoine dit l'Ermite ou encore
l'Egyptien et de saint Paul l'Ermite. Autres indices d'importance… ou hasardeux
? L'œil du lecteur averti, observera sur une carte de la série bleue qu'une
parcelle de terrain située à quelques centaines de mètres en face de l'église
est dénommée "l'Egypte". Il remarquera également que les poutres
soutenant la charpente de la nef donnent une configuration de TAU (lettre grec
- T -) inversée; Le TAU symbole de l'ordre des antonins. L'appartenance des
chanoines est confirmée dans l'acte dédicatoire de 1205 dont voici le texte
extrait d’un manuscrit anonyme du XVIIIe déposé aux Archives
Départementales de l’Eure.
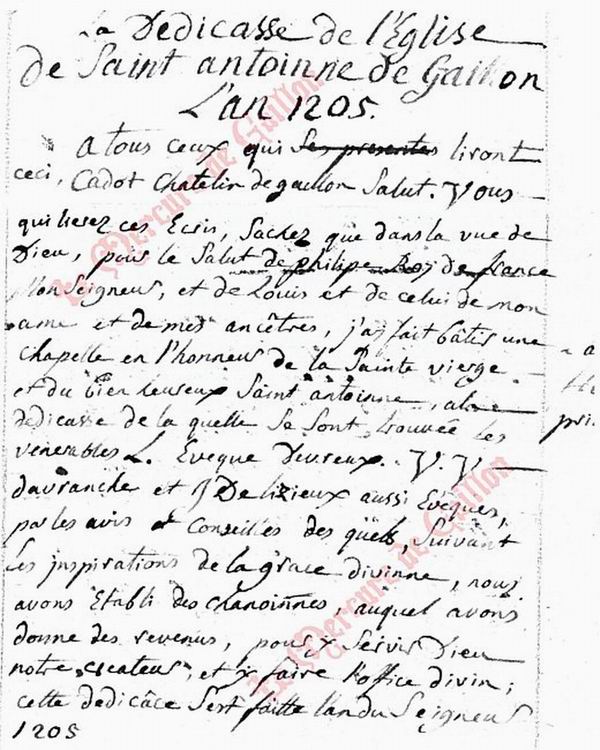
Copie (XVIIIe s) de l'acte dédicatoire
de l'Eglise Saint-Antoine de Gaillon
fondée par L. Cadoc en 1205
La congrégation des Hospitaliers de Saint-Antoine,
reconnue comme ordre religieux en 1218, s’est instituée beaucoup plus tôt à
partir d’un hôpital ouvert à Saint-Didier-de-la-Mothe (Dauphiné). La fondation,
approuvée au concile de Clermont par Urbain II (1095), en avait été
décidée en reconnaissance pour une guérison du mal des ardents, obtenue par les reliques de Saint-Antoine. L’ordre devait compter 369 hôpitaux à la fin du XVe
siècle. Les Antonins, précurseurs de
la médecine douce, étaient des adeptes de l’alchimie. Les initiés leur
donnaient le nom de souffleur[12].
Rejoignant
le syncrétisme religieux évoqué plus haut, les connaissances des Antonins
s’étalaient de la médecine à l’alchimie, jusqu’à celle des énergies
cosmo-telluriques. Elles étaient appelées veines
du dragon[13]. Ces flux, toujours
existants, constituent un réseau planétaire invisible, canalisé dans
l’antiquité par les Egyptiens puis par les Celtes, utilisé au Moyen-Âge par les
Compagnons bâtisseurs dans le plus grand secret à des fins sacrées et
soigneusement occultées par les autorités ecclésiastiques de l’époque. Le
CHÂTEAU DE GAILLON (médiéval ou Renaissance) et la CHARTREUSE de Bourbon-Lèz-Gaillon
furent bâtis sous l’inspiration de ces lignes de forces associées à la
Géométrie Sacrée.

L'église Saint-Ouen
La
nouvelle église construite vers 1773, fut placée sous le vocable de Saint-Ouen.
A la Révolution, elle était fermée au culte ; elle servait de maison du peuple,
de temple de la raison; elle ne fut rendue au culte qu'après la Terreur en
1795.
C'est
une petite église pour une commune qui s'accroît chaque jour. Elle est
construite en pierre de taille de grand appareil et constituée surtout par la
massive tour carrée du clocher et couronnée par un enroulement architectural
très à la mode aux XVIIe et XVIIIe siècles. A
l'intérieur, dans le chœur, deux statues en terre cuite, le Christ (ci-contre à
droite) et Saint-Paul, provenant du château et attribuées à Jean Juste de Tours,
milieu du XVIe siècle. De chaque côté de l'autel deux statues en
bois du XVIIe : Sainte-Scholastique
et Saint-Benoit, l'autel en marbre blanc surmonté du tabernacle et de trois
angelots de toute beauté du XVIIIe siècle proviennent de la Chartreuse
de Bourbon-lèz-Gaillon (voir photo plus loin).
A la poutre de gloire figurait un
Christ en bois sculpté de la même époque. On le voyait encore en 1894. Jusqu’à
présent on pensait qu’il s’agissait du Christ actuel. Or il n’en est rien. Nous
en avons retrouvé la trace dans un compte rendu d’excursion paru dans le Bulletin
de la Société d'Etudes Diverses de Louviers. La surprise fut de taille car
non seulement nous apprenons ici que ce Christ en croix provenait de la
Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon, mais aussi qu'il était d'inspiration
Janséniste, avec les bras surélevés vers le ciel, en "V" très marqué.
Ceci nous montre que le Christ classique placé au fond du choeur de nos jours n'est pas celui d'origine.
Voici les propos rapportés dans ce Bulletin : "M. le Doyen nous
fait remarquer le Christ de grandes proportions, se trouvant au transept et qui
provient de la Chartreuse... [...] .En face la chaire (ndlr: disparue), il est juste de
remarquer un Christ en ivoire, les bras élevés vers le ciel, selon le mode
Janséniste".[14] Ceci
est une nouvelle preuve de l’imprégnation du Jansénisme au monastère des
Chartreux de Gaillon[15]. Quelques détails supplémentaires
compléteront, provisoirement, la description de la nouvelle église remaniée à de nombreuses reprises. Nos excursionnistes Léxoviens
remarqueront encore : " un Pietas
de la fin du XVIe siècle et, en dernier lieu, un tableau relégué
dans un bas côté de l'église, paraissant représenter la scène de la
Réconciliation de l'enfant prodigue. Ce tableau nous intéresse par la façon
dont sont traités les personnages et qui rappelle celle employée par Jean
Nicolle". Le monument du XVIe siècle existe encore mais le
tableau semble avoir disparu, comme le Christ Janséniste en ivoire et d’autres
œuvres de prix.
Une
remarquable peinture sur toile XVIIIe "Les adieux de saint
Antoine à saint Paul", et non "les adieux de saint Pierre à saint
Paul", est située sous la tour au niveau de la tribune des orgues à côte
d'un splendide vitrail (actuellement déposé pour expertise et restauration) de
François Décorchemont "le Christ en croix, la Sainte Vierge et saint
Jean" datant de la première moitié du XXe siècle (env 1930).
Tout ceci fait partie des objets classés. Nous verrons plus loin la chapelle
Saint-Georges du Château. Ce
mobilier a été remanié il y a environ 50 ans. L'intérieur de l'église actuelle
a subi aussi ce que nous pourrions qualifier de nouveaux outrages et n'a plus
rien à voir avec son état d'origine. Les boiseries ornant le cœur ont disparu,
la peinture décrite précédemment était située au-dessus du maître autel. Des
zones d'ombres subsistent au sujet des toiles de maître. Nous avons tenté de dénouer
"ce sac d'embrouilles", sans résultat. Nous savons toutefois qu'une
de ces oeuvres "les adieux de St Pierre à St Paul" de l'école de
Jouvenet aurait disparu[16]... pas
pour tout le monde... Elle est exposée dans la cathédrale Saint-Ouen de Rouen
et comme le hasard ne vient jamais seul on pourra l'admirer dans la
chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul où a été inhumé Mgr de Bonnechose.
On peut lire dans un inventaire révolutionnaire de 1791 que l'église de Gaillon hérita aussi de l'horloge de la Chartreuse et d'un lutrin en cuivre en forme d'Aigle. Tous ce mobiler à disparu. L'horloge actuelle date des années 1930 et le lutrin de cuivre s'est envolé... par la force de l'aigle ? Vas savoir !
|
Pièces justificatives, bibliographie et notes
Documents du dossier





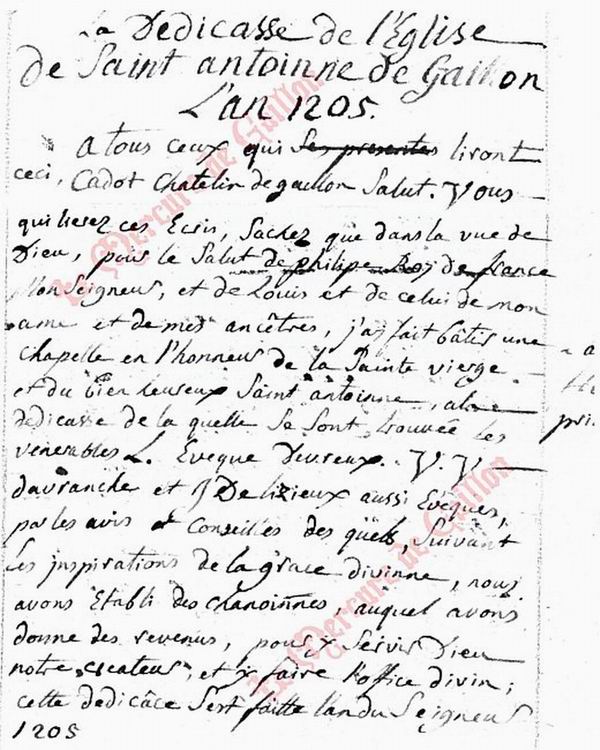





Téléchargement |
Thierry Garnier
Mis à jour le 06.08.08: cf. Bulletin de la Société d'Etudes Diverses de Louviers, 1894/1895.
Remerciements particuliers à : A-M Lecordier
[1] Antiquités
gauloises et gallo-romaines de l'arrondissement de Mantes, par Armand Cassan,
lib. A. Refay, 1835, p.10.
[2] Gravier de Gargantua et Tombeau dit de St
Ethbin à Port-Mort, Dolmen dans le cimetières d’Aubevoye en sont les seuls
vestiges dans notre région.
[3] Mémoires des
deux cités, T.I, Gaillon Historique, Th. Garnier, M2G Editions, 2004.
[4] Histoire
littéraire de la France avant le XIIe siècle, T.1, par Jean-Jacques
Ampère, éd. Hachette, Leipzig, 1839, p.39.
[5] Inventaire des menhirs et dolmens de
France, L. Coutil, 1897.
[6] Op.cit,
p.61.
[7] Cf, Titre des chapitres 4 de «L’Aiguille Creuse» et 9 de «Dorothée danseuse de corde».
[8] Mémoires des
deux cités, T.II, Gaillon Mystique, Th. Garnier, M2G Editions, 2005/2007.
[9] Histoire de
Lisieux T.1, de L. du Bois, éd. Durand, Lisieux, 1845, p.395.
[10] Cartulaire normand de Philippe Auguste, par L. Delisle, Soc.
des Antiquaires de Normandie, 1882, n°393.
[11] Carte
archéologique de Gaillon, P. Caldéroni, 1994.
[12] Ce surnom a
été donné arbitrairement aux faux alchimistes.
[13] Les Veines du Dragon, par G. Tarade, Ed. Robert Laffont, 1989.
[14] Bulletin de la
Société d'Etudes Diverses de Louviers, T.2, 1895, p.20.
[15] Voyez notre
enquête sur la Chartreuse dans Mémoires des Deux Cités T.II.
[16] Nouvelles de l'Eure N°93/1984, Gaillon et son canton, p.11.
