|
|
Pierres Miraculeuses La Géométrie Sacrée du château de Gaillon |
L’écrin Bleu
En
cette fin de XVe siècle, l’Europe, la
France en particulier, aspire à de nouveaux horizons. Il n'est pas
vain ni prétentieux de dire que Gaillon fut, dès le début du XVIe siècle, le premier foyer du style
Renaissance en France car c'est la vérité. Même si peu de gens le savent, et ne
s'intéressent qu'aux maçonneries du Val de Loire, nous pouvons le lire
en toutes lettres dans diverses grandes encyclopédies:
« Le paysage artistique français
resta tout au long du siècle très lié au gothique flamboyant. Toutefois, le Val
de Loire et la Normandie devinrent les premiers centres de diffusion du nouveau
style. Le pavillon d'entrée du château
de Gaillon, dans l'Eure, dont la construction s'acheva en 1510, constitue le
premier exemple d'une architecture entièrement représentative du phénomène.
Agrémenté de jardins à l'italienne et orné de sculptures provenant
d'outre-monts, le bâtiment fut commandé par le cardinal Georges d'Amboise,
archevêque de Rouen et vice-roi de Lombardie. Le roi François Ier construisit peu après ses premiers palais
Renaissance: Blois, Chambord (dont le plan est parfois attribué à Léonard de
Vinci) et Chenonceaux. Le grand escalier de Blois,
achevé en 1524, démontre que les architectes avaient alors assimilé les
principes théoriques de la Renaissance[1]».

Mais
qui pourrait reprocher à nos concitoyens cette méconnaissance du site? Depuis
1789, tout semble avoir été fait pour que Gaillon sombre dans l'oubli. Mis à
part les quelques ouvrages publiés par des historiens régionaux, dans lesquels
nous avons puisé pour écrire ces pages, rien n'a été réalisé à l'échelon
national. Il ne suffisait pas de le détruire dans ses fondements, il fallait
aussi le faire dans la mémoire collective.
La barque qui coule
Que
reste-t-il aujourd’hui de cette splendeur passée? En vérité, pas grand chose. Les deux sourires de cette femme
radieuse et mélancolique ne sont plus qu’un vague souvenir esquissé
en bordure d’un cabochon d’émeraude.
Pour
le lecteur qui a l'envie de connaître, pour l’ami ou l'amoureux des arts et de
l'Histoire avec un grand H, nous
allons tenter de restituer avec le plus grand soin, comme l'a fait Mr A.
Deville dans son ouvrage de 1850, une image la plus fidèle possible de cette Dame blonde, fille aînée de la
Renaissance en Normandie. Nous nous bornerons à
décrire l'aspect architectural des bâtiments tels qu'ils apparaissaient au XVIe
siècle. Suivez le guide!
L'ensemble
de l'édifice est orienté plein Sud, affectant la forme d'un pentagone
irrégulier. Dans les rares parties ayant survécu, le pavillon d'entrée
fortement éprouvé pendant la révolution a retrouvé un semblant de vitalité
depuis 1976.
Le
pavillon d'Estouteville construit au milieu du XVe
siècle constitue en majorité l'aile ouest avec sa tour octogonale située dans
la cour. Vers l'Orient une belle galerie dite «du Val» longe les bâtiments qui
rejoignent au Nord la maison et le pavillon dit «Delorme», nom du maître maçon,
au propre comme au figuré[2],
ayant construit l'ouvrage. Une Architecture Sacrée Avant
de passer à la visite guidée des différents bâtiments, nous aimerions
entretenir le lecteur de certains traits architecturaux fondamentaux que
maniaient et maîtrisaient nos ancêtres. La
géométrie dite sacrée est de celles-là. Certains savants, de Pythagore à Adolph Zeising[3],
avaient compris que l'univers a été créé par ce qui est appelé « l'Esprit
Pur », en suivant certains modèles géométriques simples : rectangle,
triangle, pentagone. Tous
les édifices considérés comme sacrés ont été érigés selon les plans des Maîtres
d'oeuvre, et construits pour durer selon des mesures et des proportions sacrées centrées sur l'Harmonie, avec
le matériau le plus durable, le plus malléable et le plus expressif qui soit : la pierre[4]. Ces
monuments ont été construits selon des règles strictes, où le hasard n'avait
aucune place. Cette technique était manipulée avec Grand Art en vue d'un
projet au service d'un Idéal associant métaphysique et vision du Monde
où l’expression des rapports de l'Homme avec la Nature, ce qui l’entoure,
rejoint son Créateur et le guide vers le Chemin Doré. Les
lignes harmonieuses du Château de Gaillon ne sont donc pas le fruit du hasard
ou dues au coup d'œil juste. Elles naissent nécessairement de la Divine
Proportion[5], horizontale et verticale,
pour créer un volume dont les vibrations transcenderont le Corps et l’Esprit.
L'orientation, les proportions, la destination finale, dans tous les sens du
terme, du château témoignent d'un savoir-faire extraordinaire. La
planche jointe ci-dessus illustre la Géométrie Sacrée définissant la Section
Dorée ou autrement dit, l’application du Nombre d’or[6]
pratiquée avec science par Jean Juste de Tour, Fra Giocondo
et les autres architectes ayant oeuvré à Gaillon. La
Section Dorée, située au niveau de l’aile nord du château, sera résolue
à partir de la cour d’honneur dont la fontaine monumentale, gravée de 4 G
inversés en était symboliquement le Centre Gravité. De toute évidence,
il découlera de cet exercice de Géométrie Sacrée un pentagramme, une
étoile à cinq branche Il
en résulte une approche nouvelle faisant de ce Château Renaissance un « Nouveau
Temple » plus qu’un Palais de plaisance archiépiscopal. Pendant des
milliers d'années, l’interprétation de la science par le sacré a été transmise
parmi des initiés au sein de sociétés secrètes. Mais ceci fera l’objet du
second volume. Des plans sur la comète En
1954, Elisabeth Chirol, auteur de l’ouvrage « Le
château de Gaillon, un premier foyer de la Renaissance en Normandie »[7], publiait dans le Bulletin
monumental[8] une étude
comparative sur un plan présumé du château de Gaillon retrouvé aux archives
départementales de la Vienne par M. René Crozet. Après
une analyse mathématique du document, elle en avait déduit qu’il n’y avait
aucune équivoque à son sujet. La superposition des deux plans (définitif et
présomptif) ne laissait planer aucun doute.
Il s’agissait bien d’un projet pour le château de Gaillon réalisé entre
1500 et 1502 (ou 1504) en Italie. Cependant, elle ne put découvrir le nom de
l’architecte, auteur du fameux plan. Avec
force de détails, elle nous persuade de la justesse de ses propos. Le plan
aurait été fait sous l’autorité de Georges d’Amboise, vice-roi du Milanais,
pendant la campagne d’Italie du roi Louis XII. Selon
elle, le cardinal abandonna le projet car les audaces du plan avaient effrayé
les maçons locaux. Notre
étude du nouveau modèle démontre qu’ils avaient de quoi être terrifiés car il
ne respecte en rien les spécificités de l’Architecture Sacrée. Aucun
point de symétrie n’est ordonné selon la Divine Proportion. Quelle que
soit la forme géométrique utilisée pour tenter de définir la Section Dorée,
les tracés sont anéantis par un de centre gravité excentrique. Carré,
pentagone, triangle, rectangle, toutes formes ne désarment pas contre
l’ascendance cosmique de leur destinée. Le superstitieux aidant, nous concevons
mieux à présent les raisons du renoncement des maçons du XVIe siècle. Car dès le Moyen-Âge, le château de
Gaillon fut un terrain propice pour les guildes de bâtisseurs et leur vocation
initiatique profonde. Deux tours sur un échiquier Alors,
faut-il voir dans la construction médiévale du Castel Gallioni
une quelconque influence occulte ou d’occultistes ? Ce qui vient d’être
exposé le prouve indéniablement. La suite tout autant !... Dans
le Château de Gaillon médiéval les tours du pont-levis, Job et Baudet, orientées
vers le Midi, rappellent étrangement Joachim[9] et Boaz, les
deux colonnes situées à l’entrée du Temple de Salomon soumises à
la vigilance de maître jacques. Joachim
et Boaz furent reprises
dans les rites et symboles franc-maçonniques (J - B) du XVIIIe
siècle. On
ne connaît pas vraiment la date de la construction des deux tours
gaillonnaises. On peut juste l’estimer vers 1262, époque où le château passa
entre les mains d’ Eudes Rigaud, archevêque de Rouen. Ainsi la référence
biblique au livre de Job nous remet en mémoire le verset 11.-12 où il est dit
en substance que l’homme doit apprendre pour ne pas rester dans l’ignorance tel
un onagre[10] ayant la tête creuse. Sans
sauter du coq à l’âne et sans déraper car il n’y a pas qu’un âne qui s’appelle
Martin, les tours du château médiéval de Gaillon, Job et Baudet,
marquent l’affiliation d’une confrérie d’initiés : les tanneurs,
que nous retrouveront bientôt à Gisors[11], ayant pour
patron saint Martin. C’est ici l’Ordre
connu sous le nom de martiniste. Le
terme « martiniste » est un peu fourre-tout. Il a englobé des
groupements assez divers, mais ayant tous en commun une notion particulière de
la spiritualité chrétienne. Selon la rumeur, Bérenger Saunière aurait été membre d’une Loge martiniste
lyonnaise. Il n’y a malheureusement rien pour le prouver. Louis Claude de
Saint-Martin fut l’un des pères, sinon le père, fondateur de la doctrine
martiniste. Disciple de Martinez de Pasqualy, il
recruta vite des membres dans de nombreux pays au XVIIIe
siècle. Ainsi le voit-on tendre ses filets dans la région gaillonnaise : « J’ai
revu, dit-il, depuis Mr de Pontcarré à Rouen et chez
M. d’Etteville près de GAILLON, où je fut bien fâché de ne
pouvoir rester que trois jours, parce que j’avais l’espoir d’y défricher
utilement quelque terrain. »[12] Saint-Martin ne fut pas le seul occultiste à
s’intéresser à la région. Un demi siècle plus tôt, le 18 mars 1697, la société
de la ROSE+CROIX, semble t’il, tenait séance à Gaillon. Nous parlons ici
de la Société fondée en Allemagne par Johan Valentin Andréa au XVIIe siècle et non du prétendu organe occulte
qui aurait vu le jour à Gisors en 1188, ni du grade maçonnique du même nom créé
par les loges au XVIIIe siècle. C’est une
lettre de l’abbé Nicaise[13],
en réponse à une demande de recherche sur des documents historiques émanant du
« frère très zélé » Leibnitz[14],
qui en fait foi. Nous publions un extrait manuscrit de la lettre nous ayant été
communiqué. Outre la documentation sur le concile de Bâle, les
motivations de Leibnitz restent assez floues quant à
la nature ses recherches historiques. Dans cette correspondance, on trouve
également une mention concernant une étrange médaille dite de Zénodore.
Les dernières informations recueillies sur celle-ci nous laissent dubitatif car
il s’agirait d’un talisman alchimique... L’histoire de Gaillon demeure donc la partie de l’énigme
la plus méconnue. Ajoutons qu’en 1404, l’archevêque Louis d’Harcourt fit placer
une statue de saint Michel[15]
entre les deux tours. Les textes maçonniques datant de l’époque des compagnons
bâtisseurs disaient que Dieu fut le premier maçon (le grand architecte)
puisqu’il créa la lumière (que la lumière soit : fiat lux, la devise de Georges d’Amboise puis de Gaillon) et qu’il nomma
l’Archange saint Michel grand maître de la première Loge[16].
Le tableau ou plutôt le tablier maçonnique
serait incomplet si nous omettions de mentionner les multiples sièges de l’Échiquier de Normandie au sein du
château de Gaillon. L’Échiquier était une cour de
justice itinérante dont l’origine est confuse ; elle proviendrait des pays
germaniques. Elle fut réformée par Georges d’Amboise. Des colonnes J
et B du temple de Salomon, de la
représentation de saint Michel ou de l’échiquier, nous découvrons dans le
château Gaillon, dès la fin du XIIIe
siècle, les symboles des fraternités maçonniques organisées en 1717. Extrait de « Mémoires
des deux cités T. I et T.II, Gaillon Historique et
Mystique » et mise à jour . © Thierry Garnier – M2G éditions, 2004/2005-2007
Cette nouvelle édition est illustrée d'une centaine de photos et documents, dont 40 INEDITS, 4 cartes et 1 tableau chronologique (en N&B à la différence de la première édition numérotée parue en novembre 2005). Vous y découvrirez les 11 preuves rattachant la Normandie aux énigmes du Languedoc et révélant ainsi des aspects ignorés de l'affaire de
Rennes-le-Château. Gravures, peintures, monnaies anciennes, documents généalogiques et boiseries sont ici dévoilées et disséquées, vous invitant au voyage en Terre
Inconnue.
[1] Encyclopédie Encarta 98. [2] F.°.M, un des
thèmes traités dans le second volume. [3] Adolf Zeising
(1810-1876), docteur en philosophie et professeur à Leipzig puis Munich, parle
de "section d'or" (der goldene Schnitt) et s'y intéresse non plus à propos de géométrie
mais en ce qui concerne l'esthétique et l'architecture. Il cherche ce rapport,
et le trouve (on trouve facilement ce qu'on cherche) dans beaucoup de monuments
classiques. C'est lui qui introduit le côté mythique et mystique du nombre
d'or. [4] Aperçus sur la géométrie sacrée, Pierre Marçais et
Denise Rey, éd. G.uy Tredaniel,
1998. [5] Cf : Fra Luca Pacioli, un moine professeur de mathématiques qui a
écrit De divina proportione
("La divine proportion") vers 1498. [6] Ce Nombre d’or est égal à 1,618. On le désigne par la lettre grecque «phi» en hommage au sculpteur grec Phidias (490 -
430 avant J.C) qui décora le Parthénon à Athènes.
C'est Théodore Cook qui introduisit cette notation en 1914. [7] Le Château de
Gaillon par Elisabeth Chirol, Ed Picard, 1952. [8] Bulletin
monumental 1958 n°3, Orléans, chez M. Pillaut. [9] Jakin ou Jaqin en hébreux. [10] Âne sauvage. [11] Voir le pilier des tanneurs dans l’Église Saint-Gervais et Saint-Protais de
Gisors. [12] Saint-Martin,
le philosophe inconnu, par Jacques Matter, éd Didier
& Cie, 1862, p.80. [13] Fragments
Philosophiques, T.II, par Victor Cousin, lib. Ladrange, Paris,
p.277. [14] Gottfried Wilhelm von Liebnitz
(1646-1716), bibliothécaire, mathématicien et philosophe allemand. Agé de 20
ans, il se fait Rose+Croix en 1666. [15] L'Archange saint
Michel par ses qualités de Messager remplaça rapidement Mercure - Thot Hermès. [16] Synonyme respectivement de Tubal-Caïn et d’Hiram, la Franc-maçonnerie oubliée, R. Ambelain.

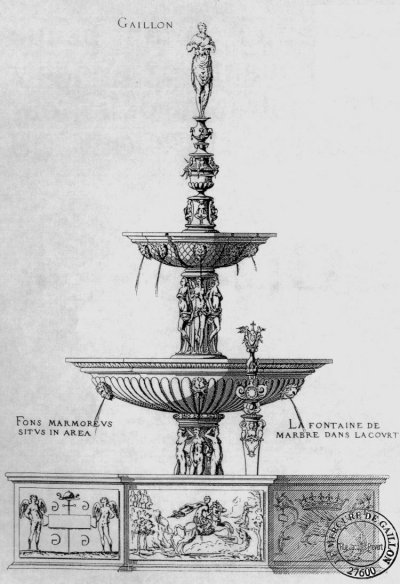

Cliquez sur la photo pour visionner la vidéo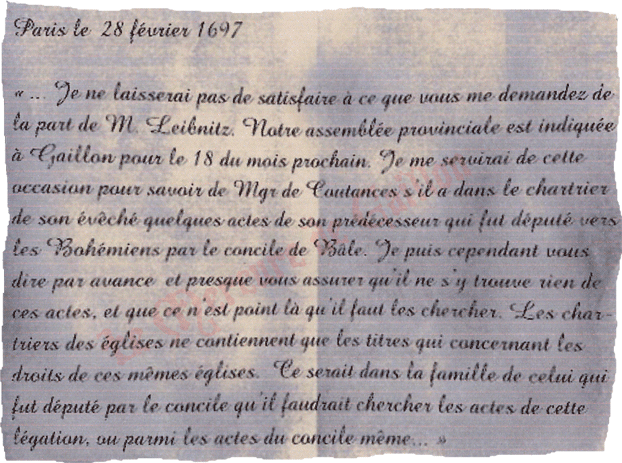
De la
franc-maçonnerie à l’alchimie, nous n’avons pas beaucoup le temps de souffler et le dragon a encore des
secrets à confesser.

Seconde Edition de "Mémoires des deux cités, T2 - Gaillon mystique"
La face cachée de l'histoire de Gaillon, qui vous sera contée ici, va vous révéler des évènements que nul n'a su découvrir et dont certains ne voulaient entendre parler.
A Gaillon comme ailleurs, quand les pierres parlent on les fait disparaître. Mais les murs ont des oreilles et ils raisonnent encore aujourd'hui des frasques et complots en tout genre qui ont modelé la France d'hier… jusqu'à aujourd'hui.
L'œuvre de Maurice Leblanc n'a-t-elle été qu'une suite de romans populaires ? Ou Arsène Lupin et ses autres héros furent-ils des faire-valoir désignés pour crypter et délivrer un message codé connu de quelques sociétés secrètes ?
Cet ouvrage s'adresse à tous les passionnés férus d'énigmes historiques. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les mystères de Gaillon et du pays de Madrie se mêlent à l'affaire de Rennes-le-Château, dans l'Aude, dont le curé Bérenger Saunière s'enrichit soudainement dès 1891.
Maurice Leblanc, fin connaisseur de l'histoire de la France secrète, a introduit et codifié ces énigmes dans sa trame romanesque. La CLEF, passe-partout capital que nous avons découvert, nous permet maintenant d'ouvrir la porte de la Demeure Mystérieuse afin de percer les véritables secrets de l'Aiguille Creuse en passant par l'île aux trente cercueils ou Dorothée danseuse de corde…
Info chez M2G éditions, 41 rue Jacques Prévert, 27600 Gaillon
