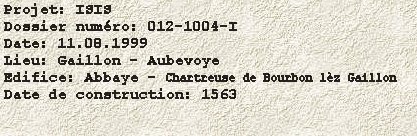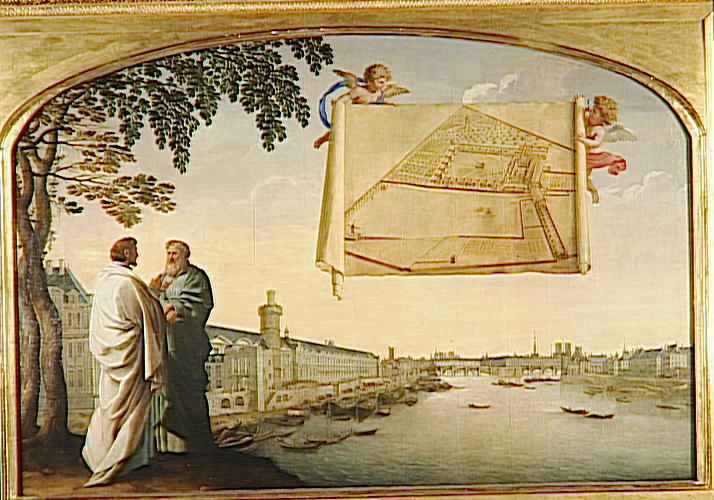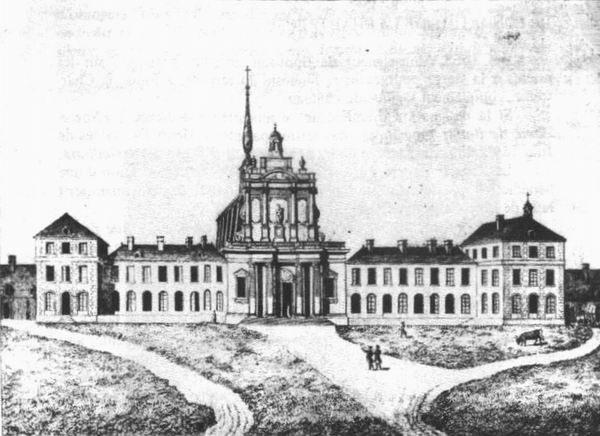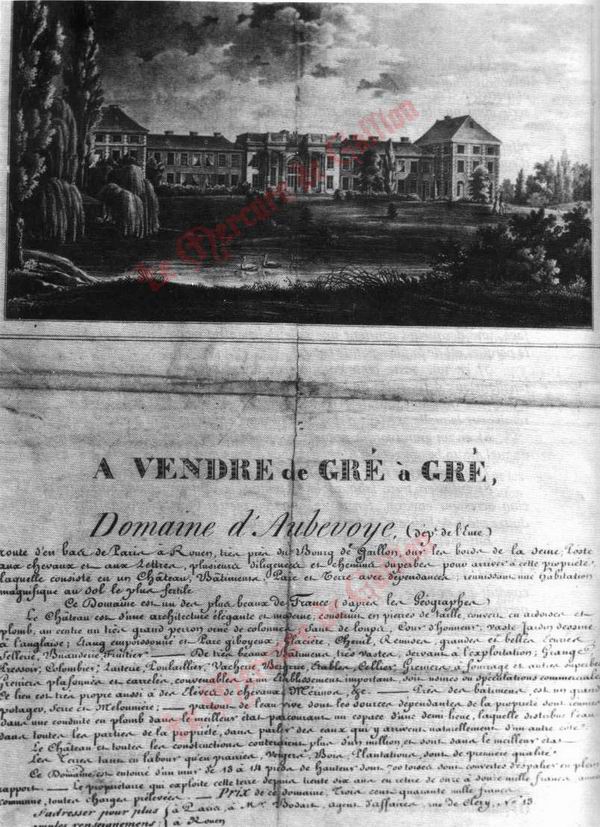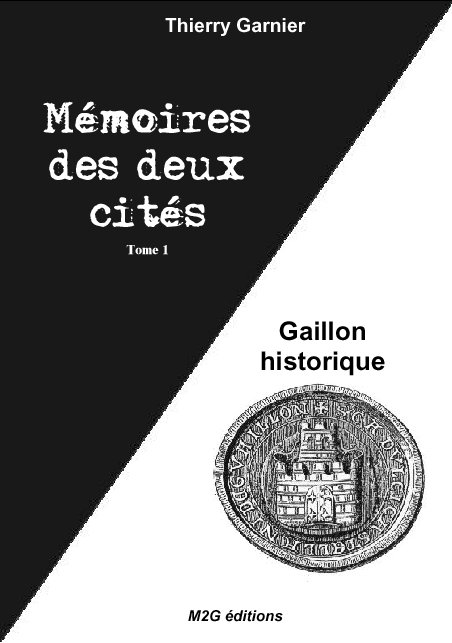L a Chartreuse de Bourbon lez Gaillon- 1563-1831 - Retour aux sources de la chrétienté Le
XVIe siècle est marqué par la réforme. Calvin et Luther font des
émules en Normandie. Le cardinal Charles de Bourbon, archevêque de Rouen,
voulait lutter contre l'hérésie protestante non par les armes mais par la
prière. A cette fin il fit édifier la Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon, sous
l'invocation de Notre-Dame de Bonne- Espérance. Les premiers plans, réalisés
sous la direction du cardinal, devaient voir naître ce monastère près de Louviers,
à la lisière de la forêt de Bord. Il en fut décidé autrement. Pour des raisons
pratiques, la Chartreuse fut construite en bordure de Seine tout proche du Château de Gaillon.
L'archevêque confia les travaux à Pierre Marchand, architecte très apprécié. Ce
dernier adopta une architecture sobre, le style toscan, excluant de fait tout
ornement. Le
27 mai 1563, accompagné par les évêques d'Evreux et de Nantes, Charles de
Bourbon posa la première pierre de l'édifice après avoir consacré cet
emplacement à Dieu. Les travaux de construction de l'église furent conduits
avec une telle rapidité qu'elle fut achevée en moins de deux ans. En même temps
que l'église s'élevait, les cloîtres, 1e réfectoire et les cellules du
monastère s'édifiaient. Dès sa naissance l'abbaye fut adoptée par l'ordre des
Chartreux. Dans une véritable charte de fondation, l'archevêque de Rouen
offrait cette maison au révérend Prieur Général et à tout l'ordre des
Chartreux. La charte de la Chartreuse est ainsi rédigée : Charles,
cardinal de Bourbon, primat de Normandie et légat d'Avignon, à MM. les RR. PP.
Prieur de la Grande Chartreuse et vénérable définiteur du Chapitre Général de
l'Ordre des Chartreux à célébrer en la présente année, salut.
Comme
ainsi soit que nous ayions commencé à faire bâtir et édifier une maison
monastère et couvent de votre Ordre, près notre château de Gaillon, au diocèse
d'Evreux, à l'honneur de Dieu et de la glorieuse Vierge Marie, que nous
désirons être appelé Notre-Dame de Bonne-Espérance pour l'espoir que nous avons
que, par son intercession, 1es hérésies du royaume soient extirpées, pour en
icelle mettre et entretenir à toujours un prieur avec vingt-quatre religieux,
pour la dot et fondation desquelles nous avons déjà acquis six cents acres de
terre et plus qui font 900 arpents mesure de France appelée la Cornehoc, assise
et enclavée dans lesdites terres et aussi, avec l'union du prieuré de
Saint-Jacques du Val des Malades, diocèse de Rouen, à la collation du roi ayant
obtenu la dite cession de Sa Majesté à perpétuité, pour la dite Chartreuse qui
se montera tout ensemble à la valeur de 4 000 tournois de revenu annuel. Nous
avons aussi donné et assigné 10 000 tournois par an, payables en quatre termes,
pour yceux I0 000 être fournis ès mains du prieur des Chartreux de Paris par
l'admis duquel l'œuvre du bâtiment se poursuivra et laquelle somme de 10 000
par an nous espérons aussi, avec l'aide et la grâce de Dieu, continuer par
chacun an jusque la perfection et consommation dudit monastère. A
cette cause nous désirons et nous requérons qu'il vous plaise dès ce présent
recevoir et incorporer en votre dit Ordre la dite maison, couvent et biens, que
par cette lettre nous vous présentons, pour être réglés sous votre charge et
selon vos institutions, statuts et profession et en icelle promouvoir pour
prieur la personne de vénérable dom Jean de Billy, à présent du prieur de la
maison de Mont-Dieu, vous priant pour fin être continus en vos bonnes prières
et oraisons. A Paris, le 21 avril 1571 Le
Chapitre général de l'Ordre des Chartreux accepta l'offre du cardinal de
Bourbon, en sa séance du 14 mai 1571. Dans une lettre, transcrite au
cartulaire, le chapitre remercie le cardinal et le loue de sa munificence. II
reconnaît que cette fondation est un signe, que Dieu daigne les prendre en
pitié, venant après les calamités qui ont frappé en France les églises et les
monastères, et en particulier ceux des Chartreux. Ainsi fut fondée la
Chartreuse de Notre-Dame de Bonne-Espérance pour vingt-cinq religieux, y
compris le prieur. Le Désert habitable Cette
chartreuse fut édifiée dans un enclos de 24 acres et demi de terres fermé de
murailles. A proximité de cet enclos un lot de 20 acres de terres divisé en 29
pièces, et un autre lot de 6 acres divisé en deux, leur avaient été concédés. Cinquante
acres au total formaient le domaine de la Chartreuse de "Gaillon-lèz-Bourbon".
Son revenu était évalué à 14 000 livres par la lettre du cardinal. Sur ce
revenu, 4 000 livres représentaient le revenu des terres du prieuré de St
Jacques. Les 10 000 livres restantes devaient être versées au prieur de Paris
chargé de poursuivre l'œuvre de construction. Pour
venir en aide aux bâtisseurs, le cardinal avait obtenu du roi l'autorisation de
faire enlever les pierres et matériaux qui restaient sur les ruines du petit
château fort du Goulet, sur l'île aux bœufs, construit par Phillipe-Auguste
dans les années 1190. Certains historiens affirment que c'est ce château de
l'île du Goulet qui aurait donné l'adjectif "Orgueilleux" au
village de Pressagny, de l'autre côté de la rive de la Seine. Les Chartreux
envoyèrent un bac pour chercher ces pierres. Le marinier qui le conduisait fut
arrêté par les officiers de Vernon. Le cardinal de Bourbon s'en plaignit au roi
Charles IX qui, par lettres royales signées à Chenonceau le 1er septembre 1571,
fit savoir au Lieutenant de Vernon, au procureur du roi et aux autres
officiers, qu'il avait donné ces matériaux aux Chartreux de Gaillon et qu'il
leur permettait de les prendre et de les emporter, en leur signifiant qu'ils
devaient rendre la liberté au marinier. Pour poursuivre les travaux, les
Chartreux durent vendre une partie de leurs terres : 688 acres étaient
situées à Longueville, (St-Pierre-d'Autils), St-Just, Hennezis et St-Marcel.
Ils employèrent le produit de cette vente non seulement pour la poursuite des
travaux mais aussi à la recherche d'eau de source et aux travaux de
canalisation. Pendant 50 ans, de 1602 à 1652, les Chartreux obtinrent des
habitants de la paroisse des sacrifices considérables pour l'approvisionnement
de l'abbaye en eau. Ils le firent le plus souvent à l'amiable, quelquefois par
voie judiciaire. Ils prospectèrent la colline, pour découvrir des sources, les
capter, construire des aqueducs, établir des regards et des tuyauteries amenant
ces eaux à la Chartreuse. Vers
le milieu du XVIIe siècle la Chartreuse semble achevée. Dès 1575,
les Chartreux firent l'acquisition de pièces de terre, nécessaires pour
agrandir le domaine. Deux chemins traversaient ces terres, l'un allant
d'Aubevoye à la Garenne, l'autre de Gaillon, à partir des jardins du bas, à
Courcelles. Dans une lettre patente de juillet 1627 la Chancellerie de Rouen
accorda aux Chartreux le droit de déplacer ces chemins puis de clore leur
monastère par de grands murs. Pendant 30 ans les murs restèrent construits à
mi-hauteur, les Chartreux ne pouvant faire mieux. Le 19 avril 1657 les
dernières pierres de ces grands murs furent posées. Les
éloges de cette abbaye sont innombrables. Dans des manuscrits rédigés en latin,
Dom Calliste dit que cette Chartreuse était édifiée dans une plaine aussi belle
et agréable à la vue qu'elle était saine et commode à l'habitation. Solitaire
dans la vallée, édifiée au milieu d'un grand parc, avec son église, ses
bâtiments, ses cloîtres et ses cellules, la Chartreuse ressemblait à une oasis.
Sa végétation conservait la fraîcheur qui lui venait de la Seine. Les sources
abondantes dans cette région entretenaient, jusqu'au sommet de la plupart des
collines, une fraîcheur qui donnait au paysage un aspect vert et riant. C'était
bien, en effet, une oasis. Une oasis d'où s'élevaient sans cesse vers Dieu les
prières des religieux, pour attirer ses bénédictions sur la contrée et sur la
France. In robore fortuna La
Chartreuse était située à un kilomètre du château de Gaillon, qui la dominait.
C'était, disait-on, la plus belle Chartreuse du royaume de France. Un dessin en
couleur, conservé aux archives de l'Eure[1], la
reproduit dans toute son étendue. Ce dessin remarquable dont nous reproduisons
quelques extraits ci-dessous (de médiocre qualité) est attribué à Jean Lemaire, dit
Lemaire Poussin, ce surnom lui avait été attribué car il était le premier
assistant du peintre andelysien Nicolas Poussin. Ce plan représente une vue
aérienne générale de la Chartreuse.
Elle
est entourée de ces hautes murailles formant un parallélogramme de 60 hectares.
Sa façade est au Midi, la Seine coule au bord de son enceinte. Vers le centre
se trouve l'église. A droite, côté évangiles, le petit cloître communiquant
avec l'église, le réfectoire et le chapitre. Les cellules sont reliées entre
elles par le grand cloître. Un peu en avant du petit cloître se trouve le
bâtiment destiné aux visiteurs. En arrière de l'église, côté épître, à l'entrée
du jardin, deux constructions élevées et spacieuses, formant le corps de ferme
seul vestige existant encore, sont affectées à l'engrangement des récoltes.
D'autres bâtiments sont disséminés çà et là. La partie que traverse un ruisseau
(la Ravine), venant des hauteurs surplombant Gaillon, est un champ cultivé. De
grandes plantations d'arbres fruitiers, des pièces d'eau, des pelouses et de nombreux
bosquets agrémentent l'ensemble merveilleusement. La
porte était encadrée de deux corps de logis servant de conciergerie. Au-dessus
de cette porte, on pouvait lire : La "Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon".
Cette mention était accompagnée de trois écus : le premier de France, à droite
celui du cardinal de Bourbon et à gauche celui du comte de Soissons. Une avenue
partait de cette porte, bordée de chaque côté par une double rangée d'arbres et
d'un fossé d'eau vive. A deux cents mètres environ, cette avenue était coupée
par une grille surmontée d'une croix. Cette grille prenait appui sur le mur
constituant le clôture intérieure du monastère.
L'église
de la Chartreuse mesurait 170 pieds de roi de longueur (56 m), 34 pieds de
largeur (11 m) et 32 pieds de hauteur (10 m). Ses murs étaient construits en
briques peintes de vermillon. Sa voûte était divisée en neuf arceaux
entièrement composés de pierres choisies et taillées. Elle était lambrissée de
pièces de bois. L'histoire raconte qu'un bois entier a dû être abattu pour en
assurer la construction. Douze chapelles semblables, ayant chacune son autel,
étaient réparties proportionnellement de chaque côté : six à droite et six
à gauche. Le
maître-autel[2] principal était orné de chaque
côté d'un autel plus élevé, suivant l'habitude de l'ordre des Chartreux. Son
retable était d'une riche architecture embelli par de belles colonnes de marbre
noir. Il était appuyé contre le mur du chevet, qui est arrondi en demi cercle. Derrière
le retable de l’autel du chœur, on pouvait lire, gravé sur un marbre noir: "Ce
grand autel de marbre noir et de marbre blanc, et le tombeau qui est dans le
chœur de l'église de cette Chartreuse de Bourbon, ont été faits des charités et
libéralités de haute et puissante princesse Mme Anne de Montafié veuve de très
haut et très puissant prince Charles de Bourbon , comte de Soissons, neveu de
monseigneur Charles, prince cardinal de Bourbon, fondateur de cette Chartreuse,
et le dit autel fut parachevé, l'an 1650". Un
Saint Jean-Baptiste était placé à l’autel du chœur coté évangiles et une Sainte
Catherine côté épîtres. Quarante-deux
hautes chaires avec un grand espace pour le cancel le meublaient. Les armoiries
qu'on y observait et en d'autres endroits étaient de France avec la barre de
droite à gauche. Elles avaient pour ornement une croix à deux traverses avec le
chapeau de cardinal. La partie supérieure était occupée par les Pères, et une
partie inférieure destinée aux frères convers, comportant chacune son autel particulier.
Au
total on dénombrait dix-huit autels tous plus beaux les uns que les autres.
Vitraux, tableaux, et matériels liturgiques d'or et d'argent en tout genre
achevaient la décoration intérieure. L'église fut consacrée le 1er septembre
1652 par Egide Boutault, évêque d'Evreux. Dans une armoire de la sacristie il y
avait un grand nombre de reliques : + Un reliquaire
d'argent doré, placé sur un pied de cuivre doré + Un cristal en
bosse enfermait une tête dont la bouche faisait voir un morceau de la mâchoire
de Saint Jean Baptiste, dans un cercle orné de pierreries + Une croix de
cristal de roche avec deux chandeliers de même. + La chapelle
portative du cardinal de Bourbon en une petite église rectangulaire avec son
toit au dessus, le tout orné de petites figures d'or massif et semé de fleurs
de lys avec la barre ou bâton entre quelques unes (qui sont les armes des
Bourbon). + Une croix
pectorale en or. + Sous un cristal
est un morceau de la vraie croix. + Et dans plusieurs
reliquaires de saints où sont rédigés en latin les noms de : S. Cruce
de N. S. J. C, de S. Corona ejusdem, de Sanguine ejusdem imbibé dans une
éponge, de S. Sudario; de Bombice quo extersa sunt vulnera ejusdem ; de Vinculis
quibus ligatus fuit idem, D. J. C.; de Capillis B. M. Virginia, de Zona,
chlamyde et Veloejusdem; de SS. Apostolis Petroet Paulo, Matthœo, Philippo,
Matthiâ, de Camisiâ S. Johannis évangelistae et capite S. Jambi, de S. Marco,
de S. Barnaba, de S. Bartholomeo, de SS. Stephano, Dyonisio Areopagita, S.
Vincentio, Levita et martyre, S. Laurentio, S. Sébastiano et de S. Euphemia,
virgine et martyre, de S. Théodore martyre, de S. Colomba, virgine et martyre ;
de Ossibus, S. M. Jacobi, de S. Martha Virgine. Un pas vers le coffre-fort des moines Dom
Mignot en était le prieur à cette époque. Les règles de vie des Chartreux
étaient très strictes : isolement perpétuel, un silence quasi absolu.
L'abstinence absolue de viande et le jeûne fréquent complétaient la règle même
en cas de maladie grave. Ils s'habillaient d'une robe de drap blanc, serrée par
une ceinture de cuir, avec une capuche. Ils sont toujours porteurs du cilice et
ont les reins ceints d'une corde pour se mortifier. Ils se consacraient à la
vie contemplative et à quelques travaux manuels. Certains moines s'adonnaient à
la culture des lettres, des arts et de la science. L'effectif d'un monastère se
composait d’un prieur, qui régit les religieux de la communauté, du vicaire
remplissant les fonctions de prieur en l'absence de celui-ci, du procureur
chargé des intérêts temporels de la maison, du sacristain à qui est confiée la
tenue de la sacristie, du garde des archives, d'un ou de plusieurs coadjuteurs
et adjoints, et des religieux proprement dits. Toutes les fonctions sont
électives. On donne le nom de profès à ceux qui font vœu de s'engager dans
l'Ordre, après être passés par le noviciat. Des domestiques sont attachés au
service de la maison et des religieux. Le roi imposait aux monastères
l'entretien des soldats invalides. Ceux-ci portaient alors le nom de Frères lais,
d'oblats ou de Frères donnés. Chaque année, la Grande Chartreuse, à laquelle
sont affiliés tous les monastères de l'Ordre, envoyait des visiteurs auprès de
ceux-ci pour s'assurer du maintien de l'observation de la règle commune.
Au
fil des années leurs possessions terriennes avaient considérablement
augmenté . Ils détenaient des fiefs et leurs dépendances un peu partout dans la région : §
En
1572 ils avaient acquis le prieuré de St Pierre de Launé à Radepont (Eure) et
celui de Saint Germain de Morgny. §
En
1575, c'était au tour du prieuré de Genneville près de Magny-en-Vexin (95) de
tomber dans leur escarcelle. §
En
1576 la chapelle de Saint-Fiacre d'Aubevoye. §
En
1582 tout le domaine
de Bethléem qui venait d'être érigé par le cardinal de
Bourbon sur les hauteurs d'Aubevoye. §
En
1583 la seigneurie voisine de Courcelles par le payement d'une somme de 20 000
livres et 300 écus §
En
1584, la seigneurie de Port-Mort et le fief de Roquemont à Villers-en-Vexin §
En 1597,
l'abbaye de Sainte-Catherine de Rouen avec les seigneuries de Caudecoste,
Dieppe, Appeville, Cannehan dépendant de la viconté d'Arques (la Bataille),
Carville, Limanville, Boscadan et la baronnie de Gruchy (76). §
Dans
le même temps, s'ajouteront les terres de Cahaigne, Fours-en-Vexin,
Requiècourt, Criquetot-d'Esneville, d'Anglesqueville l'Esneval, Saint-Vincent
de Nogent (76) et Giverville (14). §
En
1628, les pêcheries de Vernon (27) et la seigneurie d'Authevernes (95) §
En
1644, des biens à Montivilliers (76)
§
En
1646, le prieuré de la Chapelle aux Pots (60) §
En
1653, la seigneurie de Boisemont (27). Au XIIIe siècle le fief dépendait de la commanderie de Bourgoult. §
En
1703, le prieuré Sainte-Catherine de Bizy à Vernon (27) Bien
qu'étant incomplète, cette liste impressionnante mesure la puissance financière
de l'ordre des Chartreux à Gaillon. On estime son revenu annuel à 86 600 livres
en argent. Pour les 25 ou 28 religieux vivant dans cette enceinte, cette somme était
astronomique. Ils ne furent donc pas les seuls à profiter de cette manne
financière. Ils jouissaient également de libéralités assez
exceptionnelles : celles-ci allaient de la dispense du droit de péage sur
les grains, le vin et le bétail jusqu'au droit de "garde-gardienne"
(droit de justice de cette époque) entre autres. Sur
les actes authentiques dépendant de la Chartreuse de Gaillon on retrouve
parfois le sceau de l’Ordre cartusien de la grande Chartreuse. Lors d’une
association de prières entre les Chartreux de Gaillon et les religieuses
hospitalières de Saint-Jacques des Andelys ce sceau fut apposé dans un acte
écrit sur parchemin. Le sceau orbiculaire (ou rond) représente les instruments
de la passion avec cette légende : Un
second, tout aussi sphérique et ayant les mêmes attributs, comporte la
légende : Les
deux sceaux sont pendants et plaqués entre deux papiers en demi rond, découpés
en feston, attachés de ruban de soie rose. Sur le premier document, la formule
de « cancellation » est : "Scellé du sceau de l’Ordre, ce 14
mai 1723". Sur le second acte on peut lire : "Donné en
Chartreuse, le mai 1746".[3] L’établissement
de Gaillon était devenu au XVIIIe siècle fort important tant
financièrement que spirituellement, avec des bâtiments magnifiques dont le
cloître et l'église qui renfermaient une foule d'œuvres d'art et de riches
tombeaux.
Le mausolée des princes Charles
Ier de Bourbon, né en 1523, était le frère d'Antoine de Bourbon,
père d'Henri IV. II fut proclamé roi de France par la Ligue sous le nom de
Charles X. Son règne fut éphémère (trois mois) et celui que les Ligueurs
eux-mêmes appelaient le roi sans couronne, fut exilé à Fontenay-le-Comte, en
Poitou, où il mourut le 8 mai 1590, le jour même où les troupes royales
s'installèrent sous les murs de Paris. Son corps fut ramené à Gaillon. Il fut inhumé dans la Chartreuse tandis qu'une urne contenant ses entrailles fut conservée dans l'église de Fontenay-le-Comte. Une plaque commémorative fut apposée sur ce second tombeau. D'autres
princes de la maison de Bourbon y avaient également leur sépulture, notamment
Charles de Bourbon-Soissons[4], qui
s'était distingué à la journée de Coutras, en 1587, et décéda le 1er
Novembre 1616. Anne de Montafié, sa veuve, lui fit ériger dans le chœur de
l'église, un tombeau en marbre, où elle fut elle-même inhumée, avec deux de ses
enfants. L’épitaphe du tombeau disait ainsi: "Charles de Bourbon, comte
de Soissons, pair et grand maître de France, gouverneur du Dauphiné et
Normandie, très pieux, très sage et très vaillant, mourut l'an MVICXII, le 1er
novembre âgé de XLVI ans". Leurs statues figuraient couchés sur ce
sépulcre, tête couronnée et fleurdelisée ouverte. Etendues sur le dos avec les
mains jointes, un coussin sous la tête, l’effigie de l'homme avait un lion sous
les pieds avec la gorge couverte d'une fraise un peu évasée sur le devant. Aux
quatre coins des faces collatérales de ce monument, de son ciseau son équerre
et son compas, le sculpteur a gravé leurs chiffres entrelacés de cette
manière. Ce sont deux A dont l'un est renversé ainsi A
la face qui regarde l'autel, il y avait un piédestal pareil au précédent, il
portait deux anges qui avaient leurs mains gauches et droites appuyées sur deux
gantelets tenant un linge. Un marbre noir au dessus portait: "Anne de
Montafié, comtesse de Soissons, femme de très haut et très puissant prince,
Charles de Bourbon, princesse douée de toutes les vertus fist faire ce tombeau
l'an MVIe XXXIII et mourut l'an MVIeCXLIII, âgée de LXVII
ans". Au-dessus de cette inscription, un marbre blanc blasonnait : parti
au 1er de France avec le bâton péri, au 2e chargé d'un
lion couronné et surmonté d'un croissant tourné en dehors et rempli d'une
étoile en son vide (sic). Sur
la face collatérale côte évangiles, on y voyait aussi les tombeaux de Charlotte
Anne de Bourbon. Un gisant présentait la princesse allongée, soutenue sur son
bras gauche et tenant de sa main droite un livre posé sur sa cuisse droite et
sous son coude gauche était placé un coussin. Elle était vêtue d'un corps de jupe
orné d'un fil de perles à trois rangs descendant de haut en bas sur le milieu
de la robe et tournant sur les reins en forme de ceinture. Une inscription était
enchâssée dans un marbre indiquait : "Charlotte Anne de Bourbon, leur
fille très aimée et très estimable, mourut l'an MVIe XXIII, âgée de
XXVI ans. Ses vertus surpassaient son âge". A
la face opposée, côté épîtres, une urne de marbre blanc ouverte présentait un
coussin fleurdelisé sur lequel était couché un petit enfant enveloppé d'un
lange aussi fleurdelisé et un piédestal de marbre blanc. On pouvait y lire,
écrit en lettres d'or : "Elisabeth de Bourbon leur fille mourut l'an
MVICXI, âgée de un an, heureuse d'être morte en l'état d'innocence". Le
caveau des princes et princesses inhumés dans la Chartreuse accueillait aussi les
dépouilles de Marie de Bourbon, de Louise-Christine de Savoie-Carignan,
d'Eugène-Maurice de Savoie, mort à Unna, en Westphalie le 8 juin 1673 et de sa
sœur Anne-Marie,Françoise de Savoie, dite Mademoiselle de Dreux. On conservait
dans l'église le cœur de Louise de Bourbon-Soissons, épouse du duc Henri de
Longueville, morte le 9 septembre 1639 ; à côté se trouvait le corps de
son frère, Louis de Bourbon-Soissons tué à la bataille de Sedan en 1641, qu'il
avait gagnée contre l'armée du roi. Après, venait la dépouille de sa sœur,
Marie de Bourbon-Soissons, veuve de François de Savoie, prince de Carignan,
morte le 3 Juin 1692, âgée de 87 ans. Toutes les sépultures et monuments furent
anéantis dans les incendies qui allaient survenir. Le coup de feu 
La
vie s'écoulait paisiblement dans ce havre de paix jusqu'à ce qu'un jour de 1696
un premier incident intervienne; la foudre tomba sur le clocher de l'église qui
fut en partie détruite. Elle fut reconstruite en très peu de temps. En 1764, la
Chartreuse fut à nouveau attaquée par les flammes. Cette fois presque toute
l’abbaye partit en fumée. Mais grâce à de grands sacrifices, et à la vente de
propriétés leur appartenant, les moines purent songer à sa réédification à
partir de 1769. L'architecte Helin fut chargé de la reconstruction de la
nouvelle Chartreuse. Les travaux furent achevés le 18 septembre 1776. Elle fut
consacrée par Mgr de La Rochefoucault. C'est
à cette époque que les frères réunirent en un même tombeau les restes du
fondateur du monastère, ainsi que d'autres appartenant à la famille de Bourbon.
Les moines firent sceller par-dessus l'épitaphe de marbre, que l'on voit
aujourd'hui dans l'église d'Aubevoye. La bibliothèque
avait survécu aux deux incendies. Elle devenait de plus en plus importante. On
pouvait y trouver, parmi d'autres ouvrages du XVe siècle, des
manuscrits de saint Thomas d'Aquin provenant de la bibliothèque des rois de
Naples. Toutes les matières étaient représentées, même les plus insolites. Une
imprimerie avait même été implantée dans le monastère pour la reproduction de
ses propres oeuvres. La bibliothèque de Louviers possède quelques-uns de ces
manuscrits[5] et
autres curiosités. Voyez la notice associée à ce dossier. La
révolution de 1789 fut néfaste à ce monastère. En 1791 les biens du clergé
deviennent biens nationaux. Un inventaire avait déjà été réalisé en mars 1790.
Le 23 décembre 1791, elle fut vendue à un certain François Lefan pour la somme
de 37 100 livres. Mais Lefan ne respecta pas ses engagements financiers. Il y eut
une autre adjudication le 12 mai 1792. C'est
un certain Jacques, Juste Suard qui acquiert la Chartreuse pour la somme de
296 000 livres. Mais le 15 juin 1792 il la rétrocède à Louis-Nicolas Louis,
architecte et directeur des bâtiments du duc d'Orléans, franc-maçon,
grand-maître du Grand-Orient de France. Passé par la guillotine en 1793, le duc
n’en profita pas. La Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon devient alors le château
de famille des Louis. La fille de Louis-Nicolas, Hélène, en sera la dernière
châtelaine. Le 11 Janvier1834 c'est l'arrêt de mort de la Chartreuse qui sera
finalement achetée par M. et Mme de Dehaumont puis ensuite entièrement démolie :
l'église et les tombeaux même ne furent pas respectés. Les fondations furent
arrachées jusqu’à 1 m de profondeur afin de rendre le terrain cultivable. Le dernier refuge
Asile
sûr pour certains, trop doux pour d’autres, la Chartreuse eut aussi ses
apostats. Dom Nicolas Verson, ancien chartreux de Gaillon exilé pour
insubordination envers sa hiérarchie en 1722, n’hésitait pas écrire dans une
lettre[6] ;
"...Je dois donc embrasser avec joie le moyen que Dieu a daigné me
ménager de vivre en véritable Chartreux, car je n’aurai pu faire à Gaillon, où
j’étais trop bien. J’y avais une cellule fort commode, une bibliothèque
considérable et mille autres agréments...". Tous n’étaient pas de cet
avis. C'est
à la Chartreuse que Dom Bonaventure d'Argonne, mort en 1704, connu surtout,
pour plusieurs ouvrages d'histoire et de littérature, sous le pseudonyme de Vigneul-Marville,
séjourna longtemps. Le célébrissime peintre Eustache Lesueur, élève de Simon
Vouet et ami de Nicolas Poussin, y a composé une grande partie de la galerie de
St Bruno (en 22 tableaux) de la Chartreuse de Paris, conservé maintenant au
musée du Louvre. Parmi ceux-ci on remarquera le tableau où deux anges déroulent
et soutiennent dans les airs le plan de la Chartreuse [ci-dessus],
et le présentent au visiteur. Or quand on y regarde de plus près on constate la
similitude avec le plan de Jean Lemaire. Lesueur peignit cette toile pour
décorer le cloître des Chartreux de Paris nous dit-on[7], et
faire suite à ceux où il a représenté les principaux événements de la vie de
saint Bruno. Elle n'a cependant aucun rapport avec l'histoire du saint. Les
religieux de Paris auraient finalement insisté pour joindre à cette belle
collection le plan de leur monastère, le peintre ne voulut l'offrir que d'une
manière noble et pittoresque. Mais est-ce les religieux de Paris ou de Gaillon
qui firent cette démarche ? Que
devinrent les religieux quand l'abbaye fut saisie le 18 janvier 1791 ? Ils
étaient encore au nombre de 28 dont 16 frères et le prieur, 5 profès et 6
frères donnés. La majorité des moines se dispersèrent. Nous retrouvons trois
d'entre eux, le prieur Dom Emmanuel Ducreux, les frères Dom Dorothée Aubourg et
Dom Anthelme Guillemet au domaine de la Créquinière à Aubevoye où Dom Honorat
vint les rejoindre plus tard. Un
an avant la Révolution, le frère Ducreux écrivit une vie de saint Bruno en
français pour la Chartreuse de Gaillon[8]. Il y
mentionne plus de cent écrivains de l’Ordre de Saint-Bruno. E.
Ducreux et D. Aubourg prirent le chemin de l'Angleterre en 1792 et furent considérés
comme émigrés. En 1803, ils rentrèrent en France. Ils furent amnistiés et
jurèrent fidélité à la nouvelle constitution. Dom Dorothée Aubourg devint curé d'Aubevoye
en 1804 jusqu'à sa mort le 16 novembre 1827. Un autre homme, écrivain très connu
fuyant la Terreur, séjourna à la Créquinière avec les frères; il s'agit de
l'académicien Jean-François Marmontel. Il décéda et fut enterré à Habloville
(ou Abloville) le 31 décembre 1799, proche de Gaillon, où il s'était
définitivement fixé. Ses cendres rassemblées dans un cercueil de plomb furent
transférées, bon gré mal gré, dans le cimetière de St Aubin-sur-Gaillon le 6
novembre 1866. Une plaque commémorative fut inaugurée le 26 octobre 1899 en son
honneur. Droit d’inventaire 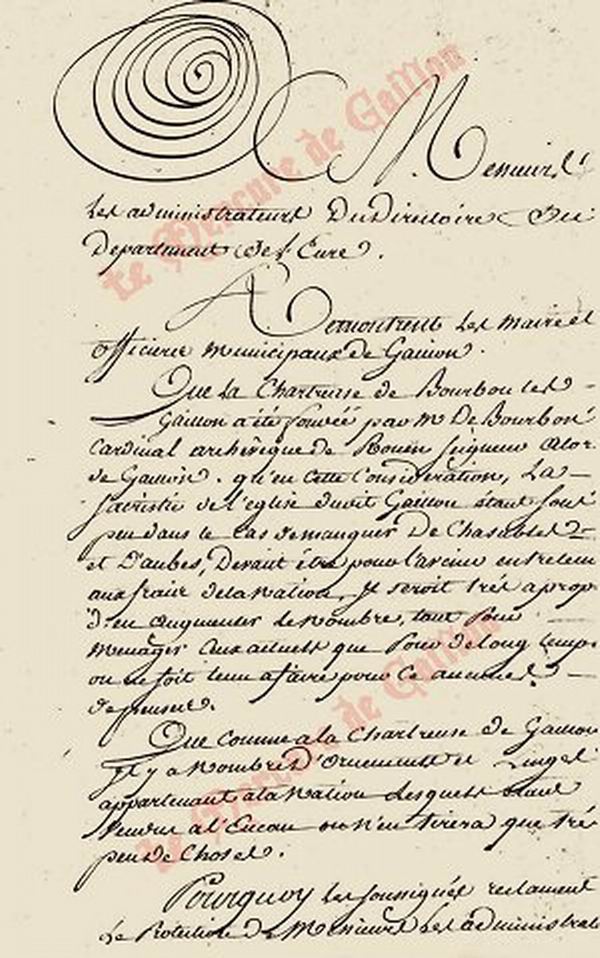
Les
œuvres d'art contenues dans l'église de la Chartreuse et le cloître étaient nombreuses.
On compte des œuvres des peintres Philippe de Champagne, dont une vision de
saint Bruno, et Eustache Lesueur, du sculpteur Nicolas Legendre ou Adrien Gois. Tout fut dispersé par la bande noire qui se jeta sur l'abbaye, comme une nuée de
vautours sur un cadavre. Quelques-unes néanmoins ont pu être sauvées grâce à de
bons esprits et figurent depuis ce temps dans quelques églises des environs: à
Aubevoye est la dalle sépulcrale et l’une des statues de saint Bruno sculptées
par Nicolas Legendre, artiste attitré de Nicolas Foucquet pour Vaux-le-Vicomte[9]. L'abbé Blanquart, curé de la Saussaye, avait attribué cette statue à Adrien Gois et la datait aux environs de 1770. Voici, ce que nous dit Millin dans sa notice de la "Chartreuse-lès-Gaillon" : "La grotte de saint Bruno servait de contre-table à l'autel; elle était sculptée par M. Gois, sculpteur de l'Academie, qui a fait aussi la Vierge du portail, et peinte par M. Machi".
Des notes de labbé Droui, curé d'Aubevoye viennent appuyer ces dires. Citant l'abbé Blanquart il nous révèle qu'un manuscrit de la bibliothèque de Rouen, contenant des relations de voyage en Haute-Normandie (de 1777 à 1779), donne quelques détails sur la Chartreuse et son église. On y lit, relativement au maître-autel et à la statue de saint Bruno: "Le maître-autel à la romaine est traité tout en marbre et excellent goût, les chandeliers en girandole dorés d'or moulu et tous les ornements de même. Au lieu d'un tableau au maître-autel, on a pratiqué dans l'arcade du rond-point, une grotte qui fait un très bel effet, ou on voit un saint Bruno à genoux, priant. Cette grotte, qui est en saillie en dehors de l'église, est éclairée par un lanternon qui ne paraît point, ce qui ajoute à l'illusion, sans interrompre l'uniformité qu'exige l'architecture". L'abbé Drouin ajoute : "Dans les Salons de 1769 et 1773, on trouve, sous le nom de Gois, et faisant partie de ses œuvres: - Saint Bruno en méditation. - L'apothéose du même saint (dessin au lavis). - Projet d'une chapelle de chœur de la Chartreuse de Gaillon. -Plusieurs dessins au lavis sous le même numéro. - Saint Bruno, statue pierre exécutée pour la Chartreuse de Gaillon".
Plusieurs autres modèles de saint Bruno, sous différentes postures, avaient été placés en divers endroits du monastère. Dans l'église de Gaillon on conserve toujours un maître-autel en marbre surmonté de trois angelots. Un inventaire de 1791 relève un aigle en cuivre formant un lutrin et l'horloge de l'église de la Chartreuse. Sans oublier le Christ en croix en ivoire d'inspiration janséniste dont nous parlons dans la notice de l'église de paroissiale. Tout ce mobilier fut transporté à Gaillon vers 1791, mais n'existe plus de nos jours.
Dans l'église de Saint-Aubin-sur-Gaillon sont les boiseries
sculptées du chœur de l'église de la Chartreuse comportant huit médaillons de
personnages de l'époque dont les noms sont inconnus. Certains y voient la présence
de Mgr François Ier Harley Champvallon ou encore Charles Ier
de Bourbon.
L'un
d'entre eux (celui à l'extrême gauche) pourtant laisse suggérer une
représentation de Jean Lemaire (dit Lemaire Poussin) l'assistant de Nicolas
Poussin venu s'abriter dans ces lieux jusqu'à la fin de sa vie. Il décéda en
1659 et y fut inhumé. A Vernon, nous retrouvons dans la collégiale le
maître-autel principal en marbre rose de toute beauté. Il est regrettable que
cet autel soit caché par des tentures en toile. Nous nous sommes laissé dire
qu'il prenait beaucoup de place dans l'église de Vernon et qu'il
"cassait" la perspective intérieure de l'édifice. Aux Andelys, le
visiteur pourra admirer une splendide mise au tombeau en marbre à l'échelle
humaine. Cette œuvre est attribuée à l'école de sculpture de Verneuil (27). Une
autre riche dépouille est l'autel de la chapelle de la Vierge, tout de bois
sculpté, garni d'un Jésus enfant au milieu des docteurs de l'Eglise. Cette
toile est attribuée à Eustache Lesueur. D'autres la donnent pour Jacques Stella
ami de N. Poussin. L'église de Saint-Julien-de-la-Liègue garde la grosse
cloche. Réduite
à néant, il ne restera rien des bâtiments prestigieux de ce qui fut appelé en
son temps "la plus belle Chartreuse de France". Le mur de clôture qui
suit la route de Gaillon aux Andelys, se poursuivant jusqu'à la Seine, en est
le seul et piètre vestige. Le corps de ferme, en fait quelques granges, a été
transformé en locaux d'habitation. Dans les années 1980, un lotissement prendra
la place de l'ancienne abbaye. Pour
conclure ce voyage historique, je vous propose de visiter maintenant la Nouvelle Galerie de St
Bruno virtuelle regroupant les quelques vestiges disséminés à travers la
région.
Thierry Garnier
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||