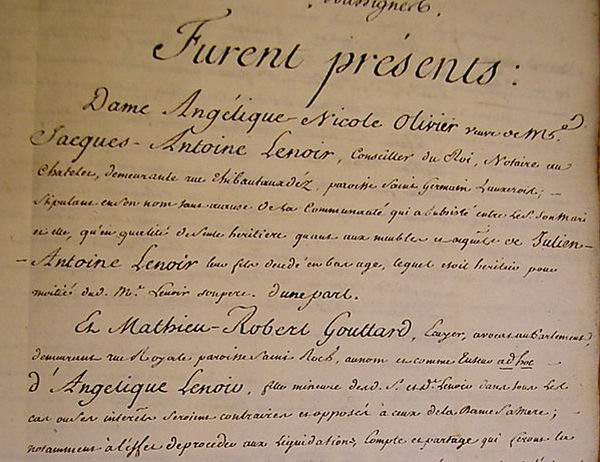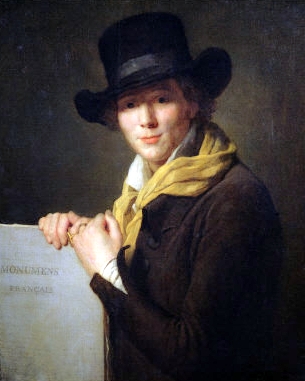Nous commencerons par Angélique (née le
18/11/1760), qui comme on a pu le voir précédemment était fille de Jacques
Antoine LENOIR, clerc du Notaire
MORIN dont l'étude était située rue Montmartre, Paroisse St Eustache. Celui ci n'exerça que 5 ans avant son décès le 17 août 1762[1], à l'âge de 37ans, laissant derrière lui 2 enfants mineurs :
Julien Antoine, décédé quelque temps après son père (4/11/1762) à l'âge de 3
ans et la petite Angélique alors âgée de 2 ans, ainsi que sa femme, Angélique
Nicole OLIVIER, 19 ans, aux bons soins de Julien Etienne OLIVIER Maître
Tabletier, père de cette dernière. Angélique Nicole n'avait en effet que 16 ans lors de
son mariage le 21 février 1759 à St Merry[2] avec Jacques Antoine LENOIR. La
mère de la mariée, Angélique TILLIARD décèdera aussi quelques mois plus tard le
27 mai 1759. C'est donc une vie difficile qui commencera pour la petite
Angélique, élevée dans ce quartier des
Halles, en partie par son grand-père et par les
grand-oncles et tantes tant du côté OLIVIER que du côté TILLIARD, sa mère étant
fille unique, Dans cette dernière famille, de nombreux cousins et pas des moindres. Angélique
est donc bercée par les Arts dès son plus jeune âge et elle a certainement
entendu raconter bien des histoires par son grand-père Julien Etienne OLIVIER,
fils de Jean OLIVIER et de Marie Anne LE BRUN, au sujet du peintre Charles LE
BRUN, "qui fit connoissance à Lyon avec le célèbre POUSSIN qui lui
accorda son estime & son amitié, & lui fit part de ses secrets de
l'Art, qui font le fruit d'un travail réfléchi & d'une longue
expérience" (et avec qui il partit à Rome en 1642), homonyme de son
arrière-grand-père. Il n'est pas impossible qu'il existe un lien de parenté, entre Nicolas
LE BRUN, père du fameux peintre, et le propre père de Charles LE BRUN,
arrière-grand-père d'Angélique LENOIR. Mais la tenue lacunaire des registres de
JOUY-SOUS-THELLE (Oise) en 1588, année de naissance de Nicolas, frère du
peintre Charles ne nous permet pas de confirmer cette hypothèse. En effet divers contrats passés entre 1724 et 1725 entre Jacques
Charles LE BRUN, greffier des Bâtiments, architecte, juré expert, cousin
germain de Marie Anne LE BRUN, grand-mère d'Angélique, et Charles LE BRUN,
auditeur en la Chambre des Comptes, légataire universel de Charles LE BRUN son
oncle, premier peintre du roi, témoignent néanmoins des bonnes relations qui
existaient entre eux. Une
quittance de 1727[5] nous indique en effet que
Jacques Charles LE BRUN est intervenu en qualité d'Architecte Expert dans les
travaux que Charles LE BRUN, neveu du peintre, fait exécuter pour les maisons
qu'il possédait Place Maubert, rue St Honoré, rue Mouffetard, Faubourg St
Marcel... la plupart provenant de son héritage. Le Peintre LE BRUN, dont la
fortune était considérable, avait en effet dès le début de 1651, put acheter
pour 7 000 livres une maison au faubourg Saint-Victor, sur le fossé entre les
portes Saint-Marcel et Saint-Victor, début d'une longue série d'acquisitions,
presque toutes dans le même quartier et souvent même attenantes. A sa mort, il
ne possédait pas moins de neuf maisons à Paris, un jeu de paume et deux
terrains à bâtir, pour une estimation totale de 110000 livres[6]
Rappelons
que LE BRUN, peintre de Louis XIV, était un ami intime d'Eustache LE SUEUR.
Tous deux élèves de Simon Vouet, et amis de Nicolas POUSSIN et malgré les
calomnies et bon mots qui en faisaient des ennemis jurés et dont Bonaventure
d'ARGONNE, entre autres, s'est fait l'écho, LE SUEUR fut néanmoins le parrain
de Suzanne LE BRUN (née en 1649), nièce du peintre, sa marraine étant Suzanne
BUTAY femme de LE BRUN. Rappelons
aussi que c'est à la Chartreuse de GAILLON qu'Eustache LE SUEUR composa une
grande partie de la galerie de St Bruno (série de 22 tableaux), conservés
maintenant au musée du Louvre. LE SUEUR mourut, non dans une cellule, chez les
chartreux, et dans les bras du prieur de ses moines, comme on a pu le dire,
mais chez lui, île St-Louis, et dans les bras de sa femme tant aimée, Geneviève
GOUSSÉ. Côté OLIVIER, c'est une toute autre
histoire, certes la famille est aisée et a comme clientèle l'aristocratie,
fréquentant la Cour, mais il semble que Jean et sa femme Marie Anne LE BRUN
aient connu des problèmes financiers vu le nombre de condamnations prononcées à
leur encontre par sentences des 29/10/1724, 12 et 15/01, 28/2, 7/3, 25/04,
10/07/1725 et 19/7/1726, les sommant de respecter leurs échéances. Au
décès de Marie Anne survenu en 1726, rue des Arcis[7],
leurs 7 enfants devront renoncer à la succession ou du moins l'accepter sous
bénéfice d'inventaire[8].
Charles LE BRUN son père, devenu tuteur de ses petits-enfants mineurs, avait
renoncé dès 1722 à son métier de marchand mercier, joaillier et tabletier
peignier, rue Planche-Mibray, pour devenir "Juré contrôleur courtier
vendeur de la volaille, gibier, cochons de lait, agneaux et chevaux". On
peut penser que le métier du bois ne rapportait plus assez ou bien qu'il
n'avait peut être pas le talent d'un TILLIARD. Il continuera néanmoins à vivre
jusqu'en 1732 sur les biens laissés par sa femme, Marie Françoise PORLIER, décédée
2 ans avant sa fille, au troisième étage d'une maison rue de la Tâcherie. Les
inventaires qui suivront les décès de chacun des arrière-grands-parents[9] et de
la grand-mère d'Angélique font pourtant état de vaisselle d'argent, de meubles
en bois d'olivier, d'armoires, de bibliothèques et de nombreux tableaux,
représentant Charles Borromée (canonisé en 1610), le cardinal de Richelieu, La
Sainte Famille ou La Madeleine, mais les dettes de la communauté excèdent de
beaucoup les biens et effets qui en dépendent. C'est en partie des
TILLIARD qu'Angélique Nicole OLIVIER, veuve LENOIR tient sa fortune. Elle
donnera et constituera en dot à sa fille Angélique la somme de 295 000 Livres
lors de son mariage avec Jean Marie Alexandre d'HAUTPOUL-FÉLINES en janvier
1780[10]. Le
père d'Angélique, Jacques Antoine LENOIR, quant à lui est le fils d'Antoine
LENOIR et d'Anne REINVILLE, cousins issus de germains, qui obtiendront une dispense
de l'Officialité de Pontoise pour se marier en 1724 à VETHEUIL (Val-d'Oise)
d'où leurs familles respectives sont originaires. (C'est dans la crypte de
cette très belle église du XIIe siècle, ci-contre) célèbre par son Retable, que
furent découverts en 1902 des sarcophages mérovingiens.) Les
LENOIR et les REINVILLE sont marchands de bois, parmi les nombreux négociants
qui se mobilisent et engagent des fonds vers l'exploitation du duché-paierie de
La Roche-Guyon, principal domaine de la famille de Louise Elisabeth Nicole et
de son père Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD.[11] L'intendant
de ce vaste domaine (de 1728 à 1768) n'est autre que Mathieu Robert GOUTTARD,
qui, par acte du 2 mars 1765 et suite au désistement de Jean Ducastel, fut
nommé tuteur d'Angélique et de Julien-Antoine LENOIR à la mort de leur père
Jacques-Antoine. Avocat au Parlement, prévost de Vétheuil, Mathieu GOUTTARD est marié à
sa cousine, Marie Geneviève OURSEL, elle-même, grand-tante d'Angélique,
Jacques-Antoine LENOIR et Pierre REINVILLE, ayant chacun épousé des demoiselles
OURSEL.
Ce
noyau familial soudé par des alliances communes attachées au domaine des LA
ROCHEFOUCAULD est pour Angélique, dès sa naissance, une opportunité
relationnelle, qui a certainement, par l'intermédiaire de Mathieu GOUTTARD,
joué un rôle prépondérant dans sa rencontre avec Jean Marie Alexandre
d'HAUTPOUL-FELINES. Angélique et Jean Marie Alexandre resteront mariés 12 ans. Souhaitant
sans doute protéger ses biens Angélique demandera le divorce, droit
nouvellement acquis depuis septembre 1792, notamment pour cause d'émigration.
En
1793, elle établira des procurations au profit de ses fils, puis des
déclarations les 3/9/1794, 6/7/1796 et 21/1/1798. Tous ces actes ont
malheureusement été passés en brevet auprès de Me Raffeneau qui n'en
a pas conservé les minutes. Elle
animera à Paris sous le Consulat
un salon fréquenté par les
notabilités de l'époque, au 9 rue du Gros-Chenet (actuel rue du Sentier). Mme
Vigée-Lebrun et Mme de Staël sont ses plus proches voisines. Angélique repose au Cimetière du Père-Lachaise avec sa
mère et ses enfants. Passons
à Alexandre (Alexandre-Marin), né le 27/12/1761, fils d'Alexandre
LENOIR, bonnetier de la rue St Honoré, et de Catherine Louise ADAM. Il est
l'aîné de 8 enfants, encore mineurs lors du décès de leur mère en 1790.
Élève
du peintre Doyen, archéologue, Alexandre Lenoir est l'un des personnages de la
Révolution qui continue à susciter parmi les historiens d'art et les
archéologues les plus violentes controverses. Les
destructions de la Révolution française seront à l'origine de la création du
Musée des monuments français. L'assemblée nationale, le jour même où elle
déclarait que les biens du clergé appartenaient à la chose publique, chargea
son comité d'aliénation de veiller à la conservation des objets qui pouvaient
se trouver renfermés dans ces domaines. C'est ce comité d'aliénation qui,
recherchant un lieu convenable pour garder les trésors qu'on se proposait de
recueillir, affecta la maison des Petits-Augustins au service de la sculpture
et des tableaux, en même temps qu'il instituait celles des Capucins et des
Cordeliers pour les livres et les manuscrits. Alexandre Lenoir, adjoint le 12 octobre 1790 à la commission des
monuments formée par le comité, demande et fait accepter, grâce au
soutien de Jean Sylvain Bailly, la réunion de tous les objets d'art provenant
des biens nationaux dans ce musée. Le 4 janvier 1791, il est
spécialement chargé du soin de recueillir les monuments, de les conserver et de
les mettre en ordre.
Destiné par son
éducation à la pratique de la peinture et n'ayant pas reçu une instruction qui
lui eût fait tenir une place parmi les érudits, il se distingua par son zèle à
remplir les devoirs qui lui avaient été donnés, par une haute intelligence
artistique et par un goût vivement senti
pour les monuments qu'il recueillait et disposait.[12] Il
épouse le 7 février 1794 Adélaïde BINARD, artiste peintre, dont il aura trois
enfants, Zélia (1795-1813), Albert né en 1801 et Clodomir en 1804.
Alexandre
père, né le 29/10/1723 à LA NEUVILLE-SUR-OUDEUIL[13] dans
l'Oise, avait épousé en premières noces Marie Charlotte MOUTON, dont il eut
quatre enfants. Marie Françoise, Françoise, Alexandrine et Henri L'aînée,
Marie Françoise, marchande de linge fin, rue de l'Arbre-sec, paroisse
Saint-Germain l’Auxerrois, avait une liaison avec Pierre MAYER, qu'elle finit
par épouser en 1789, dont elle eut une fille Constance, qui fut l'élève et la
maîtresse de Pierre-Paul PRUD'HON. Marie
Françoise décède brutalement le 30/9/1793. [14] Sa fille Constance, dépressive, vivait dans
l'inquiétude du lendemain ayant dépensé le capital légué par son père à la
carrière de Prud'hon et à l'entretien de la famille de celui-ci. Prud'hon
n'était ni veuf ni divorcé et une légitimation de leur liaison était toujours
impossible. Epuisée par les nuits sans sommeil et par l'angoisse qui la
tenaillait, elle se suicide le 28 mai 1821 dans sa chambre, se tranchant la
gorge avec le rasoir de son amant. [15] La sœur de Marie Françoise, (également prénommée Marie
Françoise) quant à elle, avait épousé Jean François Maurice HONORÉ Alexandre-Marin
Lenoir avait obtenu de Lucien Bonaparte l'autorisation de transférer à Paris le
23 avril 1800 les restes d'Abélard et d'Héloïse. Il en avait conservé des
reliques recueillies lorsqu'il était conservateur du Musée des Monuments
Français, qu'il distribuait à certains de ses amis (Vivant Denon...). Nous
pouvons suivre les traces d'une de ces reliques par l'intermédiaire de Mme
LENOIR-HONORÉ, fille ou belle-fille de Marie Françoise, qui les a reçues
d'Albert, fils d'Alexandre-Marin, et qui les donnera à Louis Maillard (1814-1865),
qui a connu la famille Lenoir à la Réunion. Les restes d'Héloïse et d'Abélard,
authentifiés par la signature de Louis Maillard du 17 mai 1860, passeront
ensuite à son cousin Alexandre Manceau, le dernier grand amour de GEORGE SAND,
jusqu'à Christiane Sand, seule héritière des archives Sand.[16] Le
petit-fils d'Alexandre-Marin, Alfred Lenoir, sculpteur, dernier enfant d'Albert
et de Laure Rey, s'était réfugié, pendant la Commune, à Péronne chez les HONORÉ
et avait "taillé dans la glaise" un médaillon du jeune Fernand HONORÉ
à l'aide d'une photo. Cette photo de 1870-1880 était jointe à l'enveloppe
contenant les précieuses reliques.[17] Alexandre
père céda à Jean François Maurice Honoré et son épouse Marie Françoise Lenoir,
par acte sous seing privé en date du 7 floréal an 6 (28 avril 1798), le fonds
de commerce de bonneterie sis au 497 rue Saint Honoré. Il
décède le 3 décembre 1802 au 28 rue Denfert à PARIS, à l'âge de 79 ans, Les Registres de LA NEUVILLE SUR OUDEUIL
comportant des lacunes entre 1704 et 1741, la filiation avec Alexandre
LENOIR, père d'Alexandre Lenoir et grand-père d'Alexandre-Marin ne peut être
certifiée. Toutefois un Alexandre LENOIR, bonnetier à La
Neuville, épouse Gabrielle PRUD'HOMME (†1722) dont il eut deux fils, Antoine et
Louis. Nous le retrouvons en mars 1761, logé chez son fils Louis rue
Montorgueil, en mai 1761 ainsi qu'en 1790 logé chez le sieur Alexandre Lenoir,
Me Bonnetier, rue St Honoré Paroisse St Germain l'Auxerrois à
l'enseigne de "la Perle".[18] Ce marchand de La Neuville épousa Catherine
SOUDAY en secondes noces (CM du 20/1/1742 Me Antheaume à Beauvais), Le père d'Alexandre
Marin né en 1723 est-il le fils de Catherine Souday ? Il
reste encore beaucoup de recherches à faire en perspective notamment du côté de
la marraine d'Alexandre Marin, Françoise COUART et de son parrain Marin CHERON dont on retrouve le
patronyme à Vétheuil. Par
les LENOIR, les LE BRUN et les LA ROCHEFOUCAULD, le Vexin se trouve encore au
cœur de ces investigations, et il n'est pas impossible de faire un jour le lien
entre les deux familles LENOIR, La Neuville-sur-Oudeuil se trouvant à 70 km de
Vétheuil.
Anne de Varax Remerciements particuliers à : A-M Lecordier [1] Inventaire du
21/08/1762 Me SIBIRE - AN ET/LXIX/693 [2] CM
du 19 février 1759 Me LE COURT - AN ET/CI/478 [3] CM
24 juin 1738 Me MASSON AN ET/CVIII/432 [4] L'art
du siège au XVIIIe siècle en France - Bill G. B. Pallot 1987 [5] Quittance du
7/7/1727 Me FROMONT - AN ET/XVII/651 [6] REVUE DE L'ART, n° 114 / 1996-4, p. 17-22 [7] La partie de
cette rue voisine de la Seine, a été détruite au XIXe siècle
et reconstruite jusqu'à l'endroit où elle se trouve coupée par la rue de Rivoli
créée alors. Cette partie était auparavant étroite, sale, obscure, et prenait
les noms de Planche-Mibray et des Arcis,
qui ont disparu. [8] Registre
Tutelle AN Y4403B 30/01/1726 [9] Scellés
du 28/4/1732 AN Y15932 et Inventaire du 9/7/1732 Me LE COURT AN
ET/CI/294 [10] CM du 11
janvier 1780 Me GOBERT AN ET/XLVI/476 [11] La famille La Rochefoucauld et le duché-pairie de La Roche-Guyon au XVIIIe ... Par
Michel Hamard [12] Les
monuments de l'histoire de France, catalogue des productions de la peinture, de
la sculpture et de la gravure. Par Michel Hennin
[13] Inventaire
ET/XI/820 Me Lecerf 13/01/1803 [14] AN,
ET/XXIV/982 du 29/1/1791 incluant un acte du 22/12/1793 [15] Constance
Mayer - [16]
http://www.pierre-abelard.com/reliques.htm#Le_baron_ [17]
http://www.pierre-abelard.com/nouveau%20don-B.htm [18] AN ET/LIII/371
du 6/03/1761 et ET/LXXVI/379 du 1/05/1761 |

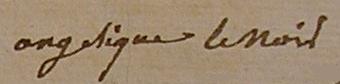 Dans un précédent article,
Dans un précédent article, 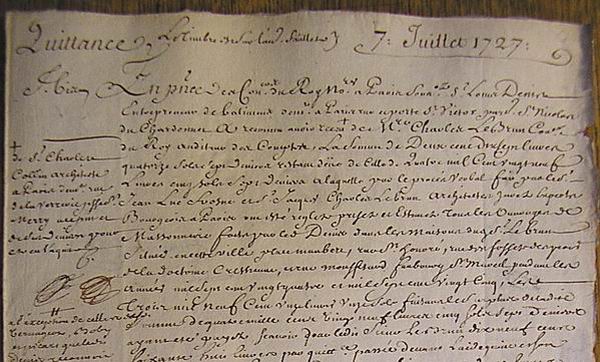
 Cette somme comprenait deux maisons rue St Joseph et rue du Gros-Chenêt pour
178 000 Livres et diverses créances dont étaient redevables entre autres, Me
Mayon d'Aulnois, le sieur de Melleville, le marquis de Poterat, et
surtout Louis MERCIER, son oncle pour la somme de 52 569 Livres (emprunt pour
payer la maison dite du "Chariot d'Or" acquise le 30/08/1749 et qui
avait également fait l'objet d'un emprunt de 12 000 Livres par Louis Mercier et
sa femme Elisabeth Nicole Olivier à Jean Nicolas de LA GUILLAUMIE Conseiller du
Roy & son épouse
Cette somme comprenait deux maisons rue St Joseph et rue du Gros-Chenêt pour
178 000 Livres et diverses créances dont étaient redevables entre autres, Me
Mayon d'Aulnois, le sieur de Melleville, le marquis de Poterat, et
surtout Louis MERCIER, son oncle pour la somme de 52 569 Livres (emprunt pour
payer la maison dite du "Chariot d'Or" acquise le 30/08/1749 et qui
avait également fait l'objet d'un emprunt de 12 000 Livres par Louis Mercier et
sa femme Elisabeth Nicole Olivier à Jean Nicolas de LA GUILLAUMIE Conseiller du
Roy & son épouse