|
|
Forteresses et tours médiévales du canton de Gaillon (partie 1) |
Part II - Forteresses alchimiques normandes et récits rabelaisiens
Un
château "fait aux dalles" alchimiques En
1262, le roi Saint Louis céda à Eudes
Rigaud (ou Odon Rigaud),
archevêque de Rouen, le château et le bourg de Gaillon, la tour et
le village des Noës avec le droit de présenter aux
prébendes, en échange du vivier, des moulins que les archevêques possédaient à
Rouen et d’une somme de 4 000 livres payée au roi à Nevers au mois de juillet
de cette même année. Tout cela nous le savons depuis fort longtemps, mais quelles sont les
raisons de cette cession à l’archevêque de Rouen ? E.
Rigaud était fort riche, selon certains de ses historiographes[1].
Depuis son accession au trône archiépiscopal du Rouennais, il cherchait
désespérément un castel en Normandie pouvant contenir et protéger toutes ses
richesses. Une chronique raconte qu’un soir, rentrant d’une visite auprès de
son suffragant l’évêque d’Evreux, E. Rigaud fut surpris au milieu de la
campagne par un violent orage. Accompagné de ses chanoines, il chercha asile et
trouva enfin refuge dans le domaine royal de Gaillon. Accueilli par le
capitaine de la forteresse, E. Rigaud y passa la nuit. L’archevêque de Rouen,
ébahi, tomba en admiration devant ce logis féodal. Etonné de voir un tel
château vide de ses occupants, il aurait dit au capitaine : « Voilà de
bonnes murailles qu’il doit être difficile d’escalader. Je pense qu’un trésor
ne saurait être plus en sûreté qu’ici »[2]. Dès cet instant, il eut pour seul objectif
d’entrer en possession du château de Gaillon afin de mettre tous ses biens à
l’abri. Si l’aspect Renaissance
du château de Gaillon nous est parfaitement connu, la documentation décrivant le château sous
son allure médiévale est quasi inexistante. On a estimé sa construction au
début du XIe siècle. Dans quelques rares
écrits, il est dépeint le plus souvent comme une forteresse avec de hautes
murailles crénelées, des tours et des remparts. Un assemblage bizarre
(sic) de bâtiments constituait le corps de logis. Tous les styles
d’architectures du Moyen Âge s’y trouvaient confondus, depuis les lourdes
colonnes lombardes jusqu’aux ornements bâtards de l’art byzantin, depuis les
plein cintre romains jusqu’aux timides ébauches de l’ogive sarrasine[3]. En 1404, Louis d'Harcourt,
primat de Normandie, fit venir une statue de Saint-Michel
que l'on plaça au-dessus de la porte du château. En 1412, Henri Lallemant était capitaine
de Gaillon. L’archevêque le gratifia d’une solde annuelle de 100 livres.
L'année 1413 voit l'édification d'un pont-levis entre les tours Job et Baudet, gardant l'entrée de la
forteresse. On fit quérir, de Tilly-en-Vexin, Olivier
Coquet, maçon et charpentier, pour assurer l’élévation de l'ouvrage. Dans le
même temps Philippot Couillard, verrier rouennais,
répara les vitraux de la chambre de Louis d'Harcourt. On
ne connaît pas vraiment la date de la construction des deux tours
gaillonnaises. On peut juste l’estimer vers 1262, époque où le château passa
entre les mains d’Eudes Rigaud. Ainsi la référence
biblique au livre de Job nous remet en mémoire le verset 11,12 où il est dit en
substance que l’homme doit apprendre pour ne pas rester dans l’ignorance tel un
onagre[4] ayant
la tête creuse : tête d’âne ou
tête d’Aiguille ? Quoiqu’il en soit, on donne à l’âne autant de vertus
que de défauts et divers sobriquets. Outre baudet ou Martin, renvoyant aux martinistes et à la confrérie des tanneurs patronnées par saint Martin, on le nomme aussi Rossignol
d’Arcadie[5]. Un ange
passe et le brouillard se dissipe encore un peu plus ! Ce
surnom lui aurait été donné par les habitants de cette contrée grecque qui
tiraient bénéfice de la vente de l’animal. Ils mettaient à profit jusqu’à ses
ossements, utilisés dans la confection des flûtes les plus sonores : les
flûtes de Pan, cela va sans dire. Il pleut, il pleut bergère... gare aux
tentations... de Saint-Antoine! A
Gaillon, JOB et BAUDET, orientées vers le Midi, rappellent étrangement JOACHIN[6] et
BOAZ, les deux colonnes situées à l’entrée du Temple de
Salomon soumises à la vigilance d’Hiram et de Maître Jacques. Joachin et
Boaz, comme saint Michel maître de la première
loge, furent reprises dans les rites et
symboles franc-maçonniques (J - B) du XVIIIe
siècle. Des alchimistes, dont l'athanor doit être alimenté par les mottes de tanneurs, prétendaient que Job après la perte de son troupeau
connut le secret de la Pierre Philosophale et devint si puissant qu’il
pleuvait du sel d’or dans sa demeure[7].
Eudes Rigaud et ses successeurs auront conservé la légende intacte. Les
anciennes tours de guet Le
plus ancien document prouvant l’existence du château de Gaillon est une charte,
datée de l’an 1025, de Richard II, duc de Normandie, en faveur de l’abbaye de
Saint-Ouen de Rouen[8]. La forteresse resta aux
mains des ducs de Normandie jusqu’en 1196, année où elle fut prise par Philippe
Auguste et remise à la garde de Lambert Cadoc. En
périphérie de Gaillon, très tôt les rois de France et d’Angleterre avaient
constitué un réseau de tours de garde ou postes avancés armés pour le protéger.
Peu de documentations concernant ces tours ont résisté aux ravages du temps. Le
canton de Gaillon est dominé par quatre d'entre elles et quatre autres
dispersées sur les hauteurs environnantes. Ces huit tours sont construites sur
le même plan, avec une cave, un rez-de-chaussée et deux étages, la même
épaisseur de murs, les mêmes ouvertures, les mêmes dimensions,
sauf qu'elles ne
sont pas construites avec
des matériaux semblables. Elles sont situées aux Rotoirs, à
Vieux-Villez (ci-contre), Tournebut, Tosny, Mouflaine, Tostes-la-Vallée, Tourny, et
Port-Mort. Au
fil des siècles, certaines, devenues surannées, ont été déclassées et
transformées en moulins à vent ou ont servi au télégraphe Chappe. Leur origine,
tout autre, ne peut être datée. Nous avons surtout vu que la construction de
certaines d’entre elles, associées au château de Gaillon, relevait de la géométrie
sacrée et suivait un schéma alchimique[9] dévoilant les dessous de la Maison des Mères, des prêtres de Cybèle. Dans
les années 1970 M. Germain Villain, historien amateur, voulant restaurer la
tour de Tosny bâtie sur le domaine des Terres Noires, avait fait
des recherches aux archives et à la bibliothèque de l'Eure, aux archives et à
la bibliothèque de la Seine-Maritime, à la bibliothèque nationale de Paris. Il
n'avait pas trouvé trace de ces tours qui pourraient nous renseigner sur leur
origine ou leur utilité. Le
seul document que nous avons en main en 2007 est une carte de Cassini du XVIIIe siècle. En l'observant, il faut noter
l'absence de moulin sur certains des sites impliqués comme au Hazey, tour des
Quatre Vents, (Vieux-Villez), alors que l'on en retrouve ailleurs. Même
si les plans de Cassini indiquent des moulins en 1748 à Tosny ou à Port-Mort
ceux-ci ont été selon toute vraisemblance des édifices remaniés pour les
besoins de l'époque, fortins ou tours de guet étant devenus obsolètes. Des
pierres meulières retrouvées à Tosny démontrent ces modifications
d’utilisation. Un
historien très qualifié avait affirmé à M.
Villain qu'elles ne pouvaient pas être autre chose que des moulins à vent ou
des pigeonniers. On voit mal un moulin situé dès le Moyen Âge à proximité
immédiate d'une forteresse : telle la situation de Château-Neuf près de
Port-Mort. De plus, quand on regarde les tours de Tourny, Vieux-Villez et
Tostes construites en matériaux de qualité et d'une architecture digne des
donjons de châteaux forts, on peut douter qu'un seigneur, même fortuné, puisse
faire construire un moulin à vent peu lucratif, d'une solidité pareille, dans
des endroits où les moulins à eau étaient nombreux. Ces moulins à eau étaient
de petites industries d'une bonne rentabilité pour les seigneurs. Tous
différents, très peu ont subsisté jusqu'à nos jours. De même pour les pigeonniers, orgueil et
prérogative seigneuriale. Il y avait plusieurs modèles : carré couvert à
quatre pans, circulaire couvert en rond ou couvert à six pans, voire à huit
pans suivant le titre du seigneur. Tous ces colombiers n'ont jamais été
construits de la même façon. Leurs
structures et leur situation stratégique font plutôt penser à des tours
militaires ou petits fortins. Dans son ouvrage, Tournebut[10], G. Lenotre est de cet avis. Il compare nos fortifications à la
tour de la Montjoye dans la forêt de Marly, ancien
poste de garde. Il nous raconte qu'en 1804, lorsque la tour de Tournebut
servait de repaire aux chouans de Normandie, il y avait un fossé et un pont-levis.
Toutefois, un document retrouvé aux Archives Départementales[11]
confirme l’hypothèse du moulin remanié avant la Révolution, époque où il fut
détruit. Depuis la tour porte le nom de Moulin Brûlé. Malgré
les recherches effectuées, les divergences sur l'origine de ces constructions
persisteront. L'énigme restera entière car aucun document ne vient soutenir
l'une ou l'autre hypothèse. Seule notre étude géométrique abonde dans le sens des
fortifications. Une
autre tour de guet authentique, dont on parle moins, existait au XIIIe siècle sur le fief des Noës,
proche de Saint-Aubin-sur-Gaillon. Elle faisait partie de la seigneurie du même
nom acquise par Eudes Rigaud en même temps que le château de Gaillon. En 1264,
la ferme des Noës était fortifiée, entourée par de
fossés en partie toujours visibles. Après avoir connu des fortunes plus moins
heureuses, elle devint la propriété du célèbre Jules Janin au XIXe
siècle qui détenait déjà le château des Rotoirs. Le bouclier de forteresses De
notre passé médiéval, il ne nous reste pratiquement aucun monument. Les
quelques tours de garde, transformées en moulins, dont nous venons de parler,
ne sont que de piètres vestiges d’une histoire glorieuse révolue. Pourtant,
plusieurs petites forteresses contribuèrent à la formation du royaume de
Philippe Auguste au XIIIe siècle. Il
reste encore quelques vestiges de ces châteaux forts, et celles-ci sont
incontestables. Plusieurs sont visibles situées sur les îles de la Seine entre
Les Andelys et Vernon. Elles sont au nombre de trois : le château du
Goulet, la forteresse de Boutavant à Tosny et le donjon de Château-Neuf à Port
Mort. Le
fortin du Goulet, appelé à tort Boutavant[12], fut
édifié par Philippe Auguste vers 1195 sur un site en bordure de Seine,
aujourd’hui appelé l’île aux Boeufs. Blanche de Vauvilliers,
auteur de l’histoire de Blanche de Castille reine des français[13], soutient cette
différenciation : Boutavant (ou Butavant) et Guleton (nom d’origine du Goulet). Il est resté dans nos
mémoires pour avoir été le séjour des rois Philippe et Richard Cœur de Lion au
moment de la signature du traité de Gaillon en 1196. Vainqueur de la bataille
de Bouvines en 1214, Philippe Auguste écroua Renaud, comte de Bourgogne, dans
cette geôle. Un autre petit château, dit Petit-Goulet,
fut construit sur l’autre rive de la Seine. Il
existe au-dessus de ce hameau l'emplacement d'une autre enceinte
militaire plus ancienne, semblable à celles qui se voient en assez grand nombre vers
l'embouchure de la Seine, et le long des falaises du littoral normand.
L'origine de ces camps retranchés est fort obscure. Nous sommes portés à en
attribuer l'établissement aux nations saxonne et scandinave qui envahirent nos
côtes au Xe siècle. Elles ont été baptisées châteaux sarrazins (sic) pour signaler leur origine normande.
Les vikings idolâtres était appelés sarrasins par les peuples subissant leurs
agressions[14], à l’instar des maures du
VIIIe siècle. Au hameau d’Emainville, près de Gaillon, les
retranchements d’un de ces camps normands sont cachés dans les taillis. Ils
affectent la forme d’une ellipse. Un sondage pratiqué en 1910 a fait apparaître
des pierres ayant servi de support à des piliers de bois au fortin dont le
fossé et le talus circulaire sont les seuls restes visibles (voir plan). De
nos jours, toutes les forteresses de la région gaillonnaise sont à l’état de
ruines. De simples mottes marquent encore leur emplacement. La majorité des
matériaux de l’île au Boeufs ont servi de réemploi pour l’édification de la
Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon
en 1563 et les maisons avoisinantes. Mais on sait que son château était encore
debout vers 1320, puisque Philippe V le Long y avait emprisonné Ferrant, comte
de Flandre[15]. Il ne peut donc s’agir
de la forteresse de Boutavant construite près des Andelys[16] qui
fut détruite plus tôt comme nous allons le voir. D’autres documents comptables
attestent d’œuvres de maçonnerie faites tant au château de Gisors, dans les
cachots, qu’à celui du Goulet en 1333 par le Machon
du duc de Normandie[17] (sic),
Robert de Hebercourt. Une
ordonnance[18] du roi Charles V, le
Sage, écrite du château du Goulet est datée du 17 avril 1364. C’est d’ailleurs
en cette place, et par les actes qu’il ratifia, qu’il prit pour la première
fois le titre de roi de France, succédant à son père Jean II le Bon, mort le
jour précédent. A
la fin du XIIe siècle, dans ce qui est maintenant l'île de Tosny,
non loin du Château-Gaillard, Richard Cœur de Lion, construit à son tour un
petit fortin qu'il nomma Boutavant : nom destiné à marquer cette place
forte construite toujours plus en avant. La forteresse devait défendre les abords
du Château-Gaillard aux Andelys. La tradition orale rapporte qu’un souterrain
de fuite desservait les
deux sites. Pourquoi en douterait-on ? On
a peut-être un peu de mal à se faire une idée de ces châteaux sur l’île aux
Bœufs ou celle de Tosny. Il ne faut pas oublier qu’à cette époque les eaux de
la Seine étaient beaucoup moins hautes et ces îles n’étaient pas aussi isolées.
Les cours d’eau étaient enjambés par de robustes ponts ou ponts-levis.
Boutavant était entouré d'un haut talus. On accédait à l'intérieur de la
citadelle par un de ces ponts-levis. On suppose que le bras de Seine, existant
aujourd’hui, s’est constitué à partir de l’amorce des douves médiévales, suite
à la montée des eaux dues à la construction du barrage de Port-Mort vers 1910. En
1200, le château fut le théâtre d’une entrevue entre Jean sans Terre et
Philippe Auguste en vue d’un nouveau traité de paix. Les tractations permirent
un échange d’otages, parmi lesquels se trouvait Robert II d’Harcourt prisonnier
du roi d’Angleterre. On pense généralement que c’est au château du Goulet
qu’eut lieu la transaction bien que d’autres aient prétendu que ce fut à
Gaillon. Quoi qu’il en soit, le rapprochement des deux parties devint effectif
par le mariage de Blanche de Castille, nièce de Jean, et de Louis, fils de
Philippe[19]. Au
mois d'avril 1200, Blanche de Castille, fille d’Alphonse VIII âgée de 11 ans,
arriva à Boutavant avec son escorte. Bien fatiguée, elle venait rejoindre son
fiancé le dauphin Louis, futur Louis VIII, qu'elle ne connaissait pas. Son
arrivée, par son attitude et sa grâce, produisit un tel émerveillement, parmi
les gens de la cour de Jean sans Terre qu’ils s’empressèrent de préparer le
mariage. Il eut lieu quelques jours après dans la chapelle du Château-Neuf de
Port-Mort, béni par l’archevêque de Bordeaux le 23 mai 1200. Malgré ces
circonstances qui déshéritaient le Louvre et Notre-Dame
de Paris des fêtes nuptiales, une vive allégresse n'en régna pas moins au milieu
des trois cours réunies. Des passations d'armes, des joutes, des fêtes de
toute espèce s'y succédèrent, et la nouvelle mariée y fut constamment l'objet
des hommages comme de l'admiration. Château-Neuf était
une autre forteresse bâtie par
Philippe Auguste vers 1199. Il ne subsiste rien de ces murailles élevées sur le
haut promontoire dominant le cour de la Seine. En
l’an 1202, le traité fut rompu une nouvelle fois et la forteresse de Boutavant
passa dans l’escarcelle du roi de France. Une entrevue entre les rois guerriers
fut organisée. Elle fut consignée par Jules Doinel, fondateur de l’église
gnostique, dans son histoire de Blanche de Castille[20]. Voici
comment les évènements se sont produits : les deux rois s'entretinrent
durant le carême entre Butavent (Boutavant) et Guleton (Le Goulet), à Château-Neuf, pour mettre un terme à
cette énième querelle. Dans sa chronique Matthieu Paris prétend que Philippe
demanda à Jean beaucoup de choses qu’il n’aurait pu accorder,
dont la cession de la Normandie, le Poitou, l'Anjou et la Touraine. Dès le
lendemain, Philippe envoya attaquer Boutavant, et le Château-Gaillard, le prit
et continua ainsi cette grande guerre qui ne finit que cinquante-six ans plus
tard. Certains
historiens rapportent la chose d'une autre manière, à savoir que Philippe
voulait obliger Jean à rendre justice aux barons du Poitou et à lui rendre
l’hommage qu'il lui devait pour la Touraine, l'Anjou et l'Aquitaine. Jean,
après plusieurs jours de réflexion s'obligea enfin, par un écrit authentique.
Il se soumit de toutes choses au jugement de la cour de France. Jean crut
pouvoir détacher Philippe des grands intérêts par de petits. Il offrit de lui
remettre deux nouvelles barrières de la Normandie et donna au roi de France les
châteaux de Boutavant et de Thillière[21], en
gage de sa parole. Philippe envoya donc recevoir les deux châteaux, mais on
refusa de les lui remettre. Les gouverneurs fermèrent les portes, et
déclarèrent qu'ils n'avoient point
d'ordre de les lui remettre. Alexandre Maillard,
seigneur d'Authouillet commandait la petite place forte avec une garnison
importante. Philippe
indigné cita Jean à comparaître à la cour des pairs, et voulut qu'il cédât une
partie des provinces françaises à son neveu Arthur de Bretagne, ou qu'il se
soumît au jugement qui serait prononcé. Quand le jour de l'assignation fut
venu, Jean ne comparut ni en personne ni par procureur. Jean prétendit alors
prendre le langage d'un roi mais n'en eut pas la conduite. Son indolence livra
ses Etats en proie à la guerre de Philippe qui prit la forteresse de Boutavant
et la rasa de fond en comble ainsi que celle de Thillière[22]. La
fureur du roi de France ne cessa pas avant d’avoir brûlé les châteaux d’Arques,
de Mortemer, de Gournay et de s’être emparé définitivement du Château-Gaillard,
des châteaux de Conches, du Vaudreuil en l’an 1204. Au
XVIe siècle toutes ces citadelles étaient démantelées. Aucun
souvenir n’aurait subsisté si quelques passionnés d’Histoire, érudits locaux,
n’avaient su tenir le flambeau de la connaissance allumé et le transmettre aux
générations suivantes. Aucune recherche archéologique officielle n’a été
entreprise pour préserver ces trésors de l’oubli. Puisse l’histoire future ne
jamais effacer cette fraction de notre patrimoine culturel car si nous n’y
prenons garde elle risque de disparaître dans les méandres de la mythologie au
même rang que Troie, l’Atlantide ou Théopolis.

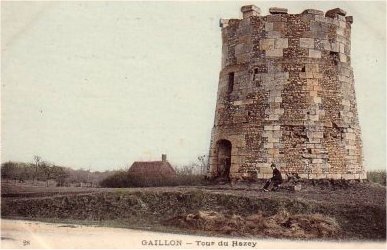
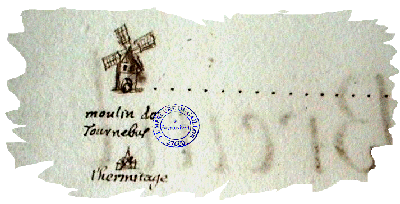
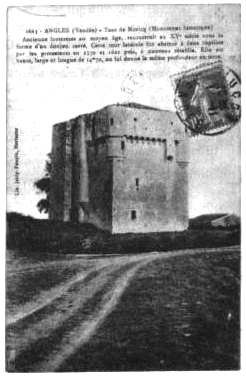
Le fort d'Angles
en Vendée ci-dessus
est une représentation
de ce que pourvait être
Boutavant de Tosny
dans l'Eure.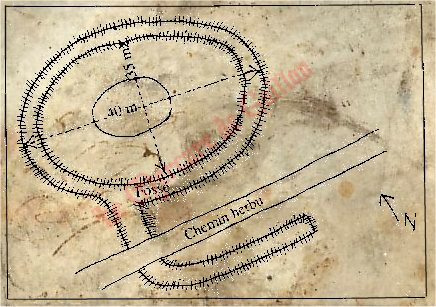
Plan du
château Sarrazin d'Emainville


Tour de Château-Neuf près de Port-Mort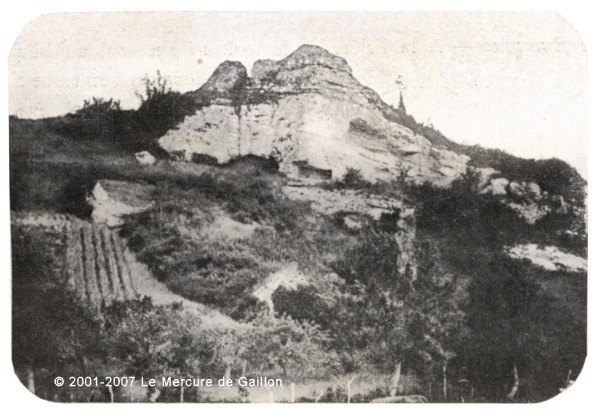
Vue des ruines de Château-Neuf
A suivre...
|
Pièces justificatives, bibliographie et notes Documents du dossier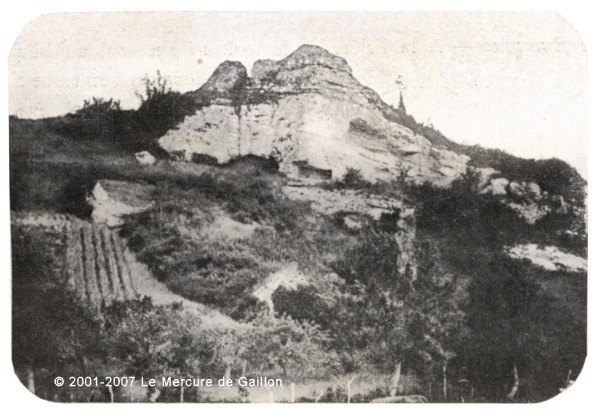


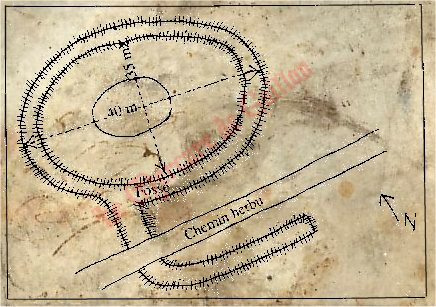
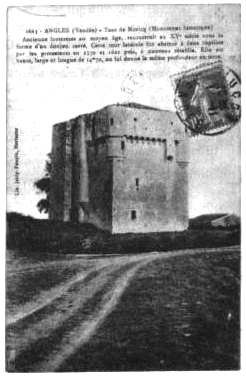
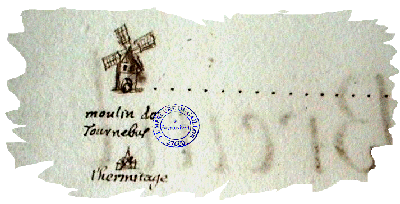

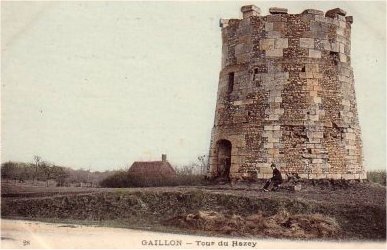
Téléchargement |
Thierry Garnier
Remerciements particuliers
à : A-M Lecordier
© 2001-2008 M2G éditions. Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.
[1] Châteaux et
ruines historiques de France, A. De Lavergne. , éd.
Charles Warée, Paris, 1845, p.319.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ane sauvage.
[5] Mémoires de
l’académie royale du Gard, Nîmes, 1833, p.95.
[6] Jakin ou Jaqin en hébreux.
[7] Dictionnaire
des sciences occultes, par J. Collin de Plancy, 1846,
p.899.
[8] Dictionnaires
des communes de l’Eure, par Charpillon et Caresme, 2° édition, Ed. F.E.R.N,
Avalon, 1966
[9] Mémoires des
deux cités T.II, Th. Garnier, M2G Editions,
2005-2007.
[10] Tournebut
1804-1809, par G. Lenotre, lib. Académique Perrin, 1913,
p.XXIII..
[11] A. D. de
l’Eure, cote 2F2493.
[12] Dictionnaire
des communes de l’Eure Charpillon et Caresme, note sur Notre Dame de l’Isle.
[13] Ed. Paulin,
1841, p.30.
[14] Une partie des
pagi Madriacensis et Vulcassinus,
par Georges Poulain, imp. Léon-Lainé, Rouen, 1913,
p.16.
[15] Le livre de Baudouin, comte de Flandre, suivi de fragments du roman de Trasignyes, publié par P. Serrure et A. Voisin de l’université de Gand, Bruxelles, 1836 , p.114.
[16] Histoire de
France depuis l’établissement de la monarchie française dans les Gaules, par
Gabriel Daniel, 1755, p.128.
[17] Catalogue
analytique des archives de M. le baron de Joursanvault,
T.2, lib. Techener, Paris, 1838, p.239.
[18] Recueil
général des anciennes lois françaises T.5, par Decrusy
et Isambert, Paris, 1824, p.185.
[19] La grande
chronique de Mathieu Paris, traduite en français par A. Huillard-Brehommes,
T.II, éd. Paulin, Paris, 1840, p.517.
[20] Histoire de
Blanche de Castille, par Jules Doinel, éd. Mame,
1879, p.17.
[21] Histoire de France
depuis l’établissement de monarchie française, T.IV,
par Gabriel Daniel, chez les Libraires Associés, 1755, p.127.
[22] Op.cit,
Mathieu Paris, p.545.

