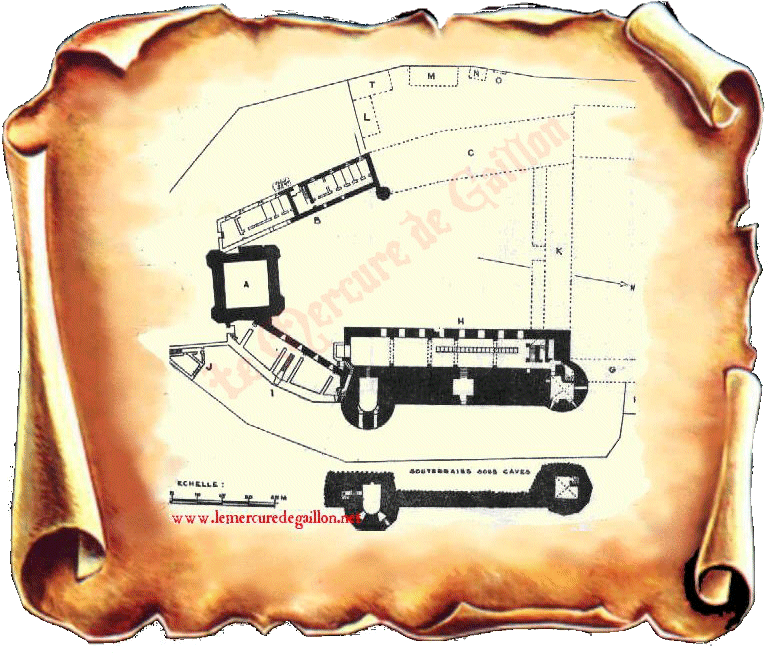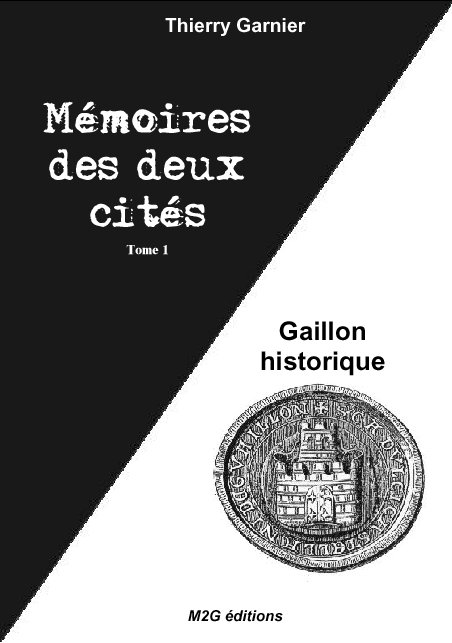de Gaillon (27)
(1ère étude)

L’architecture des anciens
A toutes les époques, les histoires de passages ou de caches secrètes ont
passionné les populations. De nombreuses légendes rapportent l'existence de
souterrains dans la région gaillonnaise. La plus connue et la plus décriée dit
qu'une galerie "où deux carrosses peuvent rouler" parcourt la
distance entre le château de Gaillon et le Château-Gaillard
des Andelys. La plupart des auteurs dénigrent ce fait, faute de preuves
tangibles, ou font fi des témoignages, argumentant sur l'impossibilité
technique de construire de telles structures ou encore la difficulté d'aération
des sites. Cette dernière affirmation est tout à fait caduque car nos ancêtres
pouvaient percer des cheminées de ventilation qui ont très bien pu être
rebouchées ou détruites avec le temps, donc impossible à retrouver. J'admets la
difficulté de réaliser un tel chantier mais certainement pas l'impossibilité. 
Vue du Château Gaillard au XVIIe siècle
Les bâtisseurs d'antan ont construit de nombreux
édifices bien plus complexes que des souterrains. En admettant la réalité de
cette réalisation pharaonique, elle n'a pu débuter qu'après 1204, quand Richard
Cœur de Lion fut vaincu au cours du siège du Château- Gaillard par Philippe Auguste.
De fait, il est bon de supposer que l'architecte prévoyait non pas un mais deux
tronçons de tunnel : l'un allant de Gaillon au fort de Boutavent,
l'autre de Boutavent aux Andelys.
Le plus souvent les souterrains qui partaient
d'un château étaient destinés à permettre aux occupants de fuir devant un
envahisseur. Ils rejoignaient une autre place forte proche ou débouchaient dans
la nature dans un endroit discret.
Nier tout en bloc serait aussi oublier, un peu vite à mon goût, les kilomètres de galeries
qui parcourent les sous-sols de notre capitale. D'autres villes, comme Provins,
sont dotées, depuis des centaines d'années, d'un réseau de galeries maçonnées, en plein-cintre, reliant les
différents édifices civils, religieux ou militaires, ainsi que des souterrains
dits "de fuite", débouchant à quelques centaines de mètres hors des
enceintes. Ces orifices, dissimulés, permettaient de communiquer avec
l’extérieur en cas de siège. Les galeries de carrières étaient creusées pour
une prise pratique et facile de matériaux (blocs d’extraction, sable à
mortier…). Ces galeries sont tortueuses, se recoupant et se chevauchant suivant
les filons. Ces souterrains médiévaux
appartenant presque tous à des particuliers ne sont pas visitables. 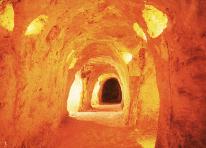
Souterrains de Provins
Nous savons également qu'à Gisors un souterrain
court du château jusqu'à la tour de Neaufles-Saint-Martin[1].
Tout ceci est nié farouchement par les historiens malgré des sources
municipales et préfectorales certifiées. Dans de nombreux écrits, le souterrain
est décrit en détail. Il passait sous la petite rivière de la Lévrière. Des tentatives ont souvent été faites pour y
accéder, mais les éboulements et autres obstacles n’ont pas permis une
exploration approfondie[2].
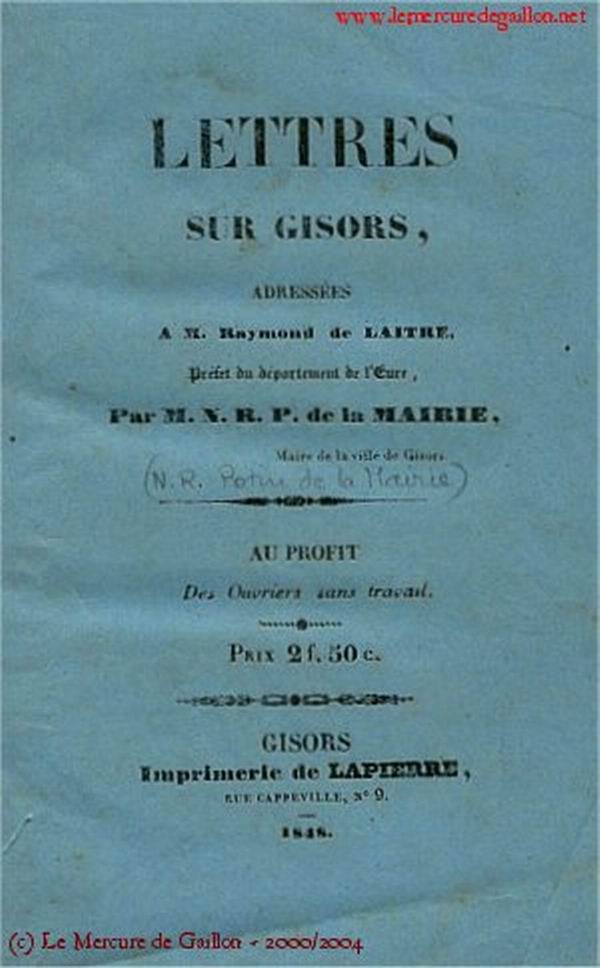
Il serait tout à fait surprenant qu’au château de
Gaillon, construit vers le XIe, il n’y eut
point de souterrains du même type. La structure Renaissance a été bâtie sur des
fondations médiévales. J’avais fait une demande officielle à la
DRACHN (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Haute-Normandie) dans
l'espoir d'obtenir une autorisation pour visiter les sous-sols du château afin
de faire une étude correcte et objective des lieux. J’attends toujours une réponse.
Que faire dans ce cas là ! Je pourrai palabrer
pendant des heures en essayant d'émettre des hypothèses. Mais je préfère plutôt
vous faire part des témoignages parfois anciens que j'ai recueillis.
Voyage au centre de la Terre
En 1940, le château devint une Kommandantur de
l’armée d’occupation. De son vivant mon grand-père racontait les tribulations
de quelques soldats allemands partis en exploration dans les mystérieux
bas-fonds gaillonnais. Pour eux, l'aventure s'était conclue par un non-retour à
la surface de la Terre. Un autre de mes parents pénétra dans ces entrailles
mais ne s'y aventura pas très loin. Avant de remonter, il avait bougé un pilier
et constaté qu'une galerie abrupte était dissimulée. Lançant un caillou à
l'intérieur, il avait entendu un bruit de verre cassé. 
Depuis plusieurs années les témoignages
s’accumulent. Dernièrement un antiquaire de Pressagny-l'Orgueilleux
près de Vernon, M. Lebrun, m'envoya un courrier électronique, me relatant ceci
: "Il y a environ 25 ans, alors que
Monsieur et Madame Richard, antiquaires, étaient propriétaires du château de
Gaillon. Ils étaient aussi mes clients. Plusieurs fois je leur ai rendu visite.
Ils logeaient dans des appartements sur la droite après le portail d'entrée.
Ils entretenaient une meute de chiens qu'ils nourrissaient avec des têtes de
bovins récupérées dans les abattoirs. Lors d'une visite, Monsieur Richard me
proposa de visiter les "oubliettes". L'accès s'ouvrait dans les
bâtiments situés sur la droite quand on entre dans la cour. Un escalier en
pierre en colimaçon nous conduisait vers les entrailles de la terre. Il fallait
descendre l'équivalent de 4 ou 5 étages si bien que je pensais être arrivé au niveau
de la Seine. On débouchait dans une pièce aveugle, divisée en deux avec un
plafond courbe sans arcs de soutènement. Aucun soupirail n'était visible qui
permette de renouveler l'air. L'endroit me semblait sinistre. Depuis si
longtemps, ma mémoire n'est pas assez fidèle pour en dire plus. J'en suis
désolé".
Ce ne sont bien sûr que des témoignages
personnels, mais ô combien précieux. Dans son ouvrage "Gaillon et ses
environs", A.-G. Poulain narre sa visite dans
ces oubliettes[3] :
"Que
l'on me permette de rappeler ici un souvenir de ma lointaine adolescence resté
très clair dans mon esprit. Vers 1890, j'avais à Gaillon un oncle nommé Giroudeau qui exerçait les fonctions de brigadier de
gendarmerie. Ce parent me fit visiter quelques parties du château non occupées
par les détenus. Je fus surtout frappé par la vue des oubliettes. Après avoir
descendu, accompagnés d'un gardien, un interminable escalier de pierre semblant
nous conduire dans les antres de l'enfer et qu'une porte bardée de fer fut
ouverte, nous pénétrâmes dans une salle assez spacieuse dont la haute voûte
était munie d'une trappe en son milieu. Sur le pavé, s'étalaient les restes de
paille humide donnant l'impression qu'un malheureux y avait séjourné peu avant
notre visite. Le gardien nous expliqua qu'en effet l'on enfermait ici les
incorrigibles à qui l'on passait la nourriture par la trappe au moyen d'une
corde. On les ramenait au jour lorsqu'ils était "tout verts", selon
l'expression de notre Cicérone".
Maçon de son état, avant guerre, mon grand-père
avait eu, pour chantier, la fastidieuse besogne de desceller les épieux et
lames métalliques situés dans ces oubliettes datant du Moyen âge. Malgré son inconfort, le château
fut sécurisé car dès 1939 il devait accueillir les réfugiés républicains espagnols
chassés par le franquisme.
L’existence de ce système de mort nous est confirmée
par le témoignage de notre correspondante et fidèle lectrice, A.-M. Lecordier : "En découvrant les écrits de
Thierry Garnier, des souvenirs depuis longtemps enfouis, ont resurgi. C’est
dans ma douzième année que j’ai quitté Gaillon, ma ville natale. Quelque temps
auparavant j’ai eu la chance de visiter le château ; enfin ce qui pouvait l’être.
La dernière fois, que je m’y étais rendue, c’était lors du bal costumé des élèves
du groupe scolaire Paul Doumer. Cette fois c’était différent, en comité
restreint. Le gardien nous a menés dans un endroit, au sol en terre battue
recouvert de paille : les « oubliettes » ; un trou à même le sol, en
partie obstrué par une échelle pour éviter tout incident, en occupait une
partie. Le gardien expliqua que par ce trou l’on précipitait les prisonniers
qui se trouvaient ensuite réduits en purée par un engin de torture constitué de
lames qui tournaient. L’on pouvait voir l’endroit où avait pu se trouver cette
machinerie car il y avait de la clarté dans ce sous-sol. Etait-ce pour mieux impressionner
la gamine que j’étais qu’il évoqua la présence d’une voie carrossable, qui
passait sous la Seine, menant de Gaillon aux Andelys ? Là s’arrêtent mes
souvenirs sur cette visite du château."
D'après les plans reproduits dans le livre "Le Château de Gaillon" d'E. Chirol (voir ci-dessous), il est probable que les sous-sols soient sur deux niveaux : le premier étant les caves[4], où le cardinal de Harley avait installé son imprimerie. La presse y était encore, mais inutilisée, à la Révolution. Ces caves sont voûtées en pierre de taille, d'une longueur de 66 m et d'une largeur de 9 m[5].
Les seconds constituent les souterrains et oubliettes appelées parfois tombeaux à vivants, dont l'ouverture est située dans la tour de la Sirène. Le plan indique très nettement entrées et descentes d'escaliers en colimaçon décrits par Messieurs Lebrun et Poulain. La réalité de ces souterrains est claire. 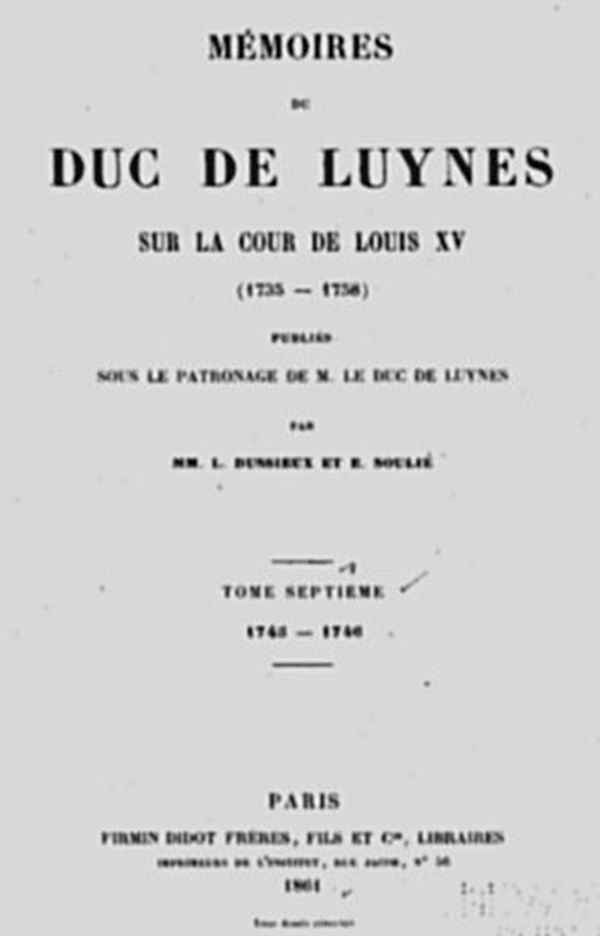
Les récits
précédents se voient renforcés par un témoignage de poids, celui du duc de
Luynes, datant de 1746. Cela ne date pas d’hier. Le duc fit un court exposé
détaillé des souterrains de Gaillon dans ses mémoires dont voici un extrait[6] :
"Le
château (de Gaillon – N.D.L.R) est presque entouré de
tous les côtés d'un fossé assez large et profond, sec et revêtu de murailles.
Il y a des souterrains, mais qui ne sont pas clairs. On descend dans les
premiers par un escalier de vingt-cinq marches, chacune de six ou sept pouces
de haut; de ceux-là on descend par un escalier de trente-cinq marches à peu
près de même hauteur, dans un autre souterrain, qui n'est pas fort grand, mais
assez clair. On compte dans ce château vingt-six appartements de maîtres, tous
commodes et bien meublés."
Il ne faut cependant pas confondre ces
souterrains avec les nombreuses marnières qui sont creusées dans les collines
de Gaillon. En juillet 2002, j'ai pu pénétrer dans une de ces cavités. Les
propriétaires, M. et Mme Lemarchand, m’avaient très
aimablement invité, avec quelques amis, à visiter le site. Ces marnières ne
sont que de très vastes tunnels. La plus grande mesure environ 60 m de long sur
6 ou 7 de large et environ 6 m de hauteur (photos
ci-dessous). Les matériaux ayant servi à la construction du château
proviennent en partie de cette mine calcaire.
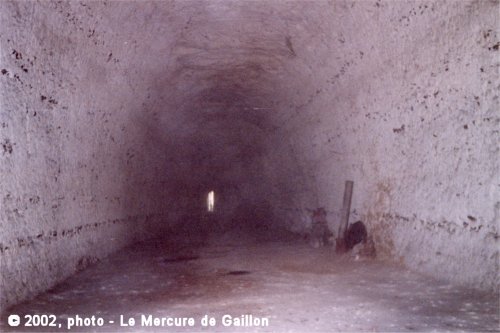 |
 |
| Anciennes mines de pierres calcaires ou marnières de Gaillon |
S'il fallait encore des preuves de l’existence
de souterrains au château de Gaillon, je conseille au lecteur de lire les
quelques passages extraits de "Mystères des vieux châteaux de
France", relatant les amours interdites au XVIe
siècle d'un prêtre prévaricateur nommé Riodet et d’Olinde une jeune fille de noble famille. Pour préserver
leur secret, les amants avaient échafaudé un plan. Le prêtre avait décidé de
faire disparaître sa maîtresse en la faisant passer pour morte. Avec son accord
il cacha sa bien aimée dans les souterrains du château pendant un an :
"Pour
donner à cette imposture un air de vraisemblance, il fallait absolument dérober
à tous les regards la femme que j'avais séduite. J'employai alors un
stratagème : la terreur. Ce fut le moyen et le ressort secret de ma
coupable intrigue… A la faveur de la nuit, je fis descendre Olinde
dans les souterrains du château. Là par une porte dérobée qui communique de la
chapelle aux galeries basses, il m'était facile de la voir".
Voyez qu'il y a là matière à discussion. Alors pourquoi Achille Deville, ce diable d'homme, élude-t-il le sujet dans ses comptes de dépenses pour le château de Gaillon en parlant de manière péremptoire de souterrains dont il n'y a rien à dire ? Y aurait-il anguille... ou aiguille sous roche ?


Graffiti découvert dans un
cachot du Château de GaillonExcavation mettant au jour
une galerie souterraine
du château de Gaillon
L’Aiguille
Creuse ?
On pourra me reprocher de spéculer sur
l'existence du réseau de galeries allant du château de Gaillon au Château-Gaillard. Je n'ai pas eu d'autre choix puisque
aucune étude sérieuse n'a été publiée; les autorités compétentes refusant
obstinément toute exploration ou alors, si cela fut fait (récemment ?),
les résultats ne furent pas communiqués et pour cause. Comme à Gisors il ne
faut surtout pas attirer les curieux. Tout ce qui concerne les dessous de
Gaillon tout est rigoureusement exact : le sous-sol du château est
"creux" depuis le Moyen Age si ce n'est avant. La datation reste à
faire. Il faut donc bien faire la différence entre ces galeries et le tunnel
d'environ 10 km conçu peut-être vers le début du XIIIe siècle dont l'existence sera soutenue par
un dernier témoignage de première main.
Un oncle passant la plupart de son temps à
battre la campagne aux alentours de Gaillon dans les années d'après guerre, me
raconta les courtes expéditions qu'il avait effectuées dans une galerie
souterraine. L'entrée se situait dans une ferme du village de
Courcelles-sur-Seine. Avec des amis, il avait pris soin de marquer d'un fil
d'Ariane son trajet. Il se souvenait d'un long tunnel sombre voûté et maçonné
en pierre de silex suintant l'eau à l'approche de la Seine. L'équipée ne put
aller au-delà du fleuve car le passage était bouché par un éboulis. D'après ses
renseignements, la galerie allait bien en direction du château de Gaillon et se
divisait en plusieurs tronçons allant dans d'autres directions.
Alors, la légende
deviendrait-elle réalité ? Ce témoignage apporte bien une preuve
supplémentaire de l'éparpillement d'un véritable réseau de constructions
souterraines dans la région Gaillonnaise jusqu'à la Chartreuse de
Bourbon-lèz-Gaillon et passant sous la Seine. Fadaises ? Non ! Aussi
curieux que cela puisse paraître, un tronçon a réellement existé de ce côté. Il
est devenu inaccessible étant effondré et inondé à certain endroit. Dans le
domaine de la Créquinière (commune d'Aubevoye), dernier
refuge des chartreux après la Révolution, il existait un accès à un souterrain.
Cet accès est fermé de nos jours par une porte en fer et le tunnel a été bouché
à quelques mètres de l'entrée.
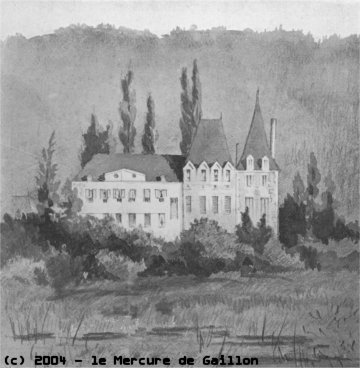 |  |
| Tournebut vers 1800 | Tournebut aujourd'hui |
Un autre site
souterrain a été localisé au château de Tournebut. Il
m'a été donné l'occasion de le visiter. La galerie sans éclairage, située en
plein milieu du domaine, apparaît comme une cave voûtée de belle allure avec
quatre alvéoles (deux de chaque côté). Mais s'il ne s'agit que d'une simple
cave, pourquoi des traces de sondages sont-elles perceptibles dans chacun des alvéoles ?
Ceux qui ont effectué ces sondages voulaient-ils savoir si d'autres galeries
existaient et pouvaient avoir été bouchées ?
La construction du premier manoir de Tournebut doit dater du XIVe ou XVe siècle. Il fut plusieurs fois détruit et rebâti sur les fondations du précédent. Des chroniques relatant son histoire rappellent l'existence de souterrains de fuite dans l'ancienne demeure du XIXe siècle[8]. Vu la situation de cette cave, il est plus qu'évident qu'elle est le dernier vestige de ces souterrains dissimulés dans les épaisses murailles de la bâtisse, aujourd'hui disparue, du chevalier de Mauriac.
 |  |
| Galerie souterraine de Tournebut | Sondage effectué dans la muraille d'une alvéole |
|
Documents et pièces justificatives |
| ||
© Thierry Garnier – Mis à jour le 05.12.07 Remerciements particuliers à : A-M Lecordier |
[1] Lettres sur
Gisors adressées à M. De Laitre Préfet de l'Eure, par Nicolas René Potin de La
Mairie - 1848
[2] Tristan le
Voyageur, ou la France au XIVe siècle par Louis-Antoine-François de
Marchangy, 1825, p.146 et 375.
[3] Gaillon et ses
environs, par A.-G. Poulain, 1960.
[4] Le Château de
Gaillon, par Elisabeth Chirol, 1952.
[5] Connaissance de
l'Eure n°66-67, 1987-88.
[6] Mémoires du duc
de Luynes sur la cour de Louis XV (1735-1758), T.VII, 1745-1746, par Charles
Philippe d'Albert duc de Luynes, éd. Firmin-Didot, Paris, 1861, p.40
[7] Mystères des vieux châteaux de France, tome
IV, éd Eugène et Victor Penaud, s.d. vers 1865.
[8] Aubevoye et son passé,
G. Villain - Beaumont-le-Roger : Eure, impr. U. Faure, 1965.
Polices d'écritures: Tempus et Old English
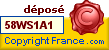 |