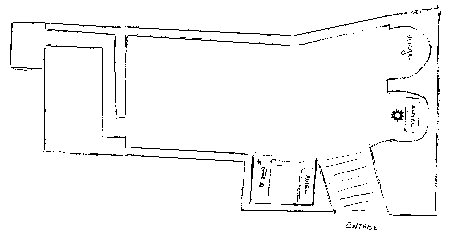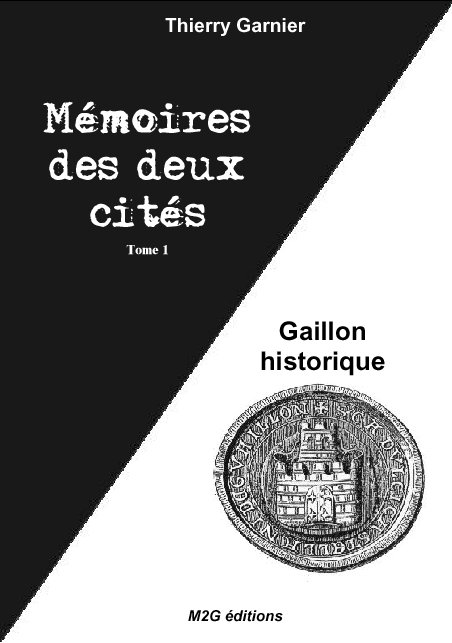Fondation
Nommé en 1550 à la tête de l'archevêché rouennais, le cardinal
Charles Ier de Bourbon avait fondé à Aubevoye, en 1571, l’abbaye de
la Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon. Ce prélat, désirant avoir près de sa
résidence archiépiscopale du château de Gaillon, une
copie exacte de la chapelle de Bethléem , bâtie sur l'étable où naquit le Christ,
envoya à deux reprises en Palestine, son architecte chargé de relever les plans
de ce haut lieu du christianisme. 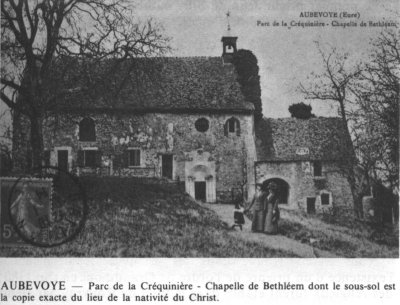 CHAPELLE DE BÉTHLÉEM (Avant sa restauration) En 1582, la chapelle et sa crypte, étaient achevées, et il en fit don
aux moines de la Chartreuse avec les terres, vignes et bois des alentours. Tout
comme l'était le Bethléem d'Orient, le Bethléem d'Aubevoye fut planté au sommet
d'une colline. Cependant, en Judée
Bethléem est juché à 846 m d'altitude, alors que le sanctuaire normand s'élève
seulement à 94 m, dominant la vallée de la Seine.
Acquisition
et restructuration Le
21 mars 1791, après la spoliation de la Chartreuse, le petit domaine de
Bethléem fut mis en vente et acheté par Mme Vve Chemin, née Lemoine, et ses
deux fils. II est fort heureux que ces acquéreurs respectèrent les dispositions
de la chapelle, se contentant de convertir la crypte en cellier. Après la famille Chemin, la propriété fut
acquise par Mr et Mme Mignot qui restaurèrent le monument et, le 24 Novembre
1895, il fut rendu au culte. Après
le décès de Mr et Mme Mignot, Bethléem échut par donation à Mme Mary, laquelle
s'en dessaisit vers 1914 au profit de Mr Matheron. En 1956, ce dernier le céda
à Mr et Mme Germain Villain, d'Aubevoye, famille très connue et estimée dans la
région de Gaillon. Mr
Villain avait converti sa jolie maison située au bas de la colline, en un
véritable musée, et taillé dans la pierre le calvaire du nouveau cimetière de
sa commune. Après le décès du couple Germain, Mme Gisèle Bailleul, notaire à
Gaillon, en devint la propriétaire en 1981. La
chapelle était, lors de la vente en 1956, dans un état de délabrement
pitoyable. La charpente du toit était à nu, les portes défoncées, des pans de
murs écroulés. 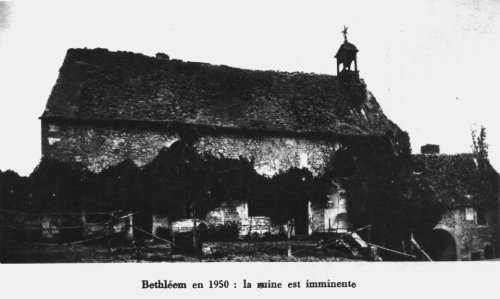 Ne
reculant devant aucun sacrifice, Mr et Mme Villain[1], dont
le courage n’a d’égale que la patience, ont su restaurer, par eux-mêmes, les
injures que le temps et les hommes avaient fait subir à ce vieux sanctuaire. Cette
œuvre monumentale était en partie terminée à la fin de l'été 1958 : les
toits refaits entièrement, l'aménagement de la crypte, du logis du vigneron
attenant à celle-ci terminés. Il ne restait plus à réparer que l'intérieur de
la chapelle et le logement des moines, dont les murs effondrés étaient en cours
de réfection.  Grands
travaux La
décoration intérieure fut réalisée avec soin par les époux Villain. Le mobilier
du culte était du XIXe siècle. Les vitraux, peut-être la tâche la
plus complexe à réaliser, ont été reconstitués par Mr Villain à partir de
matériaux anciens de récupération achetés chez des antiquaires ou brocanteurs. N'ayant
aucune gravure pour restituer une image des vitraux d'origine, Mr Villain
laissa libre cours à son imagination en s'inspirant de scènes de la Nativité. Malgré
les difficultés incombant pour une telle entreprise, on ne peut qu'être
admiratif pour le travail effectué par un homme qui n'avait, de surcroît,
aucune formation dans les métiers du bâtiment. Les efforts de Mr et Mme Villain
sont dignes de la reconnaissance du public, de tous ceux qui estiment que
conserver notre patrimoine historique et artistique est une œuvre fondamentale
pour les générations futures. Voici
l'état de la chapelle tel que l’a constaté Alphonse-Georges Poulain[2] à la
fin de l'été 1958 : Son
orientation est régulière (est-ouest) et fut bâtie sur un plan cruciforme. Mais
dans le courant du XIXe siècle, ayant été transformée en logement,
les croisillons furent abattus et une cloison sépara le chœur de la nef. Un
petit campanile qui ne date que de 1798, surmonte le toit de l'ancien chœur,
près du pignon du chevet. Celui-ci était percé d'une haute et large baie
amortie en arc plein cintre et les murs du sanctuaire de deux fenêtres de même
forme, ainsi que de deux œils-de-bœuf. Chœur et nef étaient voûtés en berceau
au moyen d’un bâti enduit de plâtre qui n'existe plus. Dans le mur latéral sud,
quelques portes et fenêtres furent percées. 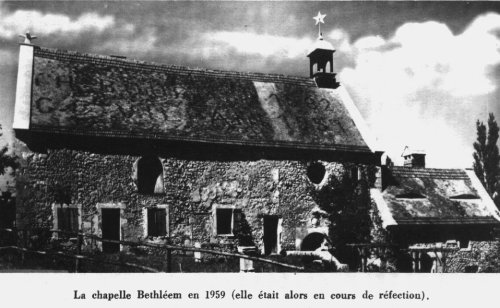  Copie conforme ou presque En
faisant édifier la chapelle de Bethléem à Aubevoye, le cardinal de Bourbon n'a
jamais voulu égaler celle de Judée, ni par ses richesses, ni par son étendue;
puisque notre sanctuaire normand est beaucoup plus réduit (mais rigoureusement
exact) : Bethléem normand: 19 m de long, 8 m 60 de large, elle ne possède qu'une
seule nef et le transept ne mesure que 6m 60 de long (voir le plan établi à main levée), alors que...

Elle
est surmontée d'une voussure en plein cintre composée de cinq rangs de moulures
dont chaque extrémité repose sur les chapiteaux d'ordre corinthien de deux
colonnes engagées (de chaque côté), dont les bases présentent deux tores
séparés par une gorge. Le tout taillé dans la pierre de la région dans le plus
pur style Roman. Il est à noter que les cinq arches de la porte symbolisent
très certainement les cinq nefs de la grotte originale. Au-dessus dans un bloc
de pierre, sont sculptées les armoiries du cardinal Charles Ier de
Bourbon, qui ont été quelque peu martelées, sans doute pendant la Révolution de
1789, et qui se blasonnent ainsi : «de
Bourbon, qui est de France (d'azur à trois fleurs de lis d'or posées 2 et 1) au
bâton péri (raccourci) en bande de gueules, l'écu posé sur une croix (sans
doute archiépiscopale, c'est-à-dire à deux branches) en pal (c'est-à-dire
verticale). Sommé d'un chapeau de cardinal (à cinq rangs de houppes) et entouré
du collier de l'Ordre du St-Esprit[3]. Après
avoir descendu quelques marches, en contrebas, vers la gauche, un autre petit
autel dédié aux Rois Mages. Etranges
visiteurs Il
y a encore quelques années, pendant la nuit de Noël, une vraie messe de
minuit en latin y était célébrée. En effet, un Indult pontifical
prescrivait que la messe de minuit soit célébrée dans la grotte. Sur les murs
Nord et Sud, deux croix pattées rouges se font face. Celles ci sont des Dédicaces
octroyées par le Clergé pour consacrer ces lieux.
Une
plainte a été déposée à la gendarmerie. Nous ne pouvons qu'espérer
l'arrestation de cette bande d'irréductibles crétins pour qu'ils paient cet
acte lâche et irresponsable. Nous remercions Mme Gisèle
Bailleul, notaire à la retraite, de nous avoir accordé l'autorisation de
visiter ces lieux enchanteurs et de publier ces quelques lignes afin de garder
en mémoire sa charge historique et mystique. Documents et pièces justificatives Thierry Garnier Remerciements particuliers
à : A-M Lecordier
|
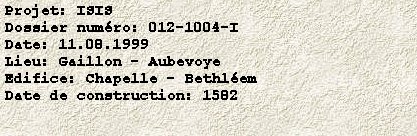

 Un peu plus au nord de l'église d'Aubevoye, dans un paysage à la
fois enchanteur et mystérieux, s'élève la chapelle de Bethléem, dont les
infortunes méritent d'être racontées.
Un peu plus au nord de l'église d'Aubevoye, dans un paysage à la
fois enchanteur et mystérieux, s'élève la chapelle de Bethléem, dont les
infortunes méritent d'être racontées. 




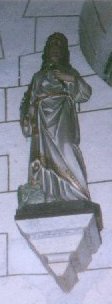 A
quelque vingt mètres de la chapelle, existe un bâtiment ayant abrité jadis le
pressoir des moines. Les vignes couvraient les vastes herbages s'étendant vers
le sud-ouest. Le charme de ce paysage sera complet en écoutant murmurer les
eaux ondoyantes d'un petit ruisseau s'échappant de l'une des cinq sources qui faisaient
tourner jadis le moulin de la Chartreuse.
A
quelque vingt mètres de la chapelle, existe un bâtiment ayant abrité jadis le
pressoir des moines. Les vignes couvraient les vastes herbages s'étendant vers
le sud-ouest. Le charme de ce paysage sera complet en écoutant murmurer les
eaux ondoyantes d'un petit ruisseau s'échappant de l'une des cinq sources qui faisaient
tourner jadis le moulin de la Chartreuse.